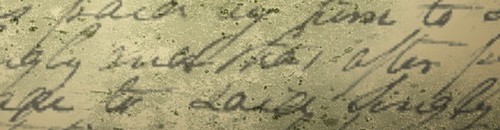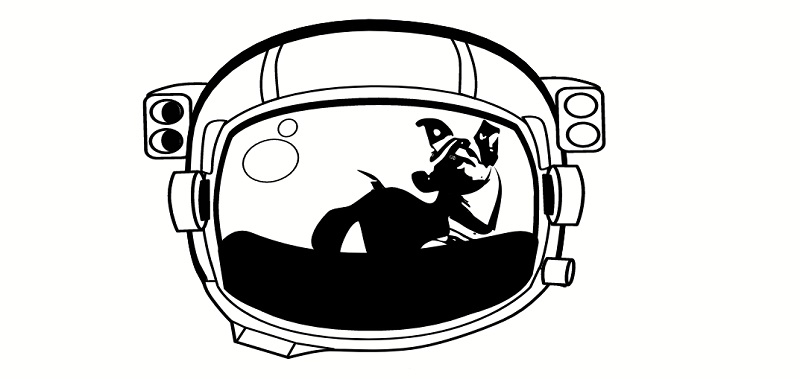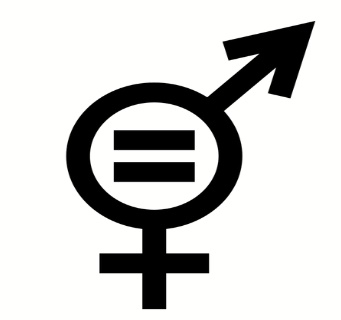Quand des groupes érigent des totems idéologiques supposés répondre à une menace que l’on croit bien définie, on insiste sur le caractère étranger et intrusif de cette menace. Cela a deux conséquences : le totem ainsi érigé devient le symbole vénéré d’une union du « nous » contre une union d’abord mal définie du « eux », mais on aide du même coup, en ostracisant, stigmatisant, des membres de notre propre groupe aux contours d’abord flous, eux, à rejoindre et composer un totem idéologique opposé se nourrissant uniquement du rejet du groupe désormais mieux défini.
Ainsi naissent certains groupes : en s’opposant les uns par rapport aux autres. Ainsi fleurissent les idéologies de la violence.
À l’image des trolls, les idéologies, comme les religions, se nourrissent du rejet qu’elles suscitent. « Qu’importe qu’on parle de moi en mal, pourvu qu’on parle de moi » : même principe. Combattez une idéologie et vous ne faites que l’alimenter.
Mais totem contre totem, ce qui est en jeu, c’est ce qu’on trouve derrière les symboles, contre quel ennemi on combat. Si on pense toujours qu’il y a derrière le terrorisme une question légitime idéologique liée à la supposée radicalisation d’une religion, l’islam, alors on ne pourra qu’échouer à résoudre la question des attaques terroristes et on ne fera que nourrir le monstre et aider à bâtir, à rendre consistant, un peu plus ce totem qu’on prétend vouloir abattre.
Aucune idéologie ne pourrait motiver et légitimer une logique mortifère dans laquelle on tue des innocents. On trouve des motifs derrière les crimes passionnels, derrière les attentats politiques, mais derrière l’idéologie supposée des djihadistes, il y a des hommes rejetés par leur société qui trouvent par opportunisme avec cette idéologie (et leur totem) une manière d’exister et de donner sens à leur vie. La cause n’en est pas une, mais puisqu’elle est désignée ainsi par tous, y compris par ceux qui en sont victimes, elle apparaît alors comme réelle et légitime. Mais ce n’est jamais l’idéologie, prônée le plus souvent cette fois à l’étranger, qui éveille les consciences à leurs idéaux ; c’est au contraire les rejetés de la société qui trouvent là un prétexte à se retourner contre elle. Ces rejetés se retourneront alors plus volontiers contre leur société si en son sein les groupes tendent toujours plus à se lier contre des ennemis de l’intérieur qu’on ne voit pas, qu’on redoute, et qui sont secrètement liés aux idéaux étrangers.
Le terrorisme est moins une question idéologique qu’un problème d’ostracisation sévère des membres de la société dont on se méfie. L’origine des violences est non pas idéologique, mais bien sociétale et psychologique.
Demandons-nous ce qui précède entre l’idéologie (donc l’idée, la pensée, menant à la lutte, à la violence) et la simple idée de tuer, de s’en prendre à ses semblables, ses voisins. Dans la quasi-totalité des cas, si on essaie de comprendre le parcours des terroristes, l’idéologie vient toujours après et semble bien légitimer une violence contenue jusque-là et qui ne se serait certes pas exprimée avec une telle violence si l’idéologie en question, le totem, n’avait pas pris corps. Les frustrations d’une intégration bâclée, les désillusions de jeunes adultes ne trouvant pas leur place dans la société qui les entoure, le rejet ressenti réel ou supposé des autres, c’est tout ça qui mène les individus à rejoindre les totems d’une idéologie que le plus souvent d’ailleurs ils connaissent mal. Les terroristes sont des opportunistes, des psychopathes, et penser qu’ils sont créés à l’extérieur est la pire manière pour espérer s’en débarrasser.
On prétend que les terroristes ne sont pas des loups solitaires parce qu’ils sont armés, préparés et sont liés à des réseaux. D’accord, mais les idéologues eux n’agiront jamais. À l’image des gourous, ils incitent leurs disciples à faire ce qu’eux seraient incapables de faire. Comme dans les sectes, l’idée est bien de trouver des individus fragiles et rejetés par la société pour qu’ils puissent exercer sur eux l’influence souhaitée. Que ce soit chez les tyrans, les gourous ou les commanditaires d’attentats, ce sont les architectes des totems qu’ils aident à élever principalement par la peur et la haine d’un ennemi parfois imaginaire. Les terroristes, ceux qui disent partir en martyrs selon les principes du dieu totem, de l’idéologie qu’ils sont censés défendre, sont bien des loups solitaires, d’anciens loups solitaires réunis autour non pas d’un même chef de meute, parce qu’on ne suivrait pas la quête personnelle d’un seul homme, mais autour d’un totem idéologique. Le symbole d’une union construite autour d’une même haine.
Des loups solitaires, qui ne choisissent pas de devenir terroristes, mais qui ont, contenu en eux, une violence commune, la société en construit tous les jours. Ce qui les pousse, et leur donne l’occasion de se mettre à l’œuvre, et alors de quitter leur frustration solitaire, c’est de trouver une idéologie, un totem, capable de leur correspondre. On se rapproche de ceux, les seuls désormais, qui disent vouloir tirer le meilleur de nous, nous mettre en valeur et nous accepter non pas pour nos valeurs (on est opportuniste et on se lie au maître qui nous tend la gamelle) mais pour ce qu’on est, ou supposé être. Un individu aux origines étrangères cherchera en vain ses modèles dans la société qui l’entoure et se tournera plus volontiers vers un groupe capable de lui dire « cela, c’est toi, c’est nous ».

un totem dressé
Comme il est aisé de trouver de nouveaux totems idéologiques quand les membres d’une société qu’on a fini par abhorrer construisent si facilement leur propre totem vous désignant comme leur ennemi… L’ennemi (son totem) de mon ennemi (son totem) est mon ami (mon totem, ma nouvelle idéologie).
Logique destructrice.
Pointer du doigt l’islam, qu’on l’accompagne ou non du terme « radical », c’est aider à l’érection du totem des ennemis qu’on souhaite s’inventer pour affirmer, par contradiction, son appartenance à un groupe qu’on cherche par là à souder et à définir. Désigner son ennemi, c’est nourrir deux monstres. Celui qu’on alimente chez « l’ennemi désigné », mais aussi celui qui est en nous, parce qu’il se nourrit avant tout de peur, de haine, de rejet, de méconnaissance, de préjugés ou de raccourcis faciles de pensée devenus légitime par la seule existence supposée de ce monstre dont on se complaît et participe à donner corps et à nourrir. Ceux qui désignent les éléments perturbateurs d’un groupe ont toujours, à première vue, le beau rôle, parce qu’ils semblent œuvrer pour l’harmonie des leurs ; les membres d’un groupe ont toujours besoin de sceller leur identité et appartenance commune en dansant autour d’un même totem idéologique ; et ceux qui parlent en allant dans ce sens sont alors perçus comme des architectes, des bienfaiteurs, de grands prêtres de l’identité commune qui nous compose. Le groupe, pour se définir et s’unir autour de valeurs communes, a besoin d’un ennemi commun ; et quand cet ennemi n’existe pas, il faut l’inventer. Le nourrir. Dans une société pourtant prospère, on peut voir apparaître une haine et un ostracisme à l’égard de certaines de ses composantes ostensiblement exotiques, et pour nourrir cette peur qui est censée réunir ceux qui sont ostensiblement, eux, indigènes, on scrute tous les faits et gestes de ces éléments jugés perturbateurs. Le moindre dérapage « confirme la règle », nourrit la haine, et prend des proportions aberrantes. Un crime terroriste perpétré au nom du totem malfaisant et ennemi aura un impact bien plus grand qu’un crime de même nature généré par un membre de son propre groupe. Un crime de masse, un meurtre isolé, ce n’est pas une attaque terroriste, et on relayera ça dans les pages des faits divers.

un totem dressé
Comme il est réconfortant, et facile, gratifiant même, de jouer avec les illusions de masse pour se cacher derrière son propre totem, se hisser en son sommet pour qu’on nous y voie chanter en son honneur contre l’« ennemi ».
C’est une illusion à laquelle il faut lutter. Les véritables ennemis sont ceux qui s’y laissent prendre ou s’amusent à attiser le feu d’un malaise bien intérieur.
Quand la guerre froide a pris fin, le monde n’a pas mis longtemps à se réorganiser pour que de nouveaux blocs puissent se faire face et se haïr. On aurait pu nous contenter de lancer la guerre au rhume des foins, à la grippe ou aux accidents de la route, mais ces ennemis-là ne font que des victimes collatéraux qu’on accepte parce qu’ils nous semblent communs et non dirigés par la même main invisible d’un méchant monstre. L’ennemi doit être idéologique, peu importe quelle nuisance réelle il opère sur notre société, c’est l’intention qui compte, l’idée, tournée contre « nous ». Il est important qu’un « eux » se définisse rapidement pour qu’un « nous » réconfortant puisse jaillir de terre et s’ériger en totem. « L’ennemi » n’aura alors qu’à profiter de la place laissée vacante par l’ancien totem abattu, et tout recommencera comme avant. Parce que les sociétés se créent ainsi un peu comme la poussière s’agrège sous une armoire pour enfin constituer des moutons qui se feront bientôt la guerre. Avant que tout se mêle et se confonde, il faut que tout se percute et s’anime. Curieuse danse de moutons.
On saute à pieds joints dans le piège des illusions et on en vient à légitimer nos propres crimes pour ne pas voir les défaillances qui au cœur de nos sociétés portent en elles les véritables maux qui pourrissent, de l’intérieur, l’harmonie tant souhaitée. Et quand ce ne sont pas des crimes qu’on légitime, c’est la remise en question de nos libertés fondamentales. Sans comprendre qu’en attisant la tension et le feu intérieur, on nourrit chaque fois plus les maux préexistants qu’on se complaira ensuite très vite à interpréter et voir comme une menace éminemment exotique.
Maurice Pialat un jour à Cannes lançait : « Si vous ne m’aimez pas, sachez que je ne vous aime pas non plus », en réponse au public qui le sifflait. Action de rejet, réaction de rejet. L’idéologie, le bras levé pour ériger on ne sait quel totem imaginaire, n’est alors qu’un prétexte : on ne s’érige jamais d’abord que contre un ennemi imaginaire, craint, supposé, et en le désignant, on aide à lui donner une consistance bien réelle. Parce que parmi ceux désignés comme « ennemis » du groupe seront tentés par un « si vous ne m’aimez pas, sachez que je ne vous aime pas non plus », non pas d’abord par une logique idéologique. Les totems se dressent grâce à l’irrationalité, à la peur irrationnelle de l’autre ou au rejet compulsif de ceux qui en premier lieu nous rejettent.
Les totems de l’idéologie ne sont pas seulement nécessaires pour alimenter les ennemis « extérieurs ». On se plaît à les ériger aussi en politique (où pour discréditer un ennemi, il est plus profitable de jouer sur les peurs qu’il inspire ou en « radicalisant » son discours) ou dans la culture (parfois jusque dans l’absurde, quand par exemple on voit de l’idéologie à travers une œuvre qui ne peut pas par définition exprimer, ou même illustrer clairement, une « idée » : telle œuvre devient raciste, tel cinéaste est suspecté d’être misogyne, etc. celui qui dénonce a toujours là encore le beau rôle).
Bref, concernant les seuls « ennemis » politiques, transnationaux, après les communistes, c’était donc au tour des musulmans (radicaux donc, précise-t-on comme pour corriger ce qui ne peut l’être ou pour apporter de la nuance à ce qui est biaisé par essence), et si ce n’était eux, ç’aurait été les Chinois, les juifs ou les pizzas aux anchois.

un totem abattu
Le processus menant aux préjugés et à la peur d’un ennemi (d’abord) imaginaire est précisément naturel et… dans la majorité des situations, profitable. Les préjugés, ou les facilités de pensée, permettent, en général, d’avancer, de disposer d’une réponse immédiate à un dilemme ou à un danger. Une fois qu’on comprend, et accepte l’idée, que le préjugé est à la fois la norme dans notre esprit, mais aussi qu’il a son utilité, et qu’il est par conséquent une forme d’intelligence sommaire, on peut comprendre que ce même processus vienne à nous tromper dans des cas où elle (notre intelligence) doive composer avec les faux-semblants ou des dilemmes bien plus complexes. La tolérance est un exercice d’équilibriste, comme celui qui devrait nous forcer à la retenue, la prudence, le doute. Or l’esprit a besoin du confort qu’offrent les certitudes, les affirmations toutes faites, ou les idées simples. C’est bien pour nous réfugier dans la facilité qu’on érige des totems idéologiques. Parce qu’un totem dessine les contours d’un problème qui resterait flou autrement. À la manière d’un sophisme auquel on peut difficilement opposer autre chose qu’un autre sophisme pour le contredire, on ne peut parfois que dresser un totem contre un autre totem. La raison demande toujours plus de temps, de précision, moins de facilités, plus de doutes et d’efforts. La complexité ici, c’est bien qu’on puisse aussi nourrir le « monstre » qui s’oppose à nous quand on cherche à éviter les écueils de la facilité : car si on a souvent tort quand on choisit la facilité (surtout sur ces questions complexes de perception qu’on se fait d’un « ennemi »), on n’aura pas forcément raison quand on prend conscience de tous ces écueils et qu’on ne s’abrite pas dans l’ombre d’un totem. On remarquera toujours vos maladresses comme si elles devaient discréditer totalement votre démarche (sophisme) ; on vous suspectera toujours une « idéologie » non avouée que vos interlocuteurs tenteront de dévoiler en questionnant vos doutes et vos hésitations ; autrement on vous fera passer pour un naïf ou pour quelqu’un aux idées trop vagues pour être crédibles. Les totems sont des jalons qui permettent à ceux qui les utilisent de ne pas se perdre tout en restant dans l’erreur. Refuser de se voir conduire par eux non seulement vous oblige à une prudence de chaque instant, mais la suspicion que cela entraînera vous condamnera en même temps à une autre forme d’ostracisme. « Tu es avec nous ou avec eux, tu ne peux pas être entre les deux. » L’idée encore que le totem sert notre intégration dans le groupe et que le refus de se tourner vers lui, l’honorer, entraîne de fait une exclusion. Si les sociétés s’inventent des ennemis, c’est surtout parce qu’individuellement nous y avons tous intérêt. Avant l’inéluctable confrontation.
Le doute, la tempérance, la tolérance, ne sont pas des voix qui portent loin ; elles ne se relayent pas facilement parce que le discours qu’elle transmette est fait de nuances, de détours, voire d’hésitations, qui ne passent ni en 140 caractères, ni en punchlines. Le jeu des apparences est toujours gagnant. Certains ne s’y trumpent pas : dans un monde perçu comme une chasse permanente à l’intrus ou au faible, il n’y a que deux sortes d’individus, les gagnants et les perdants. Avoir un totem à soi, qu’on partage avec d’autres, c’est en fait, paradoxalement, être toujours vainqueur. Ceux qui naviguent péniblement entre les lignes jouent les équilibristes, et ceux-là ont bien du mérite. C’est pourtant ceux-là qu’il faudrait, parfois, écouter.

un totem abattu
Demandons-nous si ces totems ne nous protègent pas de nous-mêmes en nous imposant le confort des idées toutes faites, du politiquement correct. Parce que si les prêtres qu’on entend tout près des totems sont ceux-là mêmes qui nous gouvernent, et si ceux-là toujours profitent des facilités de discours pour avoir le beau rôle, c’est avant tout à chacun de faire l’effort de la nuance, de la tolérance et du doute. Cet effort, il semblerait que nous le faisons, mais peut-être pas encore suffisamment. Juste assez pour ne pas tomber dans la guerre civile.
Les totems idéologiques ne sont pas à abattre, ils doivent être ignorés. On ne se bat pas contre une idée, encore moins une idéologie, ni même ici contre un ennemi (le groupe État islamique, Al-Qaida…) opportuniste capable de commanditer et de s’approprier des actes terroristes perpétrés loin de leur base ; on se bat contre la bêtise, les idées reçues, l’amalgame (comme on dit), contre les malentendus ou les raccourcis, les biais et le manque de connaissance. Autrement dit, l’ennemi ne vient pas de l’extérieur, on le construit, et on le combat, à l’intérieur. Nous sommes notre propre ennemi. Les totems ne servent que de prétexte, d’illusion, pour ne pas nous poser les bonnes questions, et dans son ombre avoir la satisfaction et le confort d’avoir toujours raison, avec les autres, les « nôtres ».
Ces questions, cela devrait être aux hommes en charge de la politique, à ces représentants élus, de les poser. Trop souvent, c’est encore la facilité qu’on entend, qui passe, et qui prévaut quand on veut être audible, crédible et convaincant. Il y a trop de risques à lutter contre le vent et les apparences. Chaque nouvel incident, attaque terroriste, crime suspecté d’être « en lien avec », et c’est l’occasion pour proposer de nouvelles mesures censées gravir symboliquement ou non une nouvelle marche vers le tout sécuritaire, vers l’augmentation supposée des moyens, des niveaux de danger ou des mesures censées abattre le totem tant redouté. Ces affichages sont non seulement liberticides quand ils changent concrètement le droit, mais elles sont inefficaces d’une part pour identifier les véritables causes des tensions, mais par conséquent aussi pour commencer à chercher à les résoudre. Les facilités encore, celles des « mesures » prises, très utiles sur le court terme en matière de communication, et au détriment des intérêts du long terme. On ne cherche pas à résoudre un problème, on montre sa volonté (sa « fermeté ») à le résoudre.

un totem abattu
La première des facilités, c’est de réagir à chaque « attaque » par une « nouvelle mesure ». L’arsenal législatif (comme on dit) sert à protéger les citoyens à l’intérieur de la nation. Commencer à l’amender, c’est répondre comme en écho à la déflagration de l’attaque contre laquelle on prétend pourtant lutter. Amender en réponse à un ennemi désigné, c’est s’autoriser des règles d’exception, c’est céder à la terreur souhaitée par ces mêmes ennemis désignés, c’est créer le chaos, c’est échafauder les bases d’un totem qui sera bâti contre l’ennemi. La peur du « eux » contre l’harmonie du « nous ». Or, les incidents doivent rester des « incidents » ; des attaques ne sont pas des batailles ; il est dangereux de se faire l’écho de leur puissance en jouant sur la peur, la haine ou le mépris. Par définition, la réaction viendra toujours après ; si on veut agir, il faut identifier l’origine du problème et agir en conséquence.
Le problème est ni politique, ni religieux, il est social et psychologique.
Il y a des opportunistes qui se servent des incidents pour se placer au pied du totem et faire entendre leur voix. Et il y a des opportunistes qui trouvent sur le tard une cause censée légitimer une violence contenue en eux depuis des années. C’est contre cette violence qu’il faut lutter, pas contre ceux qui en sont victimes. Les attaques terroristes sont la face émergée d’un problème bien plus profond : la rencontre d’une haine ou d’une peur de l’étranger et d’un manque de repère identitaire. On pourrait parler aussi d’intégration, de ghetto. Et si des citoyens décident au nom d’une cause exotique de s’attaquer aux leurs, à leurs voisins, à ceux qui devraient être leurs semblables mais qui n’ont eu de cesse pourtant de lui montrer le contraire, et si ceux-là se rendent bien sûr coupables de crimes particulièrement odieux, il ne faut pas oublier que les origines de ce malaise ne sont pas à l’étranger mais bien chez nous. Ce n’est ni l’islam, ni les musulmans, les fautifs ; mais bien nous, la société dans son ensemble, incapable de résoudre la question de l’intégration des populations issues des anciennes colonies. La question que l’on doit se poser est celle-ci : peut-on être fier de se revendiquer comme arabe, noir, ou musulman aujourd’hui en France. Un homme qui voit une femme se revendiquer comme féministe, au pire il sera indifférent, au mieux il trouvera ça légitime et formidable ; un autre voyant une personne originaire d’Espagne ou d’Italie revendiquer ses racines trouvera là encore cela très bien. Un Noir, un Arabe, un musulman, se revendiquant comme tel, et on suspectera sa volonté réelle à s’intégrer, on le priera parfois même de retourner on ne sait où. Le problème ne vient pas de celui qui revendique une identité, mais de celui qui suspecte le degré d’implication de celui qui se revendique d’un autre groupe au groupe commun, national. Le problème ne vient pas des « migrants », mais de ceux qui refusent de les intégrer à leur monde. C’est cette suspicion, ce rejet permanent, qui sème le trouble, et qui plus encore est à l’origine d’inégalités, qui sont, elles, sources de frustrations légitimes.
« Si vous ne m’aimez pas, sachez que je ne vous aime pas non plus. » Si votre totem n’est pas le mien, j’irai m’en trouver un autre.
Qui est coupable ? Celui qui réagit à des années de frustration, ou celui qui n’agit pas pour regarder autrement celui qu’il se doit d’accepter dans son groupe au nom de la fraternité ?
Les meurtres de masses, les attentats, ont toujours existé. La question politique, voire religieuse, s’il y en a une, n’est qu’un prétexte. C’est contre la violence contenue et qui grandit par rejet de l’autre qu’il faut lutter. Pas une autre.
Attendre de l’État une réponse active et ferme, c’est accepter qu’on établisse des règles d’exception pour des événements qui ne bousculent en rien la vie de la société. Au contraire, c’est en faisant appliquer de nouveaux usages législatifs et policiers, en s’attaquant au mauvais ennemi (au totem d’en face) qu’on ajoute de l’agitation, de la confusion, de la tension à la société. C’est bien là l’objectif du « terrorisme » : faire céder son ennemi à la panique et à la terreur. On ne s’y prendrait pas autrement si on voulait augmenter un peu plus l’injustice, faire peser sur une population déjà stigmatisée encore plus le poids d’une culpabilité qui n’est pas la sienne, et par conséquent œuvrer à long terme pour toujours plus de tensions et de terrorisme. L’état d’urgence plonge la société dans un état où l’exception devient la règle. Le sentiment de persécution que pouvaient ressentir certaines de ces populations stigmatisées ne devient plus seulement un « sentiment » mais une réalité car les mesures d’exception servent justement à diminuer un peu plus leurs droits et leurs libertés. La persécution devient réelle. Action, réaction : en chassant les terroristes sans base légale et en plaçant la société dans une tension permanente, on crée des vocations et on multiplie les « loups solitaires » craints, qui, blessés, persécutés, chercheront à se venger de la société qui les rejette. C’est en fait une forme insidieuse de xénophobie : au lieu de dire ouvertement qu’on a peur et qu’on rejette l’autre, on dit vouloir s’attaquer à ses éléments perturbateurs. Mais au lieu de dire qu’on protège les siens, cela veut surtout dire qu’on estime que parmi les « nôtres », certains ne devraient pas en être, et que ceux-là méritent plus que les autres à être suspectés et encadrés. C’est cette xénophobie insidieuse qui ralentit la nécessaire « intégration ». Les traîtres ne sont pas du côté désigné, mais bien de ceux qui prétendent agir pour la sécurité intérieure. Ce sont eux les loups solitaires, les apprentis sorciers, les profiteurs de guerre, les agitateurs et les véritables terroristes. Ils pourront toujours s’abriter derrière les apparences, leurs bonnes volontés et leur totem.

un totem terrorisant à abattre
La première réponse au terrorisme, c’est d’arrêter de chercher à y répondre ostensiblement. C’est une affaire d’abord de renseignements quand les réseaux sont déjà actifs ou prêts à l’être, mais surtout, sur le long terme, une optimisation des moyens d’intégration et de réduction des injustices sociales ou ethniques. Il est urgent de dire « stop » à l’urgence sécuritaire. Ne jamais donner l’impression qu’on répond, car c’est précisément ce qu’attendent les commanditaires et qu’on grimpe un niveau supérieur dans l’échelle de la violence. Cessons enfin d’ériger des totems idéologiques les uns contre les autres. Le terrorisme est le symptôme d’une misère sociale, culturelle, identitaire et psychologique, non pas une « guerre » comme certains opportunistes, qui se rêvent probablement en « chef de guerre », voudraient le laisser croire.