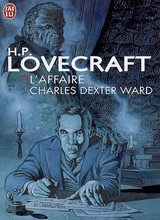À la recherche du temps perdu


À la recherche du temps perdu
Année : 1913-1927
Scénario : Marcel Proust
Un amour de Swann
Intelligence vertigineuse d’un mythomane hypermnésique livrant au lecteur toute nue la complexité des raisonnements et réflexions si détestables chez d’autres : le commentaire, l’explication… L’intelligence et la méticulosité sont si prégnantes chez Proust qu’on lui laisse passer ses défauts : son manque de clarté, son intérêt pour ce qui paraît à notre époque si futile, l’irréalisme de certaines situations ou leur faible valeur dramatique (l’épisode où Swann retourne chez Odette en craignant l’y trouver avec un autre homme et voir Proust en faire des tonnes quand vient à Swann le moment de décider ou non de taper au volet de sa belle, le tout pour se rendre compte qu’il s’est trompé de fenêtre… c’est tout de même assez révélateur du style de Proust). À l’image du Miroir de Tarko (ou le contraire), il y a quelque chose dans ce récit qui tient à la fois de l’inceste, de l’impossible et de l’amusement à arriver à se projeter ainsi aussi facilement (ou facticement) dans la vie intime, les pensées même, du père de son premier amour. Le gros du premier volume est ainsi uniquement dédié à l’amour de ce père fantasmé avec une cocotte, et il repart ensuite en reprenant tout son récit à la première personne comme si de rien n’était. Vertigineux toujours, et pour le moins embarrassant, au point qu’on puisse comprendre que s’il y a une bonne part d’expérience personnelle là-dedans, que Proust ait préféré évoquer et inventer un monde parallèle allant même jusqu’à créer des lieux où des personnages historiques qui n’existent pas… Je crains un peu pour la suite, depuis vingt ans, je tourne autour de Proust, mais j’avais bien compris instinctivement que, comme Proust avec sa mère à l’heure du coucher, je ne voudrais jamais quitter Combray. Cette première partie m’avait tellement fascinée il y a vingt ans que je m’étais endormi à la première entrée en scène de Swann…
À l’ombre des jeunes filles en fleurs
J’ai du mal à comprendre comment on peut être aussi précautionneux dans la description de la psychologie des sentiments et en savoir si peu sur les personnages rencontrés. C’était déjà le cas avec Swann, mais avec Gilberte, c’est encore pire : on ne sait rien d’elle, et même sur le jeune narrateur, on ne sait finalement rien à part ces allées et venues incessantes sur la nature de son amour et de sa relation avec Gilberte ; c’est aussi à travers les actions et les décisions qu’on se définit, pas simplement à travers l’étude (réflexions, interrogations, commentaires et comparaisons) qui se veut faussement minutieuse à force de répétitions des sentiments. On ne retrouve en fait rien des artifices géniaux narratifs du premier tome de la Recherche, pire, à certains moments le récit tourne à la description mondaine fatigante. Dans ce premier tome, le décor, l’espace, les objets, donnaient au récit une couleur qui enrichissait le thème de la mémoire : or, c’est beaucoup moins le cas ici, c’est tristement moins visuel, moins sensoriel.
Balbec rehausse l’intérêt de la première partie, on sent peut-être ce lien qu’en fera Visconti avec Mort à Venise (images d’illustration). Celle qui décrit le mieux le style, et donc le caractère de ce petit chou de Proust, c’est encore sa grande mère : « Mais quand même elle se contenterait d’un grattement on reconnaîtrait tout de suite sa petite souris, surtout quand elle est aussi unique et à plaindre que la mienne. Je l’entendais déjà depuis un moment qui hésitait, qui se remuait dans le lit, qui faisait tous ses manèges… »
Du côté de Guermantes
Le triomphe de la mondanité. Proust me perd. Rare moment réellement intéressant et dramatique de ce pavé de bonne famille : la mort de la grand-mère. Si le petit Marcel, devenu grand et con, continue le récit de son ascension dans les salons à la mode, je vais avoir du mal à le suivre jusqu’au Temps retrouvé.
Sodome et Gomorrhe.
Et on y retourne. Comme d’habitude, des mondanités pas très intéressantes, des interrogations, elles, qui le sont déjà plus, sur l’homosexualité (même si Proust se cache derrière son petit doigt et préfère minauder en lui racontant ses pensées intimes), un retour bienvenu mais trop court sur les souvenirs tendres du temps passé à glander à Balbec auprès de sa grand-mère. Parce que c’est ce qu’il y a de plus beau chez Proust… le recours trop rare à mon goût du souvenir nostalgique des êtres qui lui sont chers. Dès que Proust replonge dans un récit chronologique et flou de sa vie pleine de vide (il prend soin de ne jamais rappeler son âge comme s’il s’effaçait le plus possible derrière ses sensations et les sujets mondains de sa “vie”), c’est mortellement ennuyeux ; tout Proust en fait se trouve condensé dans ces passages où il hume le déploiement de ses sens et où il se remémore, et se revoit même en train de se replonger ainsi dans ses impressions passées ou ses souvenirs. Dommage ma petite souris que tu te perdes tant dans les mondanités.
La Prisonnière
C’est devenu une telle habitude, de m’assoupir pendant les longs passages chez les Verdurin, que j’en suis à un point où pour m’endormir, je récite le nom des personnages les plus chiants de la Recherche. Les passages avec Albertine, seuls, sont pourtant de véritables petits chefs-d’œuvre.
… Madame et Monsieur Verdurin, la duchesse de Guermantes, tous les Guermantes, Morel, Cottard, Madame de “Camembert”, Norpois, Saniette, Ski, le Prince von, le premier président, le lift et le chasseur, la princesse de Parme, Albertine (prisonnière), maman… et Marcel !
Proust utilise peu la troisième personne du singulier ou du pluriel. Ici, brièvement, il l’utilise avec le couple Verdurin, mais il l’utilise aussi dans un passage avec Charlus, un peu comme il l’avait fait avec Swann dans le premier roman. Le signe peut-être que Charlus et Swann sont deux identités fantasmées de Proust ou un mélange de souvenirs personnels et de vie fantasmée (beaucoup fantasmée pour Swann, car il y aurait un modèle indiscutable, peut-être dans ce cas le modèle que Proust aurait voulu être).
Proust champion des plantings. Celui de l’épisode de la fille Vinteuil pour suggérer l’homosexualité d’Albertine donne le tournis. Mais globalement, tous les leitmotivs sont des refrains rythmant le récit sur des milliers de pages et qui donnent cette saveur si particulière à la Recherche. J’avoue parfois m’assoupir, et la réapparition de ces thèmes récurrents, ça fait un peu l’effet de notre nom prononcé alors qu’on commence à sombrer… « Hum ? Non, non, je dors pas, je réfléchis. »
Albertine disparue
Donc Albertine meurt et tout ce qui intéresse Marcel pendant 300 pages, c’est de savoir si elle était homosexuelle. Albertine meurt et yolo, je vais enfin pouvoir mener l’enquête. Je t’adore Marcel, pendant que tu t’interroges, au moins, on échappe à toutes les mondanités pour ce coup-ci.
Le Temps retrouvé
Étonnante plongée dans la Première Guerre mondiale. Proust qui, d’habitude, concentre tout son récit sur les commentaires du narrateur avec peu d’évocations contextuelles, ici place précisément ce récit au milieu de la Guerre mondiale avec de réelles mises en situation. Notamment lors de ces séquences avec le baron de Charlus et sa maison de passes ; d’un coup, on se retrouve projeté dans Voyage au bout de la nuit, voire dans Salo et les 120 jours de Sodome, et c’est amusant de voir, et de comparer, à quel point Céline fera presque le voyage inverse de Proust en revenant sur son enfance dans Mort à crédit avec un style toujours, chez lui, basé sur les situations, au contraire de Proust, mais avec une même préciosité dans le style, dans la langue, et qui apparaît ici chez Proust par intermittence avec la même préciosité argotique. (Il arrive que certains extrêmes trouvent un terrain d’entente…)
Waouh ce début du chapitre 3 ! Une sorte de réminiscence ou une redite du début de la Recherche et du chapitre de Combray et de la madeleine, cette fois avec des souvenirs de la place Saint-Marc rappelés dans l’esprit du narrateur par le biais de pavés inégaux. Impressionnant. Si Marcel avait pu soustraire toute mondanité, voire tous les personnages antipathiques de son récit, ne garder que ces réminiscences introspectives, en fait s’il avait pu rester dans sa chambre, ne jamais sortir de chez lui, ne voir personne et imaginer des voyages, des personnages, qui chacun le ramènerait à une portion d’un passé lui-même fantasmé, là oui, ça aurait été encore plus magique. Mais je suis dur, il y a assez dans toute la Recherche d’introspections alambiquées et poétiques (oui, tu es bien un poète, Marcel) pour suffire à mon bonheur.
On dit de certaines personnes qu’elles s’écoutent parler, et ce n’est en général pas un compliment, mais chez Proust, on peut dire qu’il se regarde écrire, et ma foi, c’est assez fascinant : les toutes dernières pages de la Recherche sont en cela assez fantastiques, jouissives. Le narrateur, qui s’est toujours rêvé auteur, double de Proust, qui se dit qu’il serait temps de devenir cet écrivain qu’il a toujours rêvé d’être et qu’il a peur de ne plus être capable de devenir à l’orée de la mort, même accidentelle. Toujours dans une sorte de mise en abîme introspective, il (le narrateur) se sait avoir accumulé d’innombrables idées au cours de sa vie (parfois mondaine), se voit comme une mine dont lui seul serait capable d’exploiter les ressources, et qu’il serait dommage par conséquent de ne pas les exploiter… Touchant et beau. Après mille écarts mondains, la petite souris retourne dans son nid. Le temps retrouvé.