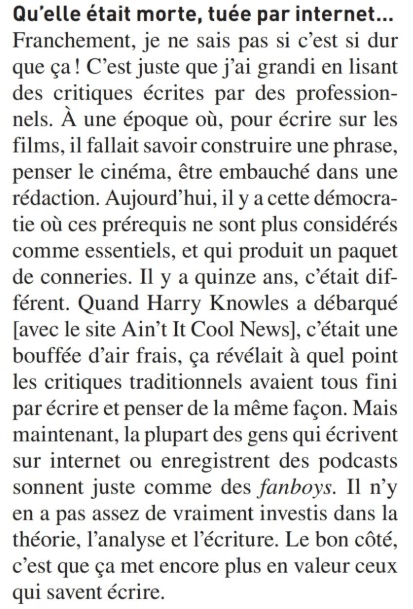La vidéo :
Plusieurs choses. D’abord, le format biographique d’une personnalité du cinéma sur une chaîne majoritairement dédiée à la vulgarisation scientifique, c’est bien et c’est passionnant. Après, pour qui aime le cinéma (genre… tout le monde ?), Roger Corman n’est pas un inconnu.
Ensuite, il y a une sorte de méprise assez commune dans la vidéo qui consiste à penser que Hollywood a commencé avec Star Wars ou Le Parrain. Invisibiliser ainsi l’âge d’or du cinéma hollywoodien est assez cocasse. Si l’on parle de Nouvel Hollywood dans les années 60 (courant auquel Corman a pas mal œuvré), c’est parce qu’il y avait… ce qu’on appelle aujourd’hui un « old Hollywood ». Hollywood est une usine à rêve depuis le milieu des années… 10. Les grands studios à l’époque sont à peine constitués, et la production américaine est largement concurrencée par les studios scandinaves, allemands et français. Puis, dès les années 20, Hollywood dévore tout.
Je suis loin d’être un grand connaisseur du bonhomme, mais il convient de bien placer le contexte de l’époque, sinon, on regarde l’histoire à travers un entonnoir. Ce à quoi Corman a participé, avec bien d’autres, c’est à une sorte de renaissance du cinéma américain qui croupissait dans le n’importe quoi dans les années 60. Hollywood est alors au bord de la faillite et il est largement concurrencé par les productions européennes animées par diverses « nouvelles vagues ». Corman a donc participé, comme des milliers d’autres, à la renaissance du cinéma américain, à travers un mode de production beaucoup plus simple et direct. Quand une production périclite, il est assez logique qu’elle finisse par se tourner vers des productions underground. Corman restait dans le bricolage et le film de genre, sauf pour son chef-d’œuvre (« pas mal » ? commente le vidéaste…), The Intruder. Cet élan de production nouvelle inspiré de ce qu’il se faisait en Europe n’avait déjà plus rien à voir avec Corman.
Corman a mis le pied à l’étriller, oui, de beaucoup de futurs talents parce qu’il était au cœur de ce cinéma underground venu à la rescousse de Hollywood. Mais ses films à lui, en dehors du film précité, c’est des films de genre, des séries B, très bof. C’est bien de l’honorer ; en faire un type qui a révolutionné Hollywood me paraît pour le moins audacieux. Il a été un facilitateur, ce qui est déjà pas mal. En revanche, je ne connaissais pas son côté distributeur, mais en faire là encore un jalon sans lequel des pans entiers de l’histoire du cinéma n’aurait pas été accessible me paraît plutôt présomptueux…
Au passage, joli tacle adressé à William Shatner. C’est un grand acteur. Avant de jouer dans vous savez quoi, il a une carrière à Hollywood tout à fait respectable. The Intruder est un chef-d’œuvre indépendant, mais avant ça, par exemple, il a joué dans un autre grand film : Les Frères Karamazov de Richard Brooks (100 % Hollywood). Taper gratuitement sur un acteur de télévision quand on loue par ailleurs le génie de bricoleur de Corman, ce n’est pas de la plus grande classe.
Effet entonnoir toujours : Hollywood, c’est un pôle industriel, un pôle d’excellence. Il est donc plutôt normal de retrouver les personnes du même milieu en marge, underground, travailler ensemble, avant, éventuellement de devenir plus connus (une fois que les studios ont décidé de donner les clés à la nouvelle génération… parce que sinon, clé sous la porte).
Je prends un autre exemple pour être plus clair : au début du cinéma parlant, les studios se tournent vers Broadway pour trouver de nouveaux acteurs. Si vous regardez les castings des pièces des années 20 à Broadway, vous trouverez quelques futures stars de la côte ouest (et beaucoup d’acteurs britanniques, très utiles dans les productions de films d’époque, et pas seulement). Le Nouvel Hollywood, c’est pareil. Quand les studios se rendent à l’évidence qu’il faut laisser la main aux jeunes créateurs du cinéma underground, ils se tournent vers les mêmes personnes… Ils se seraient, je sais pas, tournés vers la scène de Chicago, ç’aurait eu la même conséquence. Cet effet entonnoir qui consiste à regarder l’histoire à travers un unique prisme a fâcheusement tendance à laisser penser que tout est lié. Et en fait, probablement pas tant que ça : vous pouvez citer presque autant de personnalités de l’époque issues d’autres milieux. Biais, quand tu me tiens.
Le vidéaste souligne que George Lucas est avant tout un producteur. Eh bien, oui et non. S’il a effectivement dans les années 80 largement laissé son travail de producteur prendre le pas sur le reste, c’est loin d’être un rigolo dans les autres secteurs de la création. Cette manière de valoriser d’un côté le travail et l’influence de Corman pour diminuer celui d’un autre sans doute plus connu, ça ressemble un peu à un procès en popularité. Parce que George Lucas a une formation de monteur, et il est assez habile dans le domaine. En la matière, perso, je pense que c’est un génie. Il suffit de voir ce qu’il fait avec THX qui est quasiment un film muet. Il ne faudrait pas non plus dénigrer ses talents de scénariste et de metteur en scène. Mais taper sur l’auteur des Ewoks et ne pas être ébloui par un style de réalisation devenu très classique après l’échec de THX, c’était une pique à laquelle il est difficile de renoncer.
Le vidéaste nous fait ensuite la leçon quant à la prononciation de « Peter Lorre ». Notons juste que c’est un pseudonyme. Imaginer qu’il ait été inventé pour faire « américain » n’est pas idiot en soi à l’époque ; et préférer le prononcer à « l’américaine » compte tenu de sa carrière à Hollywood ne me semble pas moins aventureux que de tenir à le prononcer « à l’allemande ». Autrement, moi je le prononce à la française… Un peu comme… Alfred Itchcoq. (Mais il y a bien des puristes qui par hypercorrection disent « scenarii », alors…) Et vous, comment vous prononcez Richard Gere et Nike ?
Dernière chose. The Gunfighter est cité comme s’il était question d’une vulgaire série B. Compréhensible quand on ignore autant l’âge d’or d’Hollywood. Bref, c’est évidemment un classique, Monsieur Durendal. On peut même dire que c’est un chef-d’œuvre. Et il a un titre français, La Cible humaine.
Je comprends que faire de l’histoire, c’est aussi beaucoup revoir les événements du passé à travers un prisme contemporain, mais je suis loin d’être fan de cette manière de parcourir le passé principalement pour en trouver des correspondances que l’on croit évidentes avec l’époque contemporaine (cf. Fast and Furious).
L’entonnoir est dur à avaler.
Reste que parler d’histoire du cinéma (même mal) pour une chaîne à un million d’abonnés, c’est pas anodin. Il faut continuer.
The Intruder, Roger Corman 1962 | Los Altos Productions