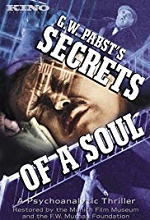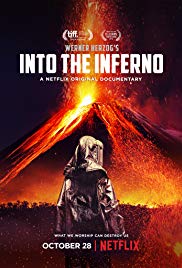ou la rencontre improbable entre la tenante de la « science folle » (historienne du cinéma amoureuse de Freud) et le réalisateur amateur qui tel Monsieur Jourdain fait du cinématographe sans le savoir
Commentaire, donc, suite à la vision de la table ronde « Les films qui disent la VERITE ».
La vidéo :
Rencontre étonnante et improbable de deux mondes rarement appelés à se rencontrer. Il y a quelque chose d’assez truculent à voir jaillir tout d’un coup la croyance d’une intervenante en une pseudoscience dans une conférence dédiée aux dérives de la désinformation. Ou comment foutre un gros malaise au détour d’un commentaire que l’on croit anodin et qui met presque en perspective l’idée d’emprise mentale propre aux dérives sectaires. C’est aussi d’un côté une sorte de Madame Jourdain qui applique sans le savoir les méthodes des pseudosciences et de l’autre un Monsieur Jourdain, s’amusant avec une caméra pour moquer les codes des faux documentaires, et à qui on dit qu’il est cinéaste. « Par ma foi, il y a plus de quarante ans que je fais du cinéma sans que j’en susse rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m’avoir appris cela. »
Pour illustrer le sujet de la table ronde, un documentaire contenant des passages parodiques des documentaires complotistes réalisé par l’équipe de la Tronche en biais est donc présenté. Après le film et quelques minutes d’échanges, de manière quasi anodine, Ania Szczepanska (historienne du cinéma, maîtresse de conférences et visiblement spécialiste des documentaires du monde de l’Est) questionne le choix jugé problématique de mêler tout à coup vrai et faux* en prenant comme exemple le discours d’un des intervenants expliquant qu’il avait commencé à déconstruire ses propres croyances quand il a douté de la psychanalyse. Idée qui semble bien saugrenue à notre universitaire, troublée que l’on puisse considérer la psychanalyse comme une pratique à laquelle il faudrait se détourner. Un échange un peu surréaliste commence alors avec Alexis Seydoux (vice-président de l’Association de Lutte contre la Désinformation en Histoire, Histoire de l’art et Archéologie) et Thomas C. Durand (« réalisateur » du film en question, créateur de la chaîne La Tronche en Biais et membre de l’Association pour la Science et la Transmission de l’Esprit Critique).
*Le documentaire est pourtant assez clair. Il reproduit plus ou moins les codes des documentaires de télévision (plus rarement de cinéma) dans lesquels divers experts sont amenés à être interrogés sur un sujet spécifique. Et pour illustrer la crédulité des spectateurs à croire en des théories alternatives, le film est ponctué par des séquences censées, elles, reprendre les codes des faux documentaires (c’est une parodie, une exagération, la part documenteur du documentaire). Les intentions du film sont clairement définies en présentation, puis rappelées en guise de conclusion, face caméra. Ce n’est pas un film d’art, mais bien en document à visée éducative : les auteurs du film partagent les orientations des experts sélectionnés, mais le discours est bien celui des experts, et en dehors des impératifs du montage qui par essence ne peut produire l’intégralité d’un discours, on peut difficilement suspecter une intention de travestir leurs propos ou une volonté d’en tirer un discours propre. Aucun sens caché, donc, à chercher derrière les effets produits, les choix de mise en scène, les cadrages, etc. Le film est à voir ici.
Thomas Durand semble totalement décontenancé par la défense d’une pratique dont il s’applique depuis des années à relever le caractère non scientifique et qu’il ne pensait sans doute pas trouver ainsi aussi bien défendue lors d’une conférence dédiée à la désinformation. L’autre intervenant semble moins surpris, peut-être plus habitué à voir des tenants de la psychanalyse dans les cercles universitaires. Aidée par quelques étudiants outrés dans la salle, Ania Szczepanska vient alors à questionner le travail de Thomas Durand sur le film et la pertinence de choisir son film pour introduire la table ronde. Le Youtubeur se trouve alors sommé de justifier ses choix de mise en scène (sic), et le voilà, expliquant un peu incrédule qu’il n’est pas professionnel du cinéma, que les sujets ou les intentions qu’on lui prête en tant que réalisateur ne sont pas les siennes. On lui rétorque qu’en tant que réalisateur, son devoir serait d’être conscient des effets qu’il produit… Il aura beau expliquer, tel un lapin aux yeux ahuris qui ne comprend pas ce qu’il se passe quand une voiture lui fonce dessus, qu’il n’est question que d’une… parodie, d’un film qui ne se prend pas au sérieux et qu’il n’a aucune prétention « artistique », le malentendu est consommé. Deux mondes ne parlant pas la même langue se rencontrent et ce n’est pas beau à voir.
Une réalisatrice de films documentaires pour le service public vient un peu à la rescousse du vulgarisateur cueilli par les critiques déplacées dont il fait l’objet, mais le mal est fait si on peut dire, et ces interventions lunaires de « sachants » montrent à quel point, encore, le monde universitaire est gangrené par une logique interprétative des œuvres qui se voudrait objective alors que c’est impossible. Tous les ingrédients des déviances que l’on pourrait retrouver dans la psychanalyse.
Quand je vois que ce petit monde est encore autant imprégné par cette idée que l’étude d’un film se fait uniquement à travers les signes, les symboles ou les intentions révélés de ceux qui font les films, interrogeant perpétuellement l’auteur et non le film même, s’interdisant d’accepter l’idée que leurs interprétations ne puissent être que purement spéculatives, le plus souvent sans aucun rapport avec les intentions parfois exprimées des cinéastes, je me dis qu’il y aurait encore pas mal de travail à faire pour « débunker » ces dérives au sein de ce milieu. J’en parle souvent ici, mais ce discours hautement interprétatif qui baigne aussi tout le milieu critique du cinéma pose un véritable problème tant il est envahissant, voire exclusif quand il est question d’analyser ou de parler des films. C’est ce qui arrive quand on ne maîtrise aucune technique de l’art qu’on commente, qu’on refuse obstinément de se placer à la même hauteur que n’importe quel spectateur, et que pour légitimer son droit à présumer des intentions d’un auteur, du message d’un film ou de la nature universelle des effets produits, on en vient à développer toute une « science » ne reposant sur rien. La ressemblance avec la psychanalyse est ironiquement… troublante. Pas mieux qu’une conférence où l’on se fait rencontrer deux mondes pour parler de désinformation pour mettre en lumière l’absurdité de cette « science folle » que peut parfois être l’exégèse cinématographique. (Je dis bien « parfois », car les universitaires ou les critiques, quand ils en viennent à analyser l’esthétique d’un film, sa forme, ses techniques, peuvent au moins faire reposer leurs commentaires sur des éléments concrets, lesquels peuvent ainsi être réfutés ou questionnés. Mais comment réfuter quelqu’un qui prétend étudier les « signes », les intentions ou le message d’un film oubliant qu’une œuvre d’art n’est pas un discours ? Et cela, encore plus quand il est question d’un documentaire de forme télévisuelle où le discours s’attache à reproduire au plus près à celui des experts : pas de voix off, pas d’effets de mise en scène, une structure à l’arrache et des intentions clairement définies qu’on peut difficilement suspecter de chercher à faire dire autre chose de ce qui est montré à travers un montage ou une mise en scène prétendument porteuse de sens forcément caché…)
On n’aura jamais aussi bien démontré, à travers une simple rencontre que l’on pensait anodine, en quoi certaines méthodes d’analyse des films dans le milieu universitaire et critique ressemblent à celles utilisées par la psychanalyse. Il serait temps que le milieu « critique » du cinéma procède à une évaluation de ses propres méthodes. Ce qui reste hautement improbable : comme dans n’importe quel milieu de ce type, faire la critique de ceux qui vous précèdent, c’est s’en exclure automatiquement. Seuls ceux qui obéissent au dogme, en acceptent les règles de l’entre-soi peuvent prétendre à en faire quelques critiques. Mais elles ne viendront jamais bousculer les principes qui reposent sur du flan : faire de l’auteur l’élément central d’un film (et non le film lui-même, voire celui qui le regarde, voire le contexte dans lequel il a été produit) et axer toute son analyse sur ce que celui-ci aurait « voulu dire ». Une fois qu’on a décidé que l’art avait toujours un discours, même caché, la partie est finie. Et pour justifier cette erreur (ou cette prétention) initiale, tous les instruments que l’on déploie pour appuyer ses prétendues analyses n’ont plus aucun sens. Et dès lors, ironiquement ou perversement, les critiques venant seules de l’intérieur finiront par créer… de nouvelles obédiences, avec de nouvelles propositions d’interprétation, mais avec jamais aucune remise en question du fondement infondé sur lequel repose tout cet univers. En psychanalyse, on voit alors Jung, puis plus tard Lacan débarquer. Mais ça reste les mêmes balivernes. Nul doute que l’on connaît les mêmes querelles de chapelle dans le milieu de l’analyse filmique.
L’incapacité à sortir de cette logique interprétative expose ceux qui en sont esclaves à sortir des âneries qu’une personne extérieure décèlerait tout de suite (voire à se protéger mutuellement, comme dans toute logique sectaire). On le voit par exemple ici. L’universitaire et les étudiants mélangent les différentes formes de « documenteurs » en ignorant, volontairement ou non, qu’il y a tout simplement des films qui ont vocation à tromper (s’il est question de parler des intentions des auteurs, ça la fout mal) et qui sont l’œuvre de charlatans ou de manipulateurs, et des films qui ont vocation à tromper pour parodier ou pour mettre en garde contre la crédulité du spectateur. En principe, un documenteur, c’est un film qui ne ment pas sur ses « intentions » : il fait du documentaire, il use des outils et des codes du documentaire, mais n’affirme pas que ce qui est présenté dans le film est vrai. Le film d’un charlatan a au contraire vocation à révéler des réalités cachées et prétend donc être dans « le vrai » (sans l’être). Pas étonnant, remarque, que des tenants de la psychanalyse aient quelques problèmes pour distinguer « pseudo ou faux documentaire » et « documenteur », tant leur perception du vrai et du faux pose problème… Ça interroge aussi leur capacité à comprendre les « intentions » des auteurs alors que c’est le cœur de leur travail et alors même qu’ils sont incapables de distinguer les intentions implicites d’un documenteur et celles d’un documentaire réalisé par un escroc.
Il y a également une confusion entre documentaire et films de propagande quand il est question des films d’Eisenstein : il faut que l’autre universitaire lui rappelle que le cinéaste soviétique réalisait des… fictions. Quand on en arrive à ce niveau de confusion, c’est qu’on a beau déployer tous les efforts pour construire un discours cohérent, tout ne sera jamais qu’illusion et prétentions. Triste monde, et tristes étudiants condamnés à errer toute leur vie dans les limbes d’un univers parallèle qui ne les connectera jamais au monde réel. Une secte, en somme. Belle ironie quand on voit le sujet du jour.
Table ronde & débat organisé à l’Institut National d’Histoire de l’Art (Les films qui disent la VERITE)