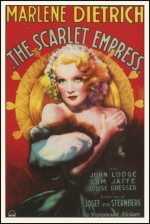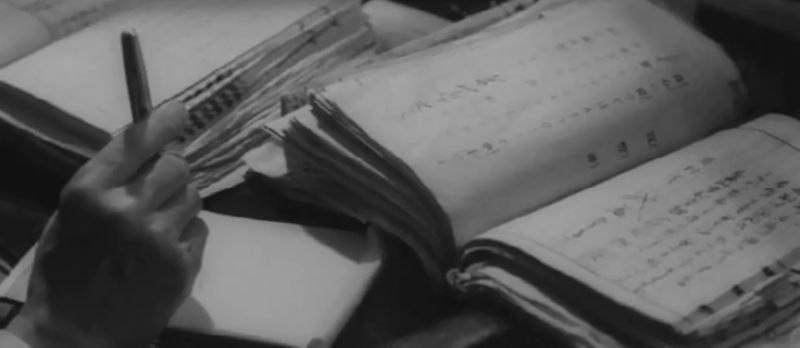Vaudeville martial

Lady kung-fu
Titres originaux : My Young Auntie/Zhang bei
Année : 1981
Réalisation : Liu Chia-liang
Avec : Liu Chia-liang, Kara Hui, Hou Hsiao
— TOP FILMS —
Quel régal… Je me répète, j’ai un faible pour les genres à la croisée des chemins, pour les prises de risque stylistiques, ou pour le simple goût du baroque (au sens premier du terme presque, quand divers genres ou thématiques peuvent cohabiter sans problèmes dans un même univers). Dans ce contexte, la dernière fois que je me suis autant régalé, c’est sans doute avec Pékin Opera Blues et Swing Kids. L’alliance du burlesque, de la screwball (où les femmes imposent leur présence ; or, ici, on frôle la comédie de remariage) et de la chorégraphie (qu’elle soit exécutée à travers un art martial comme ici ou à travers la danse comme dans Swing Kids) fonctionne pour mon plus grand plaisir.
Notons un dénominateur commun à ces films « d’humour baroque » ou de fantasme assouvi de « théâtre total » : la parfaite mise à distance avec l’impératif narratif que l’on connaît sous le terme de « suspension volontaire de l’incrédulité ». Le burlesque (qui tient ça des apartés de la commedia dell’arte) peut s’autoriser une plus grande mise à distance avec ce principe de vraisemblance et d’immersion dans le récit. C’est même souvent cette mise à distance qui provoque l’étrangeté et le rire. On dit que dans un vaudeville mieux vaut laisser le spectateur recevoir les répliques débordantes de reparties qui s’enchaînent à une allure soutenue, à défaut de quoi il peut finir noyé par le trop-plein de bons mots ou de situations hilarantes qui montent crescendo. Ce principe se retrouve dans les autres types de comédies quand elles sont réussies : la mise à distance se produit sur différents tableaux. On accorde le temps par des ruptures de rythme, et presque par de brèves mises en pause, pour que le spectateur digère, assimile et profite des effets à travers une forme de contentement de son propre rire. Il faut un certain talent pour savoir se détacher d’une situation pour ne jamais donner l’air de se prendre au sérieux et, au contraire, pour provoquer une connivence avec le spectateur. Cette mise à distance produit paradoxalement un rapprochement vers le spectateur (principe de l’aparté).
Ce n’est pas tout de ne pas se prendre au sérieux. Si du scénariste aux figurants, tout le monde doit être sur la même longueur d’onde, il faut aussi trouver le ton idéal qui suggère au spectateur que les acteurs (essentiellement) s’amusent comme des fous sur le plateau. Une réussite à mettre sans doute au crédit de Liu Chia-liang. C’était déjà la marque de son précédent film projeté dans le cadre de cette rétrospective sur le kung-fu à la Shaw Brothers : Le Singe fou du kung-fu. Si l’on reconnaît cette tonalité pince-sans-rire et généreusement facétieuse chez Liu (acteur), on se doute que c’est bien grâce à sa virtuosité à diriger ses interprètes autrement que par les chorégraphies que tous s’accordent pour proposer une même vision à base d’autodérision. Tous suivent une partition identique et renoncent à cette logique de vraisemblance stricte au profit d’un apparent « plaisir de jouer », d’un détachement ironique constant (œil qui frise, fantaisie) et de l’abandon pur et simple de toute psychologie.
La principale réussite de ce tour de force burlesque, c’est d’avoir mis au centre de cet humour une femme (ce sera le cas également dans Pékin Opera Blues). Derrière la volonté de Liu d’imposer Kara Hui, peut-être est-ce l’influence directe (ou une influence à trois bandes) de La Guerre des étoiles qui se fait ressentir : le film de Lucas venait tout juste de remettre au goût du jour la dérision typique des années 30 à Hollywood. Les incarnations féminines (et l’humour) faisaient défaut par exemple aux Cinq Venins mortels ; beaucoup de ces films d’action ou de comédies hongkongais réduisaient les rôles de personnages féminins à des héroïnes potiches quand ils n’étaient pas simplement absents. Lorsque l’on songe que l’emploi de Liu serait plutôt celui du père sage et un peu lunaire, toujours bienveillant, et que celui d’Hou Hsiao serait celui du fils exubérant, il manque en tout état de cause une figure qui représente un « yang » dominant dans cette jolie affaire familiale. Et c’est donc à une femme qu’incombe cette fonction de cheffe indiscutée. Dans une farce, cet inversement des valeurs et des stéréotypes est du pain béni. Véritable matamore au féminin, ce rôle central qui tient son petit-neveu par le bout du nez et qui tient en respect son aîné grâce à son caractère inflexible n’est pas pour autant épargné par l’esbroufe grotesque et la défiance puérile renvoyant à la réalité de sa jeunesse. Comme les deux autres, son personnage demeure ridicule, mais savoureux parce que ses intentions sont nobles et son talent martial authentique malgré ses fanfaronnades. On rit de ce trio comme on rit d’un enfant qui jouerait à botter les fesses de méchants imaginaires avec un bâton de fortune et qui finirait à terre.

On remarque donc d’un côté une connivence de rupture (avec le spectateur), et de l’autre, la connivence d’une fausse opposition entre deux personnages. Celui qu’interprète Kara Hui est censé être la tante, on comprend pourtant qu’un jeu de séduction se met vite en place entre elle et le fils de son « neveu ». La première rencontre est basée sur un quiproquo (nouvel héritage de la commedia dell’arte). La relation repose ensuite sur une confrontation joyeuse qui ne trompe personne : les deux personnages surjouent la concurrence pour cacher leur attirance mutuelle, et cette concurrence qui passe par le kung-fu fait un peu ici office de parade nuptiale. Les coups pleuvent, mais dans tous les sens du terme, cela reste du cinéma. Leur connivence est implicite, et le spectateur participe, amusé, à ce petit jeu de faux-semblants en ne pouvant être dupe de la nature « réelle » de cette confrontation.
Quand dans un film d’action les enjeux purement dramatiques reposent relativement toujours sur des schémas éprouvés, le défi consiste alors à porter un regard original sur les autres éléments du récit. Dans une comédie, cela passe encore une fois par une forme de mise en distance. Ainsi, dans My Young Auntie, lors des face-à-face avec l’ennemi, s’en joue un autre, cette fois entre la tante et le fils pour savoir qui mène aux poings. Il nous faut ainsi répondre à cette question infantile de première importance : qui possède le meilleur kung-fu entre les deux tourtereaux. Ou qui « a la plus grosse… » (Là encore, il s’agit d’un type d’écart — d’un pas de côté —, d’une dérision, déjà présente dans La Guerre des étoiles.)
Après l’humour restent les chorégraphies phénoménales de Liu, exécutées à une vitesse folle et pleines de trouvailles amusantes. Mais s’il fallait déterminer un vainqueur à ce mariage réussi, ma préférence irait définitivement à l’humour. J’adore les cabrioles spectaculaires et mixtes, mais en termes de farce et d’autodérision, on se demande parfois ce qu’on regarde (sinon un vaudeville à la sauce cantonaise) ; les audaces sont nombreuses, et Liu semble ne rien se refuser.
Communément, la comédie naît des travestissements ou des chocs de cultures. Précisons que le récit se déroule au début du XXe siècle dans la Chine profonde, que le fils revient de Hongkong (où il étudie) avec une savoureuse manie à tout tourner ridiculement à « l’américaine », et que la tante est au contraire une fille de la campagne qui découvre les bonheurs (et le bon goût) vestimentaires de l’Occident : assez pour comprendre qu’on dispose là d’une matière explosive idéale pour la farce. De Molière à Goldoni, de Feydeau à Billy Wilder, jusque dans la screwball comedy et au-delà, il est souvent question de travestissement, de déguisement, de dépassement des classes sociales, de mariage à faire (ou à déjouer) et de « voyage en terres inconnues ». On force le trait beaucoup, mais puisque la caricature s’accomplit avec détachement, et qu’on s’amuse, tout est permis. En tant que spectateur, on met bien volontiers de côté la suspension d’incrédulité parce qu’on voit bien que rien n’est réel et que la finalité est de divertir (en allant au bout dans la logique absurde de départ). On retrouve là le même nonsense que dans la screwball, la même opposition de sexe factice que dans la screwball (en guise de séduction masquée, de comédie de remariage et de parade nuptiale), les mêmes images arrêtées loufoques en rupture avec les stéréotypes que dans la screwball, les mêmes travestissements (ici aussi bien culturels, avec des Chinois qui imitent les Occidentaux, que régionaux ou sociétaux, avec la fille de la campagne mariée avec un riche propriétaire bientôt confrontée à la « modernité » du monde) que dans la screwball.
Un bonheur.
My Young Auntie/Lady kung fu, Liu Chia-liang (1981) | Shaw Brothers
Sur La Saveur des goûts amers :
— TOP FILMS —
Liens externes :