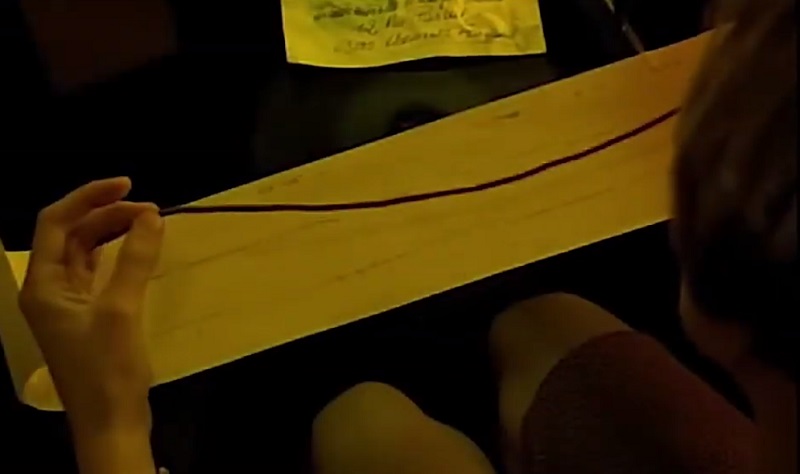Tagada Christie

Cinq Cartes à abattre

Titre original : 5 Card Stud
Année : 1968
Réalisation : Henry Hathaway
Avec : Dean Martin, Robert Mitchum, Inger Stevens, Roddy McDowall, Yaphet Kotto
— TOP FILMS —
Plus qu’un western lorgnant le film noir, Cinq Cartes à abattre est un whodunit western. Inutile de venir y chercher du suspense : on plante sa pipe dans le bec, on lève les yeux au ciel et on se laisse envoûter par la fumée en faisant semblant de réfléchir… Tout le contraire du suspense en somme. Le film est aussi tendu qu’un vieux slip de grand-mère, et l’ambition est ailleurs. On ne trouve par ailleurs aucun des codes du film noir. Un whodunit en revanche, c’est un canevas cérébral, un jeu de l’oie tout pépère ou un jeu de mots croisés (crosswroads). L’identité du coupable intéresse beaucoup moins que le parcours, un peu comme si on tirait sur le nœud coulant du mort et voyait avec surprise ce qui en ressortait… De l’imprévu, des petites surprises bariolant la trame narrative : tout le contraire du suspense.
Suspense et mystère (les deux moteurs du récit pour deux cylindrées que tout oppose) jouent sur l’appréhension. C’est là que notre belle langue montre sa sublime subtilité. D’un même terme (l’appréhension), ces deux principes narratifs en tirent deux définitions différentes. Le suspense joue avec « l’appréhension » du public, il est question de la crainte de ce qui pourrait arriver ; on est dans l’anticipation et l’inquiétude qui l’accompagne. Quant au mystère, s’il joue avec « l’appréhension » du public, il s’agit de « compréhension », de la faculté de chacun à saisir des vérités cachées ; on est dans la déduction, la réflexion. Avec Sherlock Holmes, on déduit, on renifle les traces du passé, et on cherche à comprendre avec lui ; avec le personnage de Vera Miles dans Psychose, on anticipe, on flaire les prémices du crime à venir, et on cherche à s’échapper avec elle.
Dans Cinq Cartes à abattre, le récit est donc clairement basé sur le mystère, la compréhension, le jeu de piste : à la croisée des chemins entre Les Dix Petits Nègres et le slasher movie. Il est même amusant d’y retrouver Yaphet Kotto qui tournera dix ans plus tard dans un autre film faisant le lien entre Agathie Christie et les slashers des années 80 : Alien. Le principe de l’élimination méthodique des pistes (ou le jeu carrément de massacre) est le même. Comme aux échecs : une pièce après l’autre. On pourrait même s’amuser à noter l’étrange similitude de certaines morts : celle d’un de la bande de lyncheurs sera filmée à l’identique par Ridley Scott pour la mort d’Harry Dean Stanton dans le même Alien.
Cette scène préfigure un des codes de mise en scène du slasher (ici sans le chat d’Alien). La scène s’éternise sur un personnage sans raison apparente, la caméra se positionne légèrement en retrait derrière la future victime pour suggérer la présence de l’assassin, et pour le coup, on est à l’échelle de la scène, pleinement dans le suspense. Tout indique qu’il va se faire buter : si on reste là c’est qu’il va se passer quelque chose, et comme le destin d’un second rôle, c’est de se faire buter…, on le bute. Alors quand je lis que la mise en scène de Henry Hathaway est médiocre… On est dans la suggestion et l’économie de moyens. Hathaway sait que le spectateur connaît les principes du champ contrechamp, et qu’en fonction de la place de la caméra et de la composition du plan, n’importe quel spectateur peut détecter la présence d’un autre personnage hors-champ. Il suffit d’utiliser les mêmes codes : si la future victime n’a aucune idée qu’il y a là un autre personnage, nous le savons grâce au découpage et à l’attente annonçant sa mort. Non pas parce que « bof, c’était prévisible, il est nul cet Hathaway », mais parce que c’est Hathaway qui nous donne toutes les clés ici non plus pour comprendre, on est à l’échelle de la scène plus dans le mystère, mais pour avoir peur. Au lieu d’avoir une intensité qui court tout au long d’une histoire, elle ne se joue que sur quelques secondes. Du suspense de circonstance en quelque sorte.

Cinq Cartes à abattre, Henry Hathaway 1968 5 Card Stud | Hal Wallis Productions, Paramount Pictures Corporation, Wallis-Hazen
« Western en plaid et charentaises. Le verbe y est plus important que le nerf. On y fait référence plus à Poirot qu’à Hercule. »
Si les codes du film noir (femme fatale, flashback, antihéros, jeux d’ombres, etc.) sont inexistants ici, les codes du whodunit et du slasher eux sont bien présents :
— La mise en scène des morts : puisque chaque mort a un sens pour le meurtrier, il doit laisser une signature, identifiable à travers une mise en scène. Autrement dit, après avoir tué, il place le corps d’une manière particulière pour qu’on puisse y lire une signification (et le jeu quand on reproduit sans cesse le même code, c’est la créativité dans un principe très strict, ce qui pousse très tôt — et déjà ici — au grotesque, voire au Grand-Guignol). C’est un code que le slasher partage avec le film de serial killers. Un tueur de slasher cherche surtout à venger et à se mettre à la place de « Dieu » pour réparer ses erreurs ou agir en son nom (comme c’est très clairement exprimé ici avec le personnage de Mitchum), tandis qu’un serial killer reproduit de manière impulsive des meurtres sophistiqués avec des victimes n’ayant aucun lien autre que celui que le meurtrier voudra bien leur donner (les prostituées pour Jack l’éventreur).
— Un mode opératoire unique (à quoi peut répondre ironiquement et symboliquement une ritournelle comme dans M le maudit et comme ici avec Maurice Jarre). Le meurtrier utilise la strangulation. Un mode opératoire censé donner du sens à ces meurtres comme pour éveiller l’intelligence du spectateur chargé, comme les acteurs de ce jeu macabre, de trouver le coupable (ou de faire semblant comme on fait semblant de croire qu’on peut gagner face à un illusionniste). Non seulement la strangulation rappelle la manière dont a été tué le tricheur de cartes (pendu), mais ça permet également de brouiller les cartes au cours du récit puisque celles qui n’utilisent pas d’armes — ou des rasoirs… — se révèlent être innocentes (tout est fait pour, en temps voulu, au moins, suggérer leur culpabilité), et c’est celui qui joue de la gâchette qui se révélera être le coupable…
— Le motif des crimes est presque toujours une vengeance, cherchant à réparer une justice (des hommes ou divine) défaillante. (À noter que seul le spectateur dispose à la fin de cette information, car le tueur a tué l’unique personnage qui avait su le comprendre.)
— Les fausses pistes (par définition, on ne trouve pas de fausses pistes dans le film à suspense, puisque la tension naît de l’appréhension de ce qu’on sait déjà ou devine). On reproduit en fait le jeu des illusionnistes : on sait qu’on est en train de se faire avoir, ce serait un peu idiot de chercher à rentrer dans le jeu et prétendre trouver qui est le coupable. Il n’y a rien de cérébral, il faut se laisser enfiler la corde autour du cou jusqu’à être obligé de supplier pour qu’on arrête de tirer. (Est-ce qu’il y a vraiment des lecteurs d’Agatha Christie qui prétendent prendre du plaisir à la lire en étant convaincu d’avoir été plus fort qu’elle et d’avoir résolu l’énigme avant tout le monde ?… J’ai toujours trouvé ridicule les lecteurs venant se vanter d’avoir découvert le coupable avant tout le monde et prétendre que, pff, c’était un peu prévisible. L’intérêt est ailleurs. Comme dans Columbo ou le Mentaliste par exemple.)
— Même principe ou presque avec le jeu des stéréotypes : prendre des acteurs bien connus, les mettre dans leur rôle habituel, et en faire glisser tout à fait certains à l’opposé quand les autres joueront en permanence entre les lignes, multipliant les fausses pistes sur la nature respectée ou non de leur personnage connu. Retrouver Roddy McDowall dans un western, ça met déjà la puce à l’oreille, parce que, dans un western traditionnel, personne n’imaginerait le voir dans un rôle de gardien de troupeau. Encore moins dans un personnage antipathique (à la Henry Fonda dans Il était une fois dans l’Ouest). Quant au personnage de Mitchum, la référence à son personnage de La Nuit du Chasseur est évidente, ce n’est pas une simple référence polie, c’est pour jouer avec ce qu’on sait du personnage ; tandis que figé après d’innombrables liftings, celui de Dean Martin reste invariablement droit, charmeur et… sobre.
Une des grandes réussites du film par ailleurs, c’est son humour. En soi, un slasher, un whodunit ou tout autre film jouant sur le principe de mise à mort de chacun des personnages par un autre qui se cache parmi eux, puisque tous ces genres jouent avec les codes, sont des films pleins d’ironie. Souvent dans l’histoire d’ailleurs, certains genres ont eu leur âge d’or, et à leur crépuscule, les codes étaient tellement connus du spectateur qu’il devenait inévitable de jouer sur l’ironie (le film sait que le spectateur connaît les codes et le spectateur sait que le film sait qu’il connaît ces codes… — ce qui a provoqué dès la fin des années 90 par exemple une surenchère dans les twists jusqu’à l’absurde). On est ici à l’agonie du western hollywoodien et le western spaghetti prolongeait à cette époque le genre grâce à cette ironie et au retournement des codes. Pour prendre un autre exemple, à la fin de la grande époque des films d’horreur (ironiquement très sérieux en Italie dans les années 70-80 avec le giallo) le genre retrouve un second souffle par l’intermédiaire du sous-genre qu’est le slasher inventant avec Wes Craven le slasher burlesque avec une série de films jouant là encore avec les codes…
À première vue, l’alliance entre l’humour et le western ne fait pas franchement envie. Pourtant, on est loin de Mon nom est Personne ou du Shérif est en prison, et on n’est pas tout à fait dans du Sergio Leone (dans la forme en tout cas). En fait, dans cette désinvolture face à la mort, dans cet usage du contre-pied permanent, de mise en suspens de l’action pour la « réflexion » (la repartie), on peut y reconnaître quelque chose de Tarantino. Un cinéma qui ne se prend pas au sérieux et qui pendant qu’il fait du cinéma sait qu’il fait du cinéma… Au point qu’une scène peut tout à coup s’éterniser pour permettre à des répliques bien trouvées de fuser. Certaines phrases sont inutiles d’un point de vue dramatique, mais elles permettent de caractériser les personnages, de jouer là encore avec le stéréotype qu’ils représentent (« si je suis encore vivant ce soir, je viendrai m’asseoir à cette table et je jouerais aux cartes » à quoi répond la patronne : « tu as raison, un homme respectable se doit de travailler »), ou de se moquer du genre (« ça alors ! je suis arrivé ici en sachant peu de choses, et j’en ressors en en sachant encore moins ! »). Rien n’est pris au sérieux et ça papote souvent dans le seul but de s’envoyer des absurdités délivrées dans la plus grande solennité (le côté sentencieux des discours de beaucoup de personnages de Tarantino).


Rappelons qu’on est l’année d’Il était une fois dans l’Ouest, mais niveau répliques ça envoie également du lourd :
— Quand te décideras-tu à te fixer ?
— Ceux qui se fixent n’ont nulle part où aller…
— Pourquoi vous battez-vous ?
— Il faut une raison pour se battre ?
— Oui, j’en ai une : je ne t’aime pas.
— Dis-moi adieu.
— Très bien… (Il l’embrasse)
— Il était vraiment minable ce baiser !
— Un seul genre de personne me déplaît : les inconnus…
— Quelqu’un vous a élu ?
— Dieu. Et Monsieur Colt fait élire beaucoup de monde.
— Il en élimine tout autant. Laissez Dieu faire son travail.
— Je le remplace jusqu’à ce qu’il arrive en ville…
— On lui a offert une nouvelle cravate. Sauf qu’elle était en fil barbelé et qu’on a serré trop fort.
— Un homme peut bien se conduire en parfait idiot de temps à autre. Ça prouve qu’il est encore en vie.
(Chez la « barbière » :) « Rasage 1 $. Divers 20 $. »
Bref, tout est comme ça. Un bonheur pour mes oreilles de vieux canasson.
L’idée du décalage ne vaut pas seulement pour le genre, ça marche aussi avec le jeu de cartes. On passe du jeu de cartes au jeu de massacre, mais on sent bien que tout est fait pour multiplier les références : ceux qui cachent leur jeu, ceux qui bluffent, ceux qui jouent un double jeu, ceux qui se couchent, ceux qui abattent leurs cartes, etc. Tout est jeu, mais un amusement légèrement cérébral comme peut l’être une partie de cartes ou une histoire drôle. Rien de grossier, ce sont les astuces qui remplissent le film qui servent à amuser le spectateur parce qu’il est censé connaître les codes du western et du whodunit, et donc se laisser manipuler tout en sachant qu’il n’en sortira pas vainqueur (encore une fois il n’y a que les abrutis qui croient pouvoir gagner au bonneteau en suivant parfaitement les gobelets des yeux — et en y jouant tout court ; la finalité, ce n’est pas le gain, mais bien le jeu).
Contrairement à ce que j’ai pu lire ici ou là, la mise en scène est excellente. On reste dans un type de mise en scène classique, on ne va pas demander à Henry Hathaway de faire autre chose. Seulement encore faut-il reconnaître la valeur et l’excellence du classicisme. Si Leone met en avant sa caméra, ça participe au plaisir des yeux, seulement un metteur en scène qui est capable de se mettre en retrait pour mettre l’accent sur les acteurs, la situation et les mots, c’est tout aussi précieux (et rare). Il y a par exemple dans la direction d’acteurs un savoir-faire qui n’est pas donné à tout le monde : quand deux acteurs se font face et se dévorent des yeux sans qu’une ligne de leur texte indique qu’ils doivent à cet instant précis flirter, c’est que le metteur en scène leur demande (les acteurs sont flemmards, et comme tout le monde, pudiques, donc ils n’auront pas l’idée, ensemble, de flirter ainsi). Comprendre un texte, savoir déceler en quelques échanges ce qui se joue précisément dans la situation, ce qu’on peut y apporter de plus pour souligner ou au contraire enlever, c’est un art très délicat. Bouger des caméras et choisir des angles ou des focales, c’est certes compliqué mais c’est un art bien moins subtil que celui d’imaginer le sous-texte et le mettre en œuvre, ou de trouver le ton juste, l’atmosphère juste, l’intensité juste, le rythme juste… Sans compter qu’on peut souvent truquer au montage quand on a foiré des idées de plan. Alors qu’une scène qu’on a mal comprise et donc mal dirigée, c’est foiré pour de bon au montage.

Liens externes :