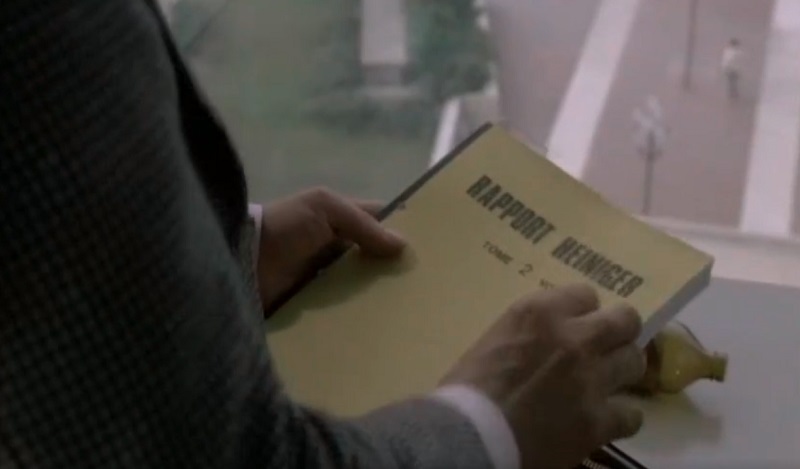Le voilà le chef-d’œuvre du cinéaste franco-ukrainien. On se demande encore comment un tel film a pu rester inaperçu pendant tant d’années. Le pire moment sans doute pour le sortir : la veille d’une guerre qu’on espère encore en invoquant Coué qu’elle n’aura pas lieu, et se référant à une grande encore dans les mémoires qu’on voudrait tant ne plus revivre. Et voilà que le film jouerait presque les chats noirs.
D’autres films antimilitaristes ont pourtant eu un meilleur sort auprès des critiques et des historiens. Léonide Moguy était peut-être populaire avant-guerre, ce n’était pas Renoir. Ce sera d’autant plus facile à oublier.
Arrêtons un moment de chialer. C’est Quentin Tarantino qu’il faut remercier de l’avoir sorti des limbes de l’oubli, et qui a largement loué ses qualités.

Je t’attendrai, Léonide Moguy (1939) | Éclair-Journal
À première vue, en songeant à Conflit (tourné l’année précédente) qui se déroulait dans de beaux décors d’appartements bourgeois, rien de commun avec un film qui prend place, lui, dans un village aux abords du front franco-allemand. Pourtant, à y regarder de plus près, on retrouve dans les films de Moguy certaines techniques identiques : sa caméra est toujours en mouvement pour suivre au plus près ses personnages, la profondeur de champ est travaillée pour y laisser se développer une vie à part au second plan (la force de la contextualisation, toujours ; Moguy a beau être lyrique, il est surtout réaliste, comme un Raymond Bernard ou un Abel Gance pouvaient l’être), les acteurs se situent si bien par rapport à la caméra qu’il est parfois inutile de la bouger ou de couper afin de proposer un contrechamp… De fait, les contrechamps sont rares, Moguy préférant disposer ses acteurs dans le même cadre ; et quand il le fait, c’est lors des rencontres entre ses personnages principaux ou lors de moment de tension (ne plus voir l’objet de cette tension et voir la peur se dessiner sur le visage d’un personnage en imaginant ce qui se joue hors-champ, c’est bien plus efficace). Le tout est merveilleusement fluide. Pas de plan-séquence forcé par pur maniérisme : Moguy cherche à être efficace auprès de son public, pas à émouvoir les étudiants en cinéma. Le spectacle, et le sujet, avant tout.
Le sujet, parlons-en. Parce que c’est là encore une indéniable réussite et le point fort du film. On songe un peu à La Ballade du soldat sorti vingt ans plus tard en Union soviétique, et avec un dispositif narratif cependant bien différent. Car la grande originalité de cette histoire, c’est qu’un peu à la manière du récent 1917, on suit son personnage principal en temps réel (et en dehors de quelques plans de coupe ou des courts montages alternés, on ne le quitte quasiment pas). Ce n’est ni une astuce ni un exercice de style, mais bien la particularité d’une situation (ou d’une opportunité) qui rendait possible une telle concentration d’événements : la voie du chemin de fer sur laquelle file un train plein de soldats français est attaquée par l’aviation allemande ; le temps qu’on répare la voie, un des soldats, qui reconnaît les abords de son village, veut en profiter pour saluer sa famille. Un « bon de sortie » comme on dit au vélo. Le soldat (Jean-Pierre Aumont) promet de revenir en moins d’une heure. Le problème, c’est qu’une fois retrouvé sa mère, elle lui apprend que sa fiancée, qui logeait chez elle, se retrouve à faire l’hôtesse au bar mal famé du coin fréquenté par une ribambelle d’autres soldats et tenu par un borgne un peu louche lorgnant avec insistance sur sa belle… Et voilà qu’en moins de deux, notre soldat cavaleur doit démêler le vrai du faux, tenter de se rabibocher avec sa fiancée, se tenir à carreau des gendarmes ou des délateurs, et composer encore avec une mère un peu trop aimante. Une vraie tragédie pressée par le temps. Un retour presque aux règles aristotéliciennes du théâtre classique…
Les bonnes idées, on sait ce que d’autres en font. Moguy, lui, assure à tous les échelons. Comme dans Conflit, c’est aussi son excellente distribution qui l’empêche de passer à côté de son sujet. Jean-Pierre Aumont, en désertion temporaire, donne le ton : l’urgence, oui, mais surtout la justesse. Et une carrure de premier rôle : son visage respire l’intelligence et la sympathie. Une très légère réserve sur l’actrice de la mère (Berthe Bovy, un peu grimée inutilement à mon sens, mais elle aussi, une justesse folle dans un rôle qui aurait très vite pu devenir insupportable). Le patron du bar, René Bergeron, là encore, qui parvient à ne pas rendre antipathique un personnage qui aurait pu l’être : comme dans tous les meilleurs films avec de bons méchants, on aime à la détester, juste assez pour le comprendre et le craindre. Une vraie gueule avec un cou-de-pied en guise de nez et un débit fracassant qui vous donne l’impression qu’il aboie pour que vous déguerpissiez. Et j’insiste : quand on y songe, il aurait été si tentant d’y mettre un acteur encore plus rugueux et renfrogné (au hasard, Jacques Dumesnil dans une interprétation ratée dans L’Empreinte du dieu, du même Moguy et tourné juste après). La subtilité, ça ne se commande pas.


Je garde le meilleur des interprètes pour la fin. Avec cette énigme, ce météore, du cinéma français qu’était Corinne Luchaire. J’en ai déjà un peu dit sur mon admiration pour elle dans mon commentaire sur Conflit, mais la voyant ici pour une seconde fois, son talent et sa personnalité sont encore plus évidents. À seulement 18 ans, elle avait une présence folle, remarquée à l’époque puisqu’on la comparait à Greta Garbo. Au même âge, et si elle partageait avec l’actrice suédoise une même corpulence impressionnante (sortes de grandes asperges — ou de « grosses vaches », pour reprendre le terme moins aimable de Louis B. Mayer), le caractère diffère. Même si on a affaire à deux grandes timides, car ce sont de celles qui arrivent à faire de cette timidité une force, et qui quand elles répliquent, ou s’expriment, ou regardent, impressionnent, peut-être parce que se refusant de se dévoiler toutes entières, elles savent en donner juste assez pour donner réellement à voir, on sent toutefois une certaine exubérance chez Corinne Luchaire qui était absente chez Garbo (surtout au même âge). Cette exubérance, Corinne Luchaire la laisse peut-être plus deviner dans des séquences de Conflit où elle débite certaines répliques rapidement avec autorité. Même dans la stature, si toutes les deux sont grandes, et loin d’être frêles et fragiles, il faut noter que le maintien de Corinne Luchaire est celui d’une petite-bourgeoise bien éduquée (dos droit, port de tête…), chose que Garbo n’aura jamais. Petite-bourgeoise, c’est ce qu’elle était d’ailleurs, Corinne Luchaire…, et ce qui la perdra. Parce que si, comme indiqué dans l’autre commentaire, elle portait déjà des tailleurs avant que cela soit la mode, signe d’une certaine émancipation, il lui sera impossible de se séparer de l’influence de son père durant l’Occupation… Un gâchis inouï pour une actrice qui en deux ou trois films avait prouvé qu’avec le même talent que Danielle Darnieux, elle aurait pu être son pendant avec vingt centimètres de plus. Elle était aussi très belle, avec un visage de hamster fait pour les mélos. Sa diction, sa voix, plus encore, comme des coups de griffes d’un animal blessé, lui évitait justement peut-être de tomber dans les jolies voix de mélodrames et lui donnait à la fois une sorte d’autorité contrariée et d’assurance blessée. C’est cette modernité et cette force intérieure jaillissant avec difficulté qui étonnent aujourd’hui.


On voit Corinne Luchaire finalement assez peu en comparaison avec Conflit. Mais c’est elle que Jean-Pierre Aumont vient trouver, elle qu’il espère revoir, convaincre, aimer à nouveau, tirer des enfers. À force de parler d’elle, de tendre vers elle, d’être le sujet central et l’enjeu principal du film, on l’attend et on la connaît avant de la voir. Alors quand elle apparaît, c’est comme un petit miracle qui se produit. On vous promettait la lune, et vous comprenez que Luchaire vaut bien plus que ça. On se demande comment une si grande fille, sachant si bien se tenir, belle comme un hamster de concours, peut se retrouver dans une telle cantine pleine de boue et des mâles crevés. C’est cette étrangeté qui nous pousse un peu plus à espérer que son homme parvienne à l’y extraire. Et on peut imaginer à quel point le sentiment de trahison a pu envahir les « bons petits résistants » si scandalisés qu’une telle femme n’ait jamais éprouvé le besoin pendant la guerre de se ranger de leur côté. C’était comme si finalement les efforts de Jean-Pierre Aumont avaient été vains et qu’elle avait décidé de rester avec son ignoble patron de bar. Y a que ça.
On ne devrait pas juger les enfants et les inconscients. La preuve qu’à une époque, la France a su, quand ça en arrangeait certains, ne plus séparer l’œuvre de l’artiste. Pas sûr qu’il faille s’en servir de leçon. J’ai toujours été Arletty ; je suis désormais aussi Corinne Luchaire, l’actrice.