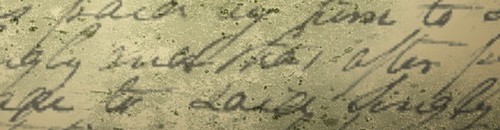Sur la lune demain je vais
Rencontrer un cache
Parent
Pour lui dire combien
Il me manque
Sur sa face constellée
Je porterai deux baisés
Révolutionnaires
Et quand au terme de ma farce
Je lui dirai adieu
Je poserai sur sa main
Un coussin
Pour lui faire
Pouet-Pouet
(Sonnaiku)
Sur les braises
Un vent d’oc
Souffle
La pestilentielle
En couronne ainsi
Font Front Fond
Là-bas les pouets
Maudissent les conteurs
D’histoires
Et tous regardent
Les Onze
À la télévision
La France sans le sou
Y mise sa culotte
Pour qu’on y voie la lune
Chanter de son orifice
Postal
Ailleurs, la flûte
Au cul
Et les cigarettes au bec
Le reste du pays
Croule sous le
Meme débat
Tandis que moi
Derrière mon tricot lover
Sur mes fraises d’oïl
J’ajoute un peu de mon
Indifférence
Hier j’ai vu
Lors de mon passage en Flandre
Deux extravagants tétons
Pincés sur un flanc de colline
Or, si la même main se tendait vers eux
Ce n’était rien à côté
De ce que je compris bientôt
En me rinçant les yeux :
Ces tétons
N’appartenaient pas
À la même femme !
Plein d’espoirs concupiscents
Je me faufilai vers cette forêt wallonne
Avec la ferme idée de me saisir
De l’un ou de l’autre
Arrivé au col
Il était trop tard
Les tétons s’étaient tus
Et une main me fouetta le visage
Brevet vert en main
Me voilà à cuisiner
Des rubans
Dans mes cheveux
Pintade chaude
Et bleue à l’horizon
Bientôt dans ton assiette
Tu manges rat
Moi le pipi gris
Je siffle dans vos verres
À vingt sous
Sous ma coupe
Je bois vos prières
À deux balles
Bal urine
À la commissure des lèvres
Tout dégouline
Line de vapeur moite
Changée en stance
Troubadour
Dourmir rêver
Mourir peut-être
Dit le pouet
Mais de nos pouets
Aux interstices de nos cliques et de nos claques
Tout se mélange
Dans les langes
De l’instance
Mère
Mastodonne d’airain
Aux reins
D’argile
Oui, passer le Rubicon
Et mourir
En chemin
Tout composté
Déjà
…⚘…
Ô moi, eau écarlate !
Quand je baigne dans tes veines
T’as de la veine
Quand je pisse
Hors de tes entrailles
Tu baignes en moi
Ô, gicle ! de tous côtés
De l’air, de l’air !
Libre ! Enfin !
Fini le train-train de la vie
Dans ce cycle infernal
Maintenant la lumière
Ô qu’est-ce là mes globules ?
Je coagule !
Rentrons au bercail
Avant que de l’occire
— Ô rage ! eau de l’espoir !
Nous coagulerons plus tard !
Rentrons, vous dis-je !
— Impossible ?!
Rah, quelle plaie !
Quelle plaie !
Perlimpinpin
C’est le nom de mon papa
Comme lui je suis de la poudre du Bengale
Tous deux faisons des miracles
Sur les réseaux de l’instance pape
Nous saupoudrons un peu de nos larmes
Sur vos tracas quotidiens
Perlimpinpin
C’est le nom de mon papa
Retiens ce nom si tu as mal
Tous deux pouvons te vider les poches
Notre cousin
Marchand de sable
Trime pour le pape
Mais au Bengale
La rémunération est cruciale
Et vos bobos sont notre oseille
De la poudre pour tes yeux
Perlimpinpin
My last fortune cookie:
« What’s wong with you?! »
-你這人怎麼回事-
Dans les spirales
De mes pensées fétides
J’ai vu voltiger
Une mouche
Celle-ci était zinzin
Et me susurrait
Aux synapses
Combien mes volutes arides
La rendaient marteau
Tsé quoi mon colibri chéri
J’men vais patauger
Au-d’ssus d’ta tête
Jusqu’à c’que le zag t’emporte
Qu’elle me dit
J’sais plus quoi penser depuis
J’ai la tête dans un étau à bois
J’sens plus mon tournevis
Et la zigzaguante a pris la mouche
La poudre d’escampette
Elle broie du noir
Maintenant
Dans ma cervelle
Je m’en allais flairer le groin dans les roches crevées
Mon patron sur le dos j’étais son féal
Je grattais sous la terre, truffe ! et c’était un régal
Oh, la la que de laies avides ai-je pu renifler !
Mon unique carotte, je la tenais de mon maître
Porcinet rêveur j’égayais vos blondes de mon chant
Porcin. Mon auge était ronde
Et mon patron aussi. Revenu bredouille, le traître
Me fit hisser en haut d’une broche
Tira des ficelles sur mes sabots
Blessés. Un pied près de mon cœur
Vidé.
Hier j’ai vu mon parachute
Par en haut
À la renverse
Je tombe
Soudain
Le vide
(Un parachute ça se regarde par en dessous comme les jupes des filles ou ça se regarde pas.)
Ce matin
Dans mon train
J’ai vu
Dudu
Faire le mariole
Vers 14 heures
Pour son malheur
Dudu
A vu
Un Laguiole
Lui frôler le pif
Paf !
Maintenant
Dudu
Saigne
Il en a une fiole
Pleine
Mais Dudu
Va mieux
Il batifole
Déjà
Dans les couloirs
Du RER
Demain
Dudu
Prendra
Son train
Tout affriolé
Un cornet
Au bout du cou
Façon à
Tutu
Tête
Traînant
Derrière lui
Son maître
Dudu
Mon toutou
Quotidien
Mon agent
De voiries