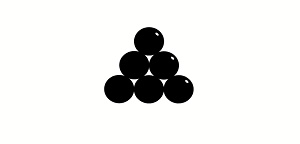Une société qui ne cesse de prôner, et d’afficher comme principe, le respect du prochain, mais qui en fait méprise l’autre (l’étranger) est vouée à la disparition.
La distinction parfois entre le « prochain » et « l’autre » se limite à peu de choses. C’est en fait toute la subtilité, et le vice, contenu dans ce qu’on dit, et ce qu’on fait. Ce qu’on voudrait, dans l’absolu, que « les autres » appliquent (potentiellement pour nous ou « nos prochains »), mais qu’on n’hésiterait pas à ne pas appliquer pour soi-même si on était sûrs de s’en tirer sans dommage.
C’est bien pourquoi, en plus des règles, des lois, des principes, des belles paroles creuses, les sociétés ont toujours mis en place des systèmes pour les faire appliquer. Contrôler, réguler, apaiser, alerter. Si ces systèmes défaillent ou n’ont pas les moyens d’exercer leur contrôle, les lois ne sont que du vent.
Plusieurs facteurs peuvent gripper la machine. La crise, susceptible de moduler les rapports de force alors tenus en équilibre (et toutes les sociétés sont organisées selon des modèles indépendants, des boules de neige non assujetties aux influences extérieures) ; la compétition, qu’on accepte toujours avec facilité et dont on admet aisément les principes “vertueux” quand on en est les principaux bénéficiaires ; et la corruption (j’entends par là toutes les formes de corruption, autrement dit toutes les activités ou comportements susceptibles de profiter à des individus dans une situation où il n’aurait rien gagné en agissant selon la “règle”, que l’on parle de loi ou de simple morale).
Notre société souffre. Et c’est bien parce que tous les facteurs sont réunis pour qu’il n’en soit pas autrement. La compétition accentue la crise, augmente la nécessité d’avoir recours à la corruption ; la compétition profite aux petits corrupteurs et se nourrit de la crise, etc.
Ça, c’est le constat. Parfaitement personnel, mais qui aurait légitimité de présenter autre chose qu’un constat personnel ? Si l’histoire n’est pas affaire de politique, le constat, le regard sur le monde donc, ne l’est pas non plus. Au mieux, la politique se satisfera d’un consensus, mais même quand « un constat consensuel » lui est proposé (à dame politique), elle peut fermer les yeux et ne pas en tenir compte. Il y a ceux qui constatent, et ceux qui jouent avec le feu. (On le voit notamment avec le « réchauffement climatique ».)
Maintenant un exemple, plus ou moins fictif, pour voir comment le petit effet pervers décrit en titre (différence subtile entre le respect que l’on porte au prochain et le mépris de « l’autre ») peut s’appliquer à l’échelle de l’individu. À l’échelle de « l’autre ».
Imaginons un homme vivant seul, sans travail, sans amis s’installant discrètement dans une plus ou moins grande ville. Cela pourrait être un migrant (moi, que je déménage, je migre), un célibataire, un individu louche ayant choisi de changer d’identité et de vie (oui, ça existe), ou le retour attendu de David Bowie sur Terre.
Imaginons encore que cet homme, pour des raisons inconnues ou qui lui sont propres, interagisse peu avec ses voisins, ni avec personne d’autre, étant donné que cet homme-ci n’est entouré d’aucun “proche” ou “semblable” (il n’y a qu’un David Bowie, des migrants seuls, ça existe aussi, quant aux célibataires et aux hommes ayant changé de vie, de fait, ils n’ont pas de proches).
Quel serait les réactions des habitants, des autorités, à l’égard de cet homme plutôt louche ? Est-il à l’écart de la société ? Au-dessous ou au-dessus des lois ? Passons les détails qui auraient pu pousser cet individu à être effectivement un « hors-la-loi » (ah, pour migrer, vu que les demandes d’asile ne sont pas respectées, ça devient un délit fort condamnable ; et pour changer d’identité, il faut bien trafiquer quelque part…), et concentrons-nous sur les réactions « des autres ».
Dans les années 70, on a expérimenté la capacité des individus à se comporter comme des tortionnaires en milieu carcéral et cette joyeuseté est depuis connue sous le terme « d’expérience de Stanford ». Eh bien dans notre société, il y a de ça, et notre David Bowie réincarné en ferait l’expérience. Si dans une société encore prospère (une telle société a-t-elle jamais existé ?), on pourrait penser que cet “autre” puisse encore faire valoir ses droits, au respect de son intégrité, de son intimité, de son droit à l’indifférence, de l’équité, et être ainsi considéré, comme « les autres », comme un “prochain”, et non un “étranger” ; dans une société soumise aux cahots des forces contraires, à la crise, au doute, à la peur, à la suspicion…, cet homme servirait alors de fusible, de réceptacle aux frustrations de ses contemporains, de mouton noir, et serait responsable de tous les maux, réels, supposés ou fantasmés, craints par ses mêmes contemporains.
En détail, lentement, insidieusement, ce qui était alors louche deviendra alors que trop suspect, et cette suspicion sera alors confirmée, puis légitimée par l’échange de doutes des uns et des autres. On oublie rarement dans cette situation que les monstres n’existent pas, ou que quand ils existent, ce ne sont jamais que des monstres à cinq (ou plus) têtes. Les monstres sont des créations de la société, non des individus. On voit des monstres quand on veut en voir. On les crée, quand on veut les voir prendre forme. Mais ce faisant, on oublie là encore, qu’on participe soi-même à fabriquer et à être ce monstre, et que ce monstre, ce n’est pas celui qu’on désigne, mais l’espèce de masse informe et dégoûtante qui se cache derrière une somme d’individualités molles. Et on retrouve ici, la crise, la compétition et la corruption.
Notre David Bowie kurde national devrait alors supporter les premières insultes, incivilités ou agressions de ces “prochains”, mais le plus dur resterait à venir. Car notre homme, ainsi harcelé, pourrait être en droit de faire appel à l’autorité de la ville, de la police, à Bruce Willis…, rien n’y ferait. Parce que quel intérêt aurait une quelconque autorité à faire respecter le droit pour un individu seul contre plusieurs autres ? On s’accommode très bien des règles d’exception, et cela, sans avoir à en faire la propagande, au contraire. Car chacun des représentants de ces “autorités” s’appliquerait personnellement à ne prendre aucune initiative pouvant nuire à sa propre tranquillité (et à ceux de ses “proches”). Ne pas intervenir face à un individu commun, c’est prendre le risque que cet individu fasse jouer ses relations, sa propre autorité auprès d’autres services “compétents” ; mais un homme n’ayant aucune accroche, aucun recours, une bête, et qui plus est, une bête traquée par les citoyens de la ville, un nuisible… pourquoi prendre ce risque quand il n’y en a aucun à ne rien faire ? La corruption (passive) est là. À la question de principe bien connue « qu’est-ce que tu aurais fait pendant la guerre ? » on oublie de préciser qu’il ne sert à rien de répondre, car la proposition de principe, « dans l’absolu », s’opposera toujours dans les faits à une situation, un contexte personnel, dont les implications seront toujours jugées plus essentielles par rapport à ces implications de principes. L’amour du prochain vaut bien un peu de mépris pour l’autre. « Ma fille vaudra toujours plus que ce dangereux criminel ». Pourtant, on prétendra toujours le contraire. Prétendre et faire. C’est ce que l’expérience de Stanford avait plus ou moins illustré : notre capacité à nous cacher derrière des principes, qui, en dehors de toute régulation ou contrôle, volent en éclats. Mieux, pour abattre « la bête », le monstre supposé, on se portera toujours candidat, comme une preuve de notre appartenance au groupe des “prochains” contre l’autre, l’étranger, l’intrus.
D’où l’importance, non pas de décider de règles, mais d’être en capacité de les faire appliquer. Or, à des situations de crises, on voit bien que le législateur aura toujours tendance à ajouter ou à adapter des règles communes. Le problème ne vient pas des règles, mais bien à ce qu’elles ne sont pas appliquées sans moyens de contrôle.
Imaginons encore où tout ça pourrait nous mener. Notre homme est donc harcelé, agressé et aucune autorité légitime ne prête attention à lui. Démarches, lettres, appels à l’aide, appels téléphoniques…, tout cela lui serait automatiquement refusé. La machine n’est plus grippée, c’est déjà un monstre. Un monstre nourrissant un autre monstre et n’attendant plus qu’elle s’éveille pour la frapper, lui couper la tête et la présenter fièrement à la foule déchaînée…
« J’ai vaincu le monstre qui était source de tous nos problèmes ! Accueillez-moi en héros ! »
Et cela se passe toujours ainsi. Pour qu’il y ait des héros, il faut qu’il y ait des monstres. Puisque les monstres ne naissent pas spontanément, on les crée, on les nourrit, et on les abat.
Les héros sont tous des imposteurs.
Quelles alternatives pour notre David Bowie national ? La fuite, l’autodestruction et la rébellion. Le plus souvent, notre homme choisira la solution la plus commode : la fuite. Mais parfois, les circonstances font que notre homme est en incapacité à fuir (on remarquera d’ailleurs que souvent les sociétés dans lesquelles ils ne sont pas les bienvenus préfèrent les bannir, et si autrefois le bannissement était une sanction commune, on parle aujourd’hui plutôt d’expulsion, et quand il n’est pas question de “migrants” on parlera alors plus de harcèlement, ce qui est toujours plus pratique parce qu’on n’a pas à se salir les mains et on a jamais à répondre de son mépris pour l’autre — on peut toujours faire entrer le harcèlement dans le Code civil, il sera plus question de harcèlement au travail, non de celui dans une société et en particulier quand ceux qui s’en rendent coupables sont précisément ceux chargés de la constater — corruption, toujours).
L’autodestruction, plus communément appelée “suicide”, est probablement moins fréquente que les fuites, les exils, mais la société aura toujours une réponse toute prête à ces petits drames personnels : la victime était inadaptée. Ou « pas heureuse », ou « mal dans sa peau ». On peut, c’est certain, être malheureux de voir que ses “prochains” se complaisent dans des agressions permanentes à son encontre et cela en toute impunité ; et plus que mal dans sa peau, il est à parier que ces victimes soient plus incommodées par la “peau” des autres… Il y a une vidéo sur Youtube d’un film pas très drôle mais qui illustre très bien cette situation : un diable s’amuse à taper une victime avec une petite cuiller, partout, tout le temps, et ça n’en finit pas…
C’est aussi le principe du supplice de la goutte d’eau ou de la lapidation. On peut faire face à une goutte, même à cent, mais à la millième on est déjà noyé. « Vous allez me faire croire que vous êtes harcelé par les bonnes gens du village… qui vous crachent à la figure ? » (Et une goutte de plus, une.)
Je vais bien me garder de faire de la statistique, mais à vue de nez, on retrouve donc en troisième position, après la fuite et l’autodestruction : la rébellion. Il est probable même que dans nos sociétés actuelles, cette troisième possibilité l’emporte sur la seconde. On pourrait se dire, que se rebeller contre des institutions, c’est formidable, surtout dans le pays de la révolution… Sauf que je place dans cette rébellion, toutes les formes de rébellions, pas forcément les plus populaires, et donc plus précisément ici celle décrite par la situation de notre homme, exilé dans son propre pays, David Bowie perdu sur terre… Et là, ça fait mal, parce que cette rébellion-là, on ne l’accepte pas : une rébellion de masse d’individus se révoltant contre une autorité, quand elle finit par tourner l’histoire à son profit, c’est toujours raconté avec des trémolos dans la voix par les héros de ces guerres qui y ont survécu. Un rebelle solitaire ne tourne jamais l’histoire à son avantage. Il n’est le héros de personne. Il sera toujours le monstre. L’autre. Celui qu’on a nourri pour se faire peur ou pour satisfaire son propre petit confort. Avant l’explosion, qu’on sait venir, mais qu’on espère toujours plus tardive, toujours plus loin de « nos proches ». Rien n’explose innocemment. La logique des kamikazes ou des terroristes par exemple, ou des assassins de masse comme on en rencontre parfois aux États-Unis, échappe à la logique des sociétés qui se disent en être victime. Pourtant, la logique est là. Du basculement coupable entre le principe de respect du prochain vers le mépris de l’autre. Les monstres, s’ils existent, ne se font pas tout seuls. La société aura toujours le beau rôle à se présenter comme la victime de tels monstres. Mais ce faisant, elle ne fera toujours plus que pointer du doigt le fruit, le résultat, le monstre, de sa propre cruauté. Des individus seuls ne peuvent détruire une société. C’est la société elle-même qui se détruit, seule, par déni de la réalité, déni de la responsabilité, déni de justice, déni de ce sur quoi elle se base. Une telle société sera toujours le mirage de ce qu’elle prétend être. Derrière le paravent, se cache le monstre. Le seul.
Restons à l’abri. Ou disparaissons.









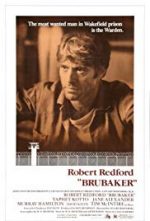 Année : 1980
Année : 1980