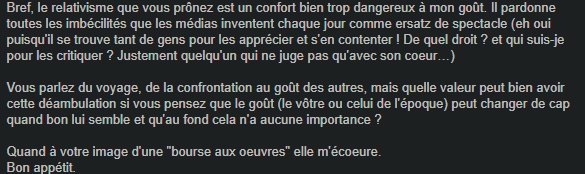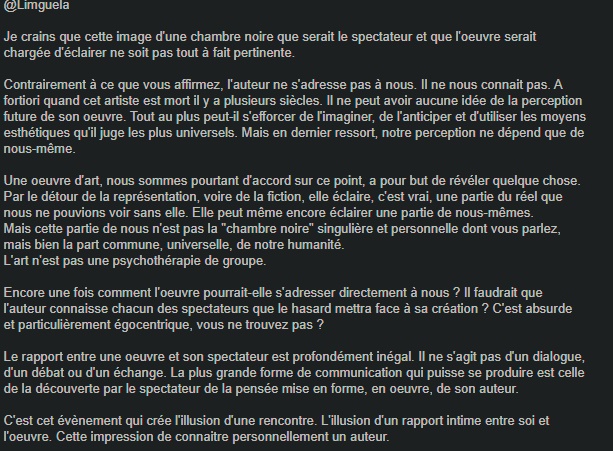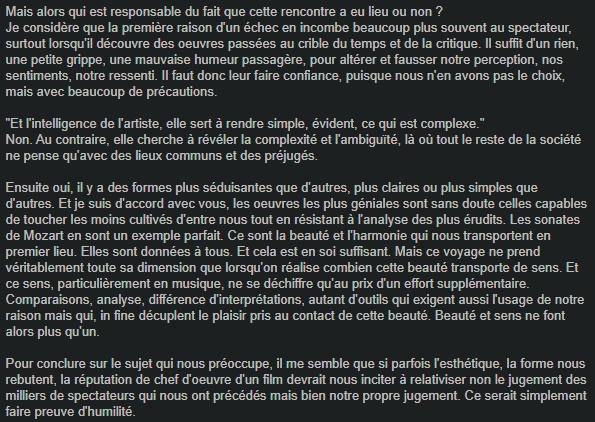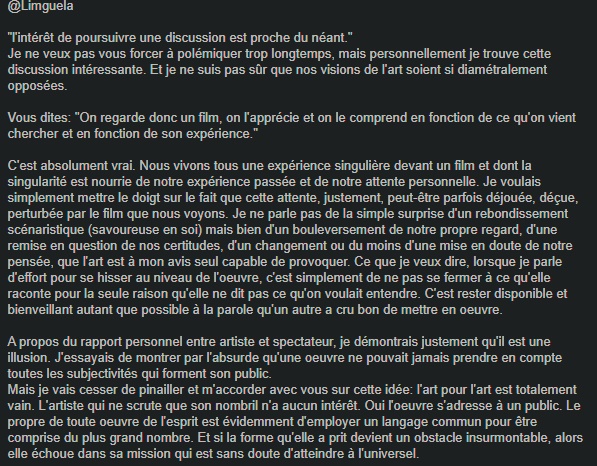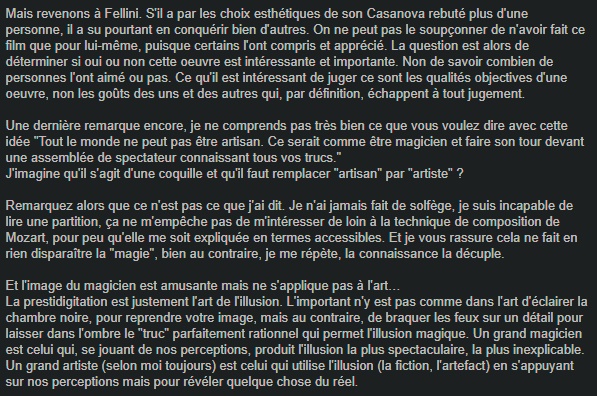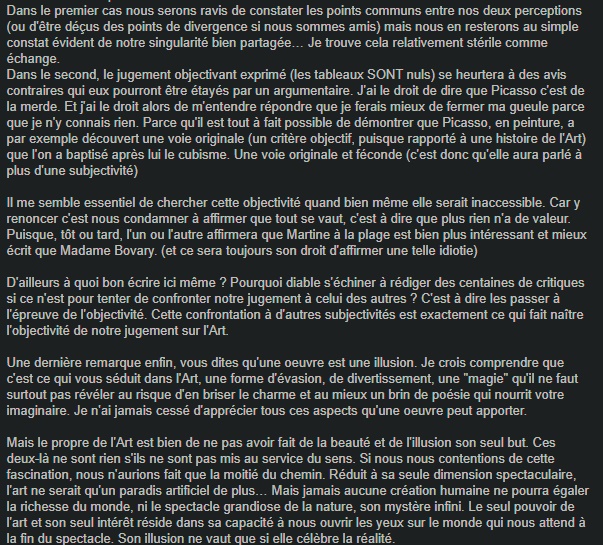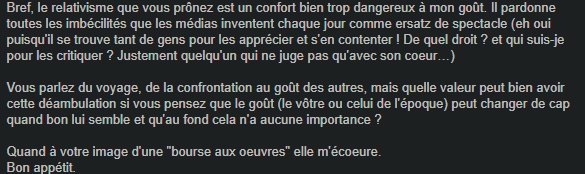Moi, par exemple, je ne comprends absolument pas comment on peut s’emmerder devant l’ambiance démente de Stalker.
C’est bien toute la diversité des goûts. L’esthétique touche directement à ce qui nous est personnel. On pourra écrire des milliers de critiques pour tenter de rationaliser tout ça en prétendant y trouver des valeurs esthétiques universelles, il suffit parfois d’un seul élément pour nous pourrir le paysage ou lui donner sa saveur. Plus on découvre les goûts des autres, plus on est surpris. On prend d’abord l’autre pour un con, pour un mouton, on dit qu’il a des goûts de chiottes, et puis à force, en partageant certains goûts, en étant soi-même la risée de tous en aimant une œuvre particulièrement détestée par d’autres et qu’on chérit, on accepte. On pourra toujours me dire que le relativisme, ça pue sa race, je ne vois pourtant pas d’alternative raisonnable. On peut adorer Casanova ou le trouver grossier, on peut être fasciné par Stalker ou le trouver glauque et chiant, il n’y a pas de goût conforme et respectable. Et ça pousse encore plus au relativisme quand ce sont nos propres goûts qui évoluent. Revoir Chunking Express et ne pas comprendre pourquoi on a trouvé ça génial…

Si tu regardes un classique, un chef-d’œuvre considéré comme tel, et que tu n’y trouves aucun intérêt, tu ne feras aucun effort pour te mettre au niveau… de ce que tu penses être de mauvaise qualité. Ce n’est pas au spectateur de faire l’effort d’aller vers une œuvre (même s’il peut), c’est avant tout à l’artiste de tout mettre en œuvre pour lui représenter. C’est même le sens de l’art. Tu ne présentes pas des œuvres pour le goût de l’absconcitude ou de la complexité. Toutes les grandes œuvres sont complexes ? Mouais. Une grande œuvre, c’est une œuvre qui a différents niveaux de lecture, qui est compréhensible de tous, qui a un premier niveau de lecture simple, clair, et qui ensuite peut nous suggérer une certaine complexité. Mais cette complexité, c’est plus la nôtre que celle de l’œuvre. Un chef-d’œuvre, c’est une lumière qui s’éclaire dans une chambre noire. Notre chambre noire. On y découvre nos secrets, nos mystères, peu importe, mais un chef-d’œuvre ne peut et ne doit être que l’éclairage. Pas la chambre déjà toute décorée. Si une œuvre éclaire son propre nombril, tu regardes ça de l’extérieur et tu n’y trouveras jamais aucun intérêt. L’intelligence elle est du côté de l’artiste, pas de côté du spectateur. Et l’intelligence de l’artiste, elle sert à rendre simple, évident ce qui est complexe.
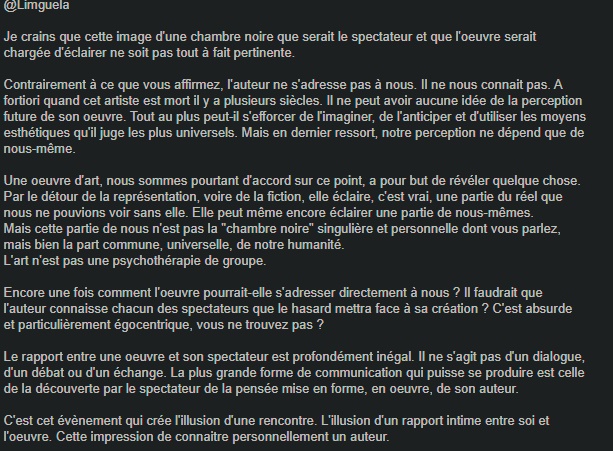
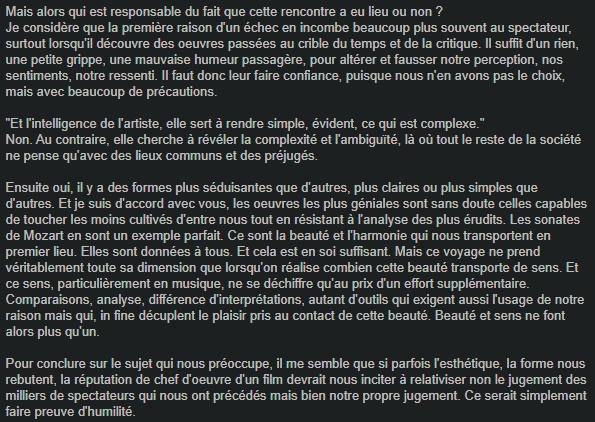
L’image de la lumière dans la chambre noire est pertinente quand on la conçoit comme je conçois l’art. Manifestement, on en a une vision totalement différente. Il faut respecter ça, je vais encore faire appel au relativisme. Vous vous intéressez à l’art et vous avez des valeurs, et tout cela vous est propre. On regarde donc un film, on l’apprécie et on le comprend en fonction de ce qu’on vient chercher et en fonction de son expérience. Mon expérience, ma formation, mes valeurs, mon goût, je l’ai grâce à ma formation théâtrale. Vous en aurez sans doute une autre. Et il m’est arrivé de tâter un peu d’écriture, et on retrouve exactement les mêmes principes, les mêmes techniques, et les mêmes objectifs. Un acteur s’adresse bien à un public. On trouve certes des acteurs qui ne jouent que pour eux-mêmes. Ce sont les pires. On trouve aussi des écrivains qui n’écrivent que pour eux-mêmes, c’est même 99 % des écrivains, ceux qui ne vont pas publier et dont les écrits n’intéressent qu’eux-mêmes. Un acteur, comme un cinéaste ou un écrivain ne va pas s’adresser individuellement à chaque spectateur de la salle. On s’adresse à un public. Une œuvre, c’est un produit relayé par un transmetteur à une audience. C’est ainsi que ça a toujours fonctionné, et cela dans tous les arts. C’est donc un peu idiot de ramener ça à un rapport entre l’artiste et un spectateur. Vous pouvez la faire, mais ce serait la preuve de votre grande méconnaissance en matière de production. Tout le monde ne peut pas être artisan. Ce serait comme être magicien et faire son tour devant une assemblée de spectateurs connaissant tous vos trucs. À partir de là, notre compréhension du “phénomène” étant parfaitement opposée, l’intérêt de poursuivre une discussion est proche du néant.
Quand on juge une œuvre mauvaise, il faut un sacré toupet pour estimer que cela incombe au spectateur. Si on ne te comprend pas, si on ne te prête aucune attention, si tu ne convaincs pas, ce n’est pas la faute de l’autre, du spectateur, mais bien à l’artiste. Et puis quoi encore ? Tu vas courir les castings, tu envoies des manuscrits à des éditeurs, on te trouve nul, et… c’est la faute de ceux qui te voient ou qui te lisent ? Heu, non. En tout cas pas dans ma perception. Vous en avez une autre, c’est tout à fait votre droit.
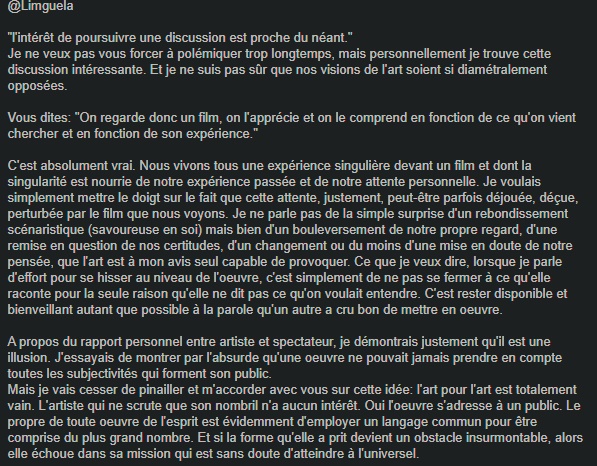
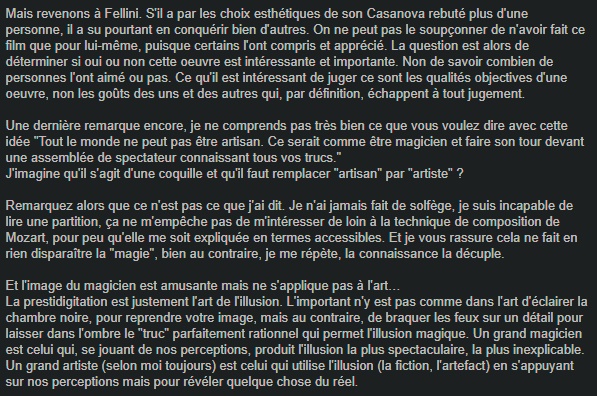
Vous pourrez assez difficilement définir ce que seraient ces critères objectifs pour juger d’une œuvre. Puisque ces critères de jugement seront influencés par les motifs, valeurs ou désirs du spectateur qui sera amené à les juger. Si le seul critère de jugement est la sensibilité personnelle éprouvée par le spectateur, chercher à établir la valeur objective d’éléments étrangers à ce cadre “sensible” n’auront aucun sens. Pour juger, il faut des valeurs communes. Or, pour une œuvre d’art, vous n’arriverez jamais à établir ces critères essentiels utiles pour juger de ces œuvres. Même dans un cadre intellectuel, cinéphilique, universitaire ou critique, il y a assez peu de critères qui forment des passages obligés au détecteur de jugement. Le plus souvent, chacun dans sa spécialité ou sa fonction (un historien de l’art, un critique ciné, un professeur d’université, un cinéphile, voire un cinéaste) jugera en fonction de critères personnels. On y verra entre eux beaucoup plus de critères communs que dans un domaine différent, mais ces critères ne seront jamais exclusifs ou exhaustifs. Il y a toujours un critère de jugement qui domine chez n’importe quel spectateur éclairé, et d’autres auxquels il ne prêtera jamais attention.
Imaginons, par exemple, un critique qui pense que chaque œuvre doit disposer d’une morale et qu’il ait ensuite à juger de cette morale : il pourrait n’avoir aucun intérêt à juger du jeu des acteurs ou de la photographie (et même s’il le faisait, il est tout à fait possible encore que les critères pour juger de ce seul élément soient multiples et puissent opposer différentes sensibilités). Et imaginons maintenant, ma mère, qui ne juge une œuvre qu’en fonction du plaisir qu’elle y a éprouvé. Ses critères pour juger de ce plaisir seront assez vagues, mais le résultat assez simple : une note sur 10, une appréciation…
Puisque l’art s’adresse à tout le monde, c’est à chacun de déterminer les critères qui vont permettre de juger une œuvre. D’ailleurs, on pourrait s’amuser à faire le compte de ce qui pourrait intégrer la base de données utile à juger d’une œuvre… objectivement. Il y aurait tellement de critères qu’il serait impossible d’y voir clair. Et certains éléments y seraient tellement opposés qu’il faudrait bien en privilégier certains par rapport à d’autres pour finalement déterminer une valeur à l’œuvre. Qu’est-ce qui pourrait alors choisir des critères qui auraient plus de valeur que d’autres sinon… la subjectivité. Est-ce que la moralité vaut plus que l’esthétique ? Est-ce que la technique vaut mieux que les intentions ? Est-ce que le savoir-faire vaut mieux que le cœur ? Est-ce que la musique vaut plus que les dialogues ? Est-ce que la profondeur de champ vaut plus qu’une image sans relief ? Est-ce qu’un panoramique vaut plus qu’un travelling ? Un gros plan plus qu’un plan d’ensemble ? Non, c’est impossible. Aucune objectivité possible.
Les caractères objectifs d’un jugement viennent à la suite d’une impression première, qui est, elle, subjective. On ne se sert de ce qui est objectif que pour rationaliser, expliquer ce qui est impalpable. C’est comme essayer de définir ce qu’on voit en regardant un arbre. « J’ai vu un arbre, je peux l’affirmer. » D’accord, mais entre ce qu’on a vu, ce qu’on exprime, et ce qu’on sait avoir vu, il y a un monde. On n’a pas vu « un arbre », on a vu un certain arbre, dans un certain contexte, qui avait telle ou telle forme, etc. Et au final, on ne peut, objectivement, traduire ça que par « j’ai vu un arbre ». Tous ceux qui ont vu le même arbre pourront dire qu’ils ont vu « un arbre », et le même, sans aucun doute, pourtant si on leur demande d’être plus précis, c’est là qu’on n’échappera pas à des références purement subjectives pour définir ce qu’ils ont vu. L’objectif sera toujours insuffisant pour exprimer une vision qui sera toujours personnelle. Donc une œuvre, on peut la montrer à différents individus, dans le même contexte, au même moment, ils y verront pourtant tous une œuvre différente. Vous pourrez encore une fois chercher à définir des critères communs, mais face aux perceptions personnelles, ces critères ne pourront servir qu’à confirmer une vision première. Il peut arriver que grâce à ces critères communs, on soit amenés à rejuger une œuvre, mais ce n’est pas parce qu’on se met tout à coup à adopter la même grille de lecture, mais juste parce que le souvenir de l’œuvre, sa perception, se voit modifié par un nouveau critère qu’on décide d’adopter (mais on peut très bien ne pas adhérer à tel ou tel nouveau critère ; là encore, ce ne sera qu’une question de perception, de goût, de valeurs, d’intérêts).
Rendre objectif ce qui est une expérience personnelle, c’est intéressant pour qu’on puisse comprendre chacun d’entre nous ce qui est au centre de nos propres préoccupations, intérêts, etc. C’est même une des dimensions les plus intéressantes dans l’art. Mais en aucun cas, on ne saurait parvenir à créer des critères de jugement objectifs valables pour tout le monde. Et c’est même en ça d’ailleurs que l’art est si vital pour l’homme. Parce que face à une œuvre, personne ne pourra nous imposer des critères objectifs. On aime, on adhère, on y trouve de l’intérêt, et personne ne pourra jamais être en mesure de nous dire qu’on a tort. En matière d’art, il n’y a ni raison ni vérité. Seule la liberté de percevoir, d’aimer, de comprendre, avec comme seul critère de jugement : nous-mêmes.
Un magicien, un artisan, un artiste, tout ça relève des mêmes principes. Une œuvre, c’est une illusion. Un artiste produit un numéro de cirque, et on ne sait rien du comment il y est parvenu. La seule chose qu’on sait, c’est si ça éveille en nous quelque chose, et si ça répond à nos attentes. Si un professeur devant ses élèves a un but, celui d’instruire ses élèves, si un homme politique a un but, celui de convaincre de ses qualités et de sa capacité à diriger, un magicien, un artisan ou un artiste, quand il propose un produit, une œuvre à un public, il peut avoir des buts différents tandis que son public viendra pour des motifs tout aussi différents. Mais ils se regroupent tous dans ce même principe de présentation. Que ce soit pour plaire, pour convaincre, pour amuser, voire pour instruire, magiciens, artisans ou artistes obéissent à la même chose : faire et montrer. Et puisque ce qu’on voit n’obéit qu’à notre seule subjectivité, tout n’est qu’illusion. Chacun a son petit numéro à faire, et chacun doit juger de son intérêt. Si ton grand artiste utilise l’illusion pour révéler le réel, reste que ce qu’il produit doit être jugé par un public, et que chaque spectateur est amené à juger de la pertinence de cette “révélation”. C’est tout l’intérêt du malentendu. Racine peut se tuer à écrire le meilleur des Phèdre possibles, ce sera tout à fait le droit du public de penser que si la pièce est une réussite, c’est grâce à la beauté envoûtante de l’interprète… C’est la différence entre un meuble Ikea et une pièce de Mozart. Fort heureusement, personne ne nous impose d’étudier un manuel pour y comprendre quelque chose ou pour pouvoir en jouir (ou pas).

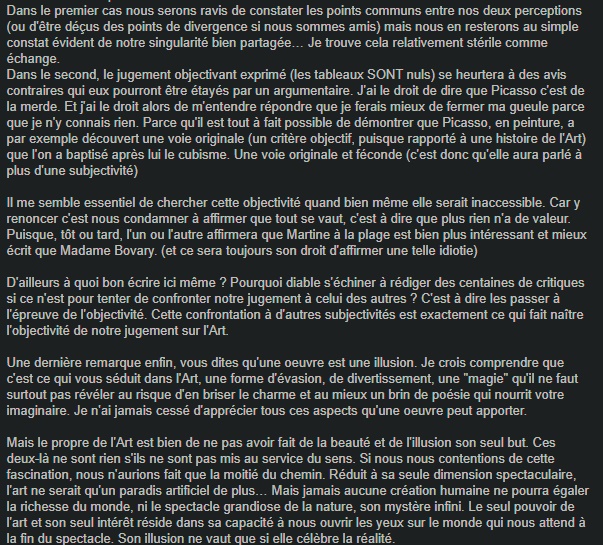
L’œuvre est invariable (et encore, quand on dispose d’autant de traduction de Shakespeare, par exemple, on se met encore plus à relativiser), mais ceux qui les voient, les commentent et les jugent restent des hommes. Il n’y a qu’en science et en droit qu’on peut établir une objectivité. En art, ça me paraît bien impossible. Parce que tout est point de vue, opinion, impression, goût, préférence.
Concernant la difficulté d’attribuer une valeur aux œuvres, il y a plusieurs choses. Chacun peut estimer selon ses goûts, intérêts, etc. que telle ou telle œuvre n’a pas de valeur à ses yeux. Mais ce n’est pas dire qu’on refuse de croire que cette œuvre puisse avoir une certaine valeur au regard de l’histoire ou d’autres spectateurs. Il y a une sorte de marché de l’art où certaines œuvres ou artistes sont cotés qu’ils le veuillent ou non, et ces valeurs fluctuent comme tout autre produit en fonction de l’intérêt porté à leur égard. Ça monte, ça descend, en fonction de critères se voulant rationnels, objectifs. En réalité, ces valeurs évoluent en fonction de phénomènes assez flous tout simplement parce que la valeur est ici plus une réputation qu’une marque de qualité réelle. C’est d’ailleurs pour ça que ces valeurs fluctuent. Ce n’est pas l’œuvre elle-même qui change, mais la perception qu’en a le public. C’est donc normal de voir au cours de l’histoire, des arts, des œuvres ou des artistes, passer de l’ombre à la lumière.
À l’époque de Florence, par exemple, la peinture n’était pas considérée comme un art majeur et de Vinci avait surtout l’ambition de se faire un nom dans les arts de la guerre. Il n’aurait jamais imaginé devenir célèbre pour ses peintures, voire ses croquis. On réévalue perpétuellement ce qu’on voit, lit ou regarde. L’œuvre reste la même, c’est exact, mais c’est bien notre perception qui change. Il n’y a donc aucune objectivité possible. Quand les valeurs, la morale, les références, les mœurs, les enjeux et les ambitions personnelles changent au gré des évolutions sociétales, c’est normal de voir la perception des œuvres changer. Et encore une fois, c’est une perception. Rien de rationnel, aucune possibilité de juger la valeur d’une œuvre en fonction de critères objectifs. Il y aura la valeur toute personnelle qu’on est prêt à donner à une œuvre ; et la valeur (qu’on connaît ou non, mais qui est toujours assez difficile à évaluer parce qu’elle ne dépend pas de nous, mais d’une connaissance ou non de la valeur générale qui lui est attribuée) d’une œuvre dans une culture, une société, un art.
Votre exemple de Picasso est intéressant. Il montre bien que la valeur de certaines œuvres (ou artistes) se fait après-coup. C’est comme en histoire. On réévalue sans cesse les événements en fonction de ce qu’on sait être venu après. La prise de la Bastille est-elle l’événement majeur de la révolution ? Non, c’est un symbole. Même chose pour Picasso ouvrant la voie au cubisme. Si on juge de la valeur des peintures rupestres de la grotte Chauvet, c’est moins pour sa qualité artistique (et on ne sait même pas si ça avait une fonction artistique ou spirituelle, sans doute les deux) que par son importance historique. Si on voulait juger objectivement d’une œuvre, il serait plus juste de juger de leur valeur artistique intrinsèque. À moins de juger que cela a un sens d’avoir comme critère de jugement, l’influence future d’une œuvre. Mais puisqu’on peut discuter de ce critère, c’est bien la preuve qu’aucun consensus sur les critères de jugement n’est possible, et donc qu’il n’y a aucune objectivité possible à attribuer une valeur juste à une œuvre. C’est même pour moi le propre même de l’art. Tout ce qui fait son intérêt, c’est qu’aucune autorité ne pourra nous imposer la valeur d’une œuvre. Elle s’impose à nous, ou elle s’impose dans un groupe comme canon, comme chef-d’œuvre admis. Et comme il n’y a pas qu’un groupe, mais une constellation de mouvements de pensée, de goûts, d’intérêts, de conceptions, eh bien, encore et toujours, personne ne pourra décréter au nom de tous que telle ou telle œuvre vaut plus qu’une autre.
« Non, mais, t’es sérieux ? Tu mets War of Warcraft au même niveau que la Joconde ? » Eh bien, oui. Je ne dis pas que moi, personnellement, je place un jeu au même niveau qu’une peinture. Je dis que l’objectivité, si elle est en soi impossible, elle nous dit une seule chose : que toutes les œuvres se valent. Parce que l’histoire montre que ce qui n’avait pas de valeur hier peut en avoir demain. Ce n’est rien d’autre d’ailleurs qu’une forme de démocratie. Est-ce que l’on dit objectivement que la droite est meilleure que la gauche ou inversement ? Non, on décide, personnellement, qu’à tel ou tel moment, l’un ou l’autre vaut mieux que sa voisine. Et on fait le compte. Un compte qui est remis en question à chaque élection. Objectivement, on ne peut pas dire que tel ou tel parti est meilleur qu’un autre, on décide juste qu’à tel moment, l’ensemble des juges-votants ont décidé d’une valeur. Ça ne veut pas dire qu’on partage l’avis général, mais au moins qu’on l’accepte… jusqu’au prochain vote. L’art, c’est une bourse aux œuvres qui tourne 24 h sur 24. À la clôture, tu as une valeur définie, mais on sait bien que cette valeur sera toute différente demain et après-demain. Il est là le relativisme. L’œuvre ne change pas. Il n’y a que la valeur qu’on lui donne qui change.
(Ajout 2023 : J’ajoute qu’il ne faudrait pas que ce principe « démocratique » de la valeur d’une œuvre à un instant t interdise cinéphiles ou étudiants en art notamment à étudier des œuvres, des mouvements ou des artistes. On finirait par ne plus étudier que ce qui est déjà connu et fait toujours consensus. Étudier ou défendre des pans mal connus de l’art, des artistes oubliés et délaissés, sans pour autant aller jusqu’à prétendre chercher à leur donner une place ou une valeur qu’ils ne peuvent avoir, cela permet tout aussi bien de mieux connaître ce que l’on connaît — ou croit déjà parfaitement connaître —, voire parfois de repenser et voir autrement nos connaissances. Puis, avec le temps, avec les modes qui passent, les intérêts ou les préoccupations qui évoluent en fonction des nouvelles époques, les consensus évoluent, les regards changent ou se lassent.)
Quant à l’intérêt de discuter ou de partager ? Eh bien, il est justement dans le plaisir de partager ses goûts, sa vision, se confronter à d’autres visions pour faire évoluer la sienne. Parce que le goût, c’est aussi un voyage. Et parce que tout le monde cherche, dans la bourse aux œuvres, à acheter une œuvre au plus bas prix. Pour cela, il faut être à l’affût, il faut influencer…
(Ce n’est pas ce que je voulais dire en parlant « d’illusion ».)