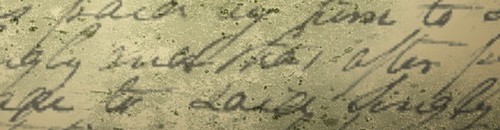Évocation et hommage

Le Professeur, Valerio Zurlini (1972) | Mondial Televisione Film, Adel Productions, Valoria Films
Après un mois de trêve olympique et démocratique imposée par le régent du pays, les médias sautent sur l’occasion opportune de la mort d’un monstre sacré du cinéma pour meubler l’espace informationnel pour parler de tout sauf du coup d’État des œillets (ou « œillères ») et des deux génocides en cours.
À force d’entendre ces hommages forcés (et bien qu’étant défenseur de la politique de la séparation entre l’homme et l’artiste), on comprend un peu de la psychologie des « élites » de ce pays qui ne sont qu’un assemblage de parvenus avec qui dès qu’on est « connu », il devient interdit de dire du mal sous peine d’être chassé de ce milieu des privilégiés (qui est pour certains une finalité plus que le goût de l’art).
On reconnaît la culture presque aristocratique (ou de tout autre parvenu) soucieux d’accueillir bien comme il faut n’importe quel dictateur random de la planète. Il en va des dictateurs, comme des criminels ou des connards manifestement.
Parce que s’il est vrai que Delon a été un monstre du cinéma, pour rendre hommage à ce qu’il laisse derrière lui, c’est de l’acteur, comme il aimait se définir (mais on s’en fout ou presque), qu’il fallait parler. Dans ces hommages, pourtant, on parle peu de l’acteur qu’on voit à l’écran, de l’artiste donc, de l’acteur. On ne parle que de l’homme. Or, l’homme était manifestement un connard. Typique des connards toxiques : un seigneur avec ceux qui l’ont aidé, une pourriture avec les autres qui auraient daigné lui faire de l’ombre.
Ainsi, Delon (l’homme), j’en ai rien à foutre. Il peut crever un jour où des millions d’autres partent dans l’indifférence ou sous les bombes, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je peux à la limite évoquer sa formidable présence dans de nombreux films, mais quelle portée cela pourrait avoir si les mensonges qui ne devraient jamais quitter l’écran débordent dans le monde réel pour faire de Delon (l’homme) un type qu’il n’était pas ? Il faut savoir : soit on rend hommage à des artistes, soit on rend hommage à des hommes. Si l’on rend hommage à des artistes, finissons-en avec ces interviews hagiographiques des parvenus ayant profité de son rayonnement ou de celles des quidams comme on le ferait à la mort de la reine d’Angleterre.
C’est sûr que si chaque fois qu’un artiste avec une personnalité problématique tire sa révérence, on ne parle que de l’homme et rarement de l’artiste, ça justifie pas mal la position de ceux qui sont scandalisés qu’on puisse ainsi rendre hommage à des connards (quand ce ne sont pas des criminels). Puisque, factuellement, c’est aussi ce qui se passe. Il y a une logique à diffuser des films, à faire des rétrospectives, à donner des prix pour récompenser une carrière ; beaucoup moins à faire du Voici en maquillant outrageusement la vérité pour faire de sombres connards des héros. Les légendes, elles sont à l’écran et elles ont vocation à y rester.
Les artistes seraient des saints qu’il serait tout aussi idiot de mettre en avant leur personnalité.
Alain Delon, l’acteur, n’est donc pas parti aujourd’hui. Non pas parce qu’il est éternel. Mais comme on serait incapable de citer le dernier film dans lequel il avait été inoubliable.
Dernière chose pour évoquer l’acteur et faire un petit point historique et technique. On oppose souvent Alain Delon à la nouvelle vague. En un sens, c’est assez vrai puisque ce sont deux cinémas qui ne se sont jamais rencontrés. Dans un autre, ces deux types de cinéma ont poussé vers la sortie un cinéma que certains qualifiaient de « cinéma de papa ». Et ce n’est pas forcément chez moi quelque chose de positif. Quand Alain Delon se vantait d’être un « acteur » et non un « comédien », en réalité, ces deux termes sont strictement identiques et interchangeables. Dans la bouche de Delon, cela signifiait qu’il ne « jouait pas », qu’il « était ». Une prétention qui ne veut pas dire grand-chose et qu’on ne pourrait retrouver que dans la bouche d’un type beau comme un dieu. Delon avait toutefois un quelque chose en plus, un talent inné, non pas pour « le jeu » (pas plus que pour « la vie »), mais pour évoluer et se présenter devant une caméra. Il y a des acteurs instinctifs qui disposent de tout le nécessaire dès qu’on leur met un texte entre les mains et qu’on les met en situation. Ce n’est pas « vivre », c’est comme ça, c’est inné. Delon était doublement privilégié : il était beau et il avait une présence.
Et là où Delon et la nouvelle vague pourraient éventuellement se retrouver, c’est donc que ces deux franges du cinéma français de l’époque qui se feront face pendant une décennie ou deux avaient exactement le même mépris pour le travail de techniciens de toutes sortes. À la nouvelle vague, on y détestait les scénaristes (invisibilisés), les décorateurs ou tout ce qu’ils pensaient altérait la « réalité » d’un film, dont un acteur issu soit de la scène, soit des productions passées. Chez Delon, c’était une haine pour la composition d’un personnage ou pour les artifices hérités d’un cinéma jugé de papa. Ce sont en réalité les deux faces différentes d’une même pièce : celle du mépris pour un savoir-faire qui à tort ou à raison avait fait son temps et attendait d’être dépoussiéré.
Il est intéressant de remarquer que si aux États-Unis, il y a eu une fascination des critiques et d’une nouvelle génération de cinéastes pour la nouvelle vague française, l’approche de Delon (qui est devenue, de fait, une norme en France, bien aidée par… l’héritage de la nouvelle vague) n’y a jamais fait son nid, ni même jamais probablement été évoquée (soit beau et tais-toi). La révolution de l’Actors Studio, donc de la method, donc d’un type de jeu hérité d’une logique de composition d’un personnage, s’était déjà faite depuis quelques années à Hollywood, et c’est elle qui, peu à peu, dans la seconde moitié du vingtième siècle, a débarrassé les plateaux de tournage des anciennes méthodes désormais obsolètes dans un cinéma plus « direct ». Quand on se morfond en voyant que certains « acteurs populaires » ont moins de prix que les autres, c’est au fond assez compréhensible. En France comme ailleurs, si vous jouez votre propre rôle (si vous « êtes », si vous ne « jouez » pas), pourquoi devrait-on estimer qu’il soit juste de vous récompenser par un prix ? Ah, oui, c’est le revers de la médaille… Et l’on en revient à la question de la séparation de l’homme et de l’artiste : pourquoi diable devrait-on se plaindre que Delon n’ait pas eu de prix (ou pas assez) s’il… ne jouait pas ? Vous fileriez des médailles à un tireur à gages, vous ?