Le soleil dans le caniveau
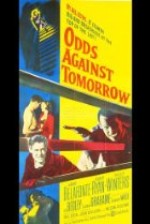
Le Coup de l’escalier
Titre original : Odds Against Tomorrow
Année : 1959
Réalisation : Robert Wise
Avec : Harry Belafonte, Robert Ryan, Gloria Grahame, Shelley Winters, Ed Begley
On sent poindre la fin du code Hays et le polar américain commence à avoir des envies d’extérieurs (même s’il y a des précédents, comme toujours : Sur les quais, En quatrième vitesse, c’est bien avant, comme les films de Jules Dassin).
La forme
Les passages entre extérieurs et intérieurs sont relativement bien exécutés : les plans de transition sont bien pensés dans les premières séquences de l’hôtel et les éléments sonores et visuels suggèrent parfaitement l’existence de l’extérieur (plan de l’entrée avec difficulté à fermer la porte, puis son du vent dans l’ascenseur). C’est peut-être moins convaincant sur l’ensemble des séquences prenant place chez la petite amie (regards dans la rue à travers la fenêtre, mais d’autres plans sentent parfois le renfermé, le studio, à cause sans doute d’un éclairage trop direct alors que la scène est censée profiter de la lumière du jour), mais face à des extérieurs si « crus » (impression renforcée par l’usage d’une pellicule spéciale), le film aurait pu souffrir d’un écart stylistique entre les deux zones.
Ce mix étrange et dangereux entre les espaces intérieurs et extérieurs apparaît également dans l’usage périlleux des transparences. Plus le cinéma répond à des exigences de réalisme et sort pour cela dans les rues, plus certains procédés tournés en studio peuvent vite tout gâcher. J’avais cité le film dans mon article sur l’évolution du procédé dans le cinéma hollywoodien :
« Robert Wise adopte ici une approche résolument réaliste (voire naturaliste) en choisissant de filmer une majeure partie de son film en extérieurs comme c’est devenu presque la règle dans les films criminels depuis 1955 avec En quatrième vitesse et Les Inconnus dans la ville. Reste la question de la manière de filmer ces séquences prenant place dans un véhicule. Robert Wise ici alterne le très bon et le moins bon. Débarrassé de dialogue, quand Robert Ryan se retrouve seul au volant, on y voit que du feu. Quand il place sa caméra à l’arrière et filme la route et les deux personnages au premier plan, la séquence semble bien avoir été filmée sur la route. Quand il fait croiser deux personnages, l’un dans une automobile, l’autre dans un bus, il place sa caméra dans le bus, aucune raison ici de passer par une transparence. Mais quand il convient alors de faire interagir deux acteurs, le charme n’opère plus et l’on devine assez facilement que Wise a dû avoir recours à une transparence qui jure forcément avec l’esthétique générale du film. »
(Wise continuera ses expérimentations pour se passer presque définitivement du procédé dans La Maison du diable, comme je le notais dans la page suivante de mon article.)


On peut par ailleurs remarquer un de tous premiers usages du zoom avant sa généralisation dans les années suivantes (surtout dans le cinéma italien). Dans cet article, il est question de zoom dans It, j’avoue ne pas me souvenir ; quoi qu’il en soit, le procédé existait déjà dans le cinéma muet, mais n’était pas employé autrement que pour divers effets vaguement expérimentaux (le procédé interdisant une netteté parfaite). Wise en fait un outil de contemplation, de scrutation en observant de loin en extérieur un personnage, puis en se rapprochant (ou le contraire). Cela deviendra une des marques du cinéma du Nouvel Hollywood (notamment chez Coppola).
Pour ces audaces formelles, Wise a fait appel à un directeur photo franco-américain, Joseph Brun qui avait déjà expérimenté le cinérama (la Cinémathèque avait projeté son film de 1955 : aucun intérêt).
Le fond
Pour le reste, on sent donc un petit parfum de fin de restrictions sous code Hays (en tout cas une volonté de jouer avec). Si les criminels meurent à la fin, et si le scénario ne ment pas sur les raisons qui conduisent ces individus à jouer leur vie (sur un coup de dé) dans un braquage, l’approche des acteurs et de Wise consiste aussi beaucoup à humaniser et à psychologiser, voire à socialiser ces pauvres gusses poussés à bout.
J’y vois d’ailleurs quelques accents identiques à ceux de Traqués dans la ville, vu récemment et réalisé par Pietro Germi en 1951, avec la différence notable que le film italien évoquait les conséquences d’un hold-up, tandis que le film de Wise s’applique au contraire à en étudier les causes.
Le plus torturé en ce sens se trouve être le personnage interprété magistralement par Robert Ryan : des trois acteurs, c’est peut-être celui qui rend son personnage le moins sympathique, mais son esprit semble agité par bien des tourments. Ancien détenu tombé pour meurtre, il reçoit chaque commentaire qui évoque son passé trouble comme une insulte, moins parce que cela ferait ressurgir chez lui un sentiment de culpabilité que parce que, étrangement, tuer lui aurait procuré du plaisir. Il serait seul à l’écran que ces élans psychiatriques répondraient aux attentes de l’air du temps et aux principes du code en ce qui concerne l’image des criminels à offrir au public. L’associer aux deux autres permet de voir ses névroses d’un œil neuf.
Un des trois est musicien noir, divorcé qui croule sous des dettes contractées en jouant aux courses et a maille à partir avec la mafia qui lui en réclame le remboursement. Comme une partie du film ne consiste pas du tout à préparer le casse comme on peut le voir dans les films du genre, mais à montrer le processus psychologique poussant les deux hommes à accepter la proposition d’un troisième, le récit passe de bonnes minutes à nous dévoiler les rapports familiaux qu’entretient le crooner avec sa femme et sa fille. On s’écarte des standards des criminels habituellement mis en scène dans les « crime films » servant la propagande du code. Nul doute que Ingram est un bon gars : chanteur dans un bar le soir, papa modèle profitant de son droit de visite pour passer du temps avec sa fille, s’il n’avait pas cette addiction au jeu, il appartiendrait au même monde petit-bourgeois que sa femme fréquente (même s’il fait mine de l’exécrer).
L’action prend place à New York, en 1959, on peut douter qu’un tel personnage ait pu exister ailleurs que sur la côte est et ouest dans les quartiers les plus progressistes du pays. Ce hiatus sert de moteur à l’intrigue, le personnage qu’interprète Robert Ryan étant originaire de l’Oklahoma et ouvertement raciste. Ce racisme ne propose pas une simple toile de fond au film, c’est un sujet à part entière qui hypothèque l’avenir crapuleux de leur association. (Soixante ans après, à l’heure du retour de Trump et du racisme décomplexé, cette thématique laisse un petit quelque chose d’amer… L’année précédente d’ailleurs, Stanley Kramer avait mis en scène La Chaîne avec Sidney Poitier et Tony Curtis qui possédait les mêmes caractéristiques de tensions et de violences racistes.)


Le troisième et dernier de la bande est peut-être celui dont on en saura le moins. On ne le verra jamais qu’accompagné des deux autres. Ancien flic, loin des stéréotypes de criminels sans passé uniquement mu par la cupidité et le vice, l’homme de loi a mal tourné après avoir été victime du système. Pour sortir de l’impasse et prendre sa revanche sur la vie, il pense avoir mis au point le coup parfait. Comme le titre du film en anglais l’indique, il y a un revers de la médaille au rêve américain : quand tu ne fais pas partie des gagnants, reste le mythe très américain qu’on peut jouer sa vie (et donc son avenir) sur un dernier coup. Le western et le film noir ont ce mythe en commun. Comme tous les mythes, il a une morale : si seul le succès importe, quand on appartient à la classe des perdants, il y a une forme de légitimité à tenter sa chance sur un dernier coup de dé…
Le code Hays à terre : les criminels agissent non parce qu’ils ont le vice qui coule dans leur veine (sinon, une fois qu’ils réussissent un coup, ils ne s’arrêteraient plus, comme Al Capone), mais parce que la misère les assaille, parce que si vous échouez, vous êtes déconsidéré, et parce qu’il est si facile en Amérique de jouer sa vie sur un ultime coup de dé (un indice sur les raisons de cela : les hold-up partagent cette caractéristique avec les tueries de masse). Ainsi, oui, ce chef de bande légèrement en retrait par rapport aux deux autres n’a pas grand-chose d’antipathique. On connaît vaguement son passé, mais Wise et son acteur en font un mec sympa. Un mec normal, normalement charcuté par la vie quand la chance a décidé de lui faire la peau.
Pourquoi tant d’humanité dans un film noir ? Nouvel indice : il a été écrit sous un prête-nom par Abraham Polonsky, le scénariste du chef-d’œuvre de Robert Hossen, Sang et Or, mais surtout blacklisté à Hollywood. Le flic de son histoire avait refusé de collaborer avec des enquêteurs fédéraux, ce que Polonsky avait précisément fait quand il refusa de témoigner à la commission des activités antiaméricaines en 1951.
Le dénouement n’a plus grand-chose à voir avec de l’humanité : la haine que se porte l’un et l’autre des braqueurs mènera littéralement à une explosion qui précipitera leur mort. Classiquement, dans le crime film, le finale se conclue par une course poursuite entre le malfaiteur et l’homme de loi. Ici, la débandade qui suit l’échec du hold-up est prétexte à ce que les deux ennemis règlent leurs comptes dans une scène de poursuite fatale.
(Wise se vante d’avoir fait changer la fin afin qu’elle soit plus noire alors qu’originellement, le Blanc et le Noir devait repartir bons potes. Sauf que je doute qu’une telle fin, à moins que ce soit un dernier geste d’apaisement avant leur mort, ait justement été acceptée sous code Hays. Le film devait déjà bien assez poser problème à la censure.)
À noter un excellent générique en phase avec les créations de Saul Bass (Wise fera appel à lui pour West Side Story), et une jolie introduction : beau ciel se reflétant dans un liquide ondulant et scintillant sous un grand soleil. Tant qu’il y aura des hommes ? Pas du tout. On éclaire la partie latérale de l’écran : il s’agit en fait d’une flaque courant le long d’un trottoir de New York. Après les transparences capricieuses, les apparences…
Le film s’achèvera d’ailleurs sur la même confusion. Après leur crime, tous les malfrats sont frits. Odd à la nuit.
Le Coup de l’escalier, Robert Wise (1959) Odds Against Tomorrow | HarBel Productions
Sur La Saveur des goûts amers :
Les Indispensables du cinéma 1959
Transparences et représentation des habitacles dans le cinéma américain
Liens externes :

























































