Ring Ring

Sang et Or
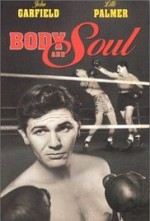
Titre original : Body and Soul
Année : 1947
Réalisation : Robert Rossen
Avec : John Garfield, Lilli Palmer
— TOP FILMS —
(Vingt ans que j’attends de voir ce film. Vingt ans que j’attends qu’il repasse à la TV. Vingt ans que j’en entends parler. Vingt ans qu’il est inscrit sur ma toute première liste de films à voir… Et le voilà enfin ! Il s’est fait désirer, mais quel bonheur ! C’est bien le chef-d’œuvre espéré.)
Dès le premier plan, on est plongé dans le bain et on sait qu’on a affaire à un grand film. On se croirait presque dans une introduction à la Citizen Kane : plan sur un ring, la caméra fait un mouvement à la fois de travelling avant et un panoramique ; apparaît dans le champ la baraque où dort héros boxeur, Charley Davis, derrière une grande baie vitrée ; on s’approche, et le boxeur se réveille après avoir murmuré : « Ben… » (On apprendra plus tard qu’il est mort et encore plus tard qu’il s’agissait de son entraîneur, symbole du boxeur déchu, vaincu plus par des rapaces que par son sport).
C’est le Rosebud de Charley Davis : la clé du problème, le sens caché de toute ambition, et pourtant il ne le comprendra qu’à la fin. Parce qu’on est bien à la fin, film noir oblige, on respecte le cahier des charges et on commence par un flashback. À la différence de Citizen Kane, Charley ne meurt pas aussitôt après : il se réveille et décide de boxer une dernière fois, pour lui, honnêtement. Le génie du film, il est là. Ce n’est pas un film sur la boxe, c’est un chef-d’œuvre noir qui a pour cadre la trajectoire individuelle et forcément tragique d’un de ces gladiateurs des temps modernes. C’est un film sur l’exploitation des hommes par d’autres hommes. Sur ces rapaces qui se nourrissent exclusivement d’argent. La boxe n’est qu’un contexte, un prétexte. Pourvu qu’il y ait un homme guidé par la revanche qu’il veut prendre sur la vie, par son arrogance, et pourvu qu’il y ait l’argent pour le corrompre. Charley s’est juré de gagner sa vie quoi qu’il arrive, parce qu’il ne supporte pas de voir son père vendre des bonbons et être au service du client. Pendant tout le film sa mère essaie de lui faire comprendre qu’il s’agit pourtant là d’un métier honorable. L’homme fier en quête de revanche…, victime idéale pour les plus vils rapaces.
Il y a dans le scénario une manière presque manichéenne de tirer les personnages vers le bien ou le mal. Charley, c’est l’homme fier et ambitieux, candide, qui ne voit pas le mal chez ceux qui l’entourent, pas plus qu’il ne voit la bonté sans failles de sa mère et de sa belle Peg. Si sa mère lui fait clairement la gueule à cause de ses choix, sans jamais être antipathique (et passer pour une sainte), on a peine à croire que sa petite amie lui offre si peu de résistance. Elle résiste en secret et finit par lui dire simplement : « C’est la boxe ou moi ». Moteur formidable pour le film. L’idée, c’est de limiter les conflits dans les dialogues à n’en plus finir et de tout mettre dans les basculements et les événements. Ainsi, elle apparaît elle aussi toujours sympathique. Sa famille, ses amis, ses proches en général, sont montrés comme des personnages aidants sans défauts. Pour le spectateur, ils doivent apparaître comme une voie de salut et de raison évidente. Ils sont tous critiques envers son mode de vie, ils comprennent ses dilemmes, mais ne l’affrontent pas, ne le jugent pas : quoi qu’il arrive, ils sont là pour l’aider même s’ils ne peuvent le soutenir dans tout ce qu’il fait. C’est presque une trame christique avec la rédemption qui devra venir à la fin. Manichéen à souhait, mais dans le bon sens du terme. L’homme face à son corrupteur (l’argent) et la voie juste (celle de ses proches qu’il ne veut pas entendre).



Comment juger un tel homme ? Il est crédule, assoiffé de reconnaissance, il en veut toujours plus. Excellente allégorie de la vie et merveilleuse illustration de ce que peut produire l’effet barnum au profit d’une dramaturgie : le besoin de reconnaissance de Charley, c’est la nôtre.
Comment vivre honnêtement sans se laisser corrompre par les nombreuses tentations ? Est-ce qu’on se laisse influencer par les bonnes personnes ? Est-ce que je suis entouré des personnes qui me veulent du bien ou sont-ils là pour ce que je représente et ce que je leur apporte (le personnage d’Alice à ce niveau est frappant : elle n’a qu’une utilité, profiter de Charley, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, et pourtant il n’y a que lui qui ne veut rien voir) ?
Donc non, non, pas un film sur la boxe. Ou au moins un film contre la boxe. Comme on réalise un film contre la drogue. Au début ça peut être beau, mais on finit toujours par y perdre. À l’image de l’entraîneur, on n’en réchappe pas sans des graves séquelles. Tout l’or du monde ne pourrait valoir ça. L’argent vous échappe aussitôt que vous n’êtes plus dans le coup. Et de l’autre côté, celui des corrupteurs, des profiteurs, il y a le monde de la magouille, les méthodes de paris foireux. Là encore, on reste à la surface des choses, parce que si ce n’est pas un film sur la boxe, ce n’est pas non plus un film sur la mafia. Tout le récit tourne autour de Charley, de ses choix, de ses erreurs, de ses dilemmes, de ses illusions. Tout ce qui gravite autour est anecdotique, ou ne doit avoir qu’un seul objectif : illustrer les failles du héros.
Les personnages sont donc tous des archétypes parce qu’on n’a pas besoin d’autre chose. Le conte produit des archétypes, les nanars enfantent des stéréotypes. Et Body and Soul est bien une fable. On ne cherche pas le réalisme, à rendre crédible une situation ou des relations. Est-ce que Faust est réaliste ? Non, c’est une allégorie. On a donc l’ami, dont le rôle est d’abord de suivre le héros, l’assister ; puis, il doit le mettre en garde de ce qu’on sait être inéluctable. Il finira tragiquement écrasé après avoir été lynché par les nouveaux managers de Charley. Il disparaît, tel un ange abattu par les démons de la tentation, tout comme le père de Charley déjà avait été tué : lui qui l’aidait en secret, mourra dans l’explosion de sa boutique de confiserie. Son père et son meilleur ami disparus, c’est à sa petite amie de le soutenir et de tenter de le ramener sur le bon chemin.


Rencontre improbable de la carpe et du lapin. On pense à Cerdan et Piaf. Les scènes de flirt entre les deux sont magnifiques. Elle ne se laisse pas facilement approcher. Elle aussi n’a d’utilité dans le récit que pour aider le héros, lui montrer la voie qu’il persiste à ne pas vouloir suivre (on sent avec le procédé du flashback que tout est tracé, qu’il est embarqué comme dans un train fantôme sans pouvoir y échapper, tout le monde lui dit de sortir mais lui trace son chemin, obsédé par « ce qui brille »). Le choix de l’actrice était primordial, et il est réussi : il y a une forme de candeur dans le jeu de Lilli Palmer, une bienveillance qui ne peut exister qu’au cinéma (on ne s’embarrasse pas de réalisme : tout tourne autour du héros, donc quand il revient la voir après plusieurs années — comme tous les ans en fait avec un nouveau prétexte pour la voir — un peu de réalisme aurait voulu qu’elle ait un homme ou au moins que les personnages abordent la question ; là non, c’est un ange qui ne vit que pour Charley). L’entente de la mère de Charley avec sa bru est tout aussi caractéristique : aucun conflit entre elles, tout au contraire, elles sont tout entières tournées vers le bien-être de Charley.
Autre personnage typique du film de boxe : l’entraîneur, usé par une grave blessure qui peut le tuer à tout moment. Il accepte de travailler pour Charley après que celui-ci lui a pris son titre de champion du monde… Et il restera fidèle à son poulain, jusqu’au bout, sans jamais s’opposer violemment à ses choix (c’est d’ailleurs parce qu’ils sont tous gentils que Charley ne voit pas qu’il fait fausse route ; il n’arrivera à lui faire comprendre qu’en lui foutant des beignes dans la poire). Dernier personnage “aidant” : le manager. On le voit peu, mais il a deux scènes cruciales : l’une où il se retrouve au milieu du plan dans un train alors que ce sont les autres qui tournent autour. Il faut voir le jeu de regard de l’acteur à cet instant (génial William Conrad, que les gamins de ma génération ont connu en regardant la série La loi est la loi). Et une autre scène, celle du combat final où subrepticement, on le voit suggérer à Charley que s’il veut casser le deal, il peut… Tout le monde lui veut du bien, sauf lui-même et cette espèce de Méphistophélès qui lui tourne autour.
Le récit profite au mieux des situations en en tirant toujours le maximum. Ça se remarque dans la qualité des dialogues, mais aussi dans le choix de certaines scènes et événements. Pour faire avancer l’action, un scénariste peut toujours se contenter de la scène qui va de soi : la « scène attendue » comme on dit dans les manuels de dramaturgie. Là, il y a bien les scènes “attendues”, mais il tire toujours le meilleur de ses situations. Quand il faut trouver une raison pour laquelle Charley après avoir accepté « de se coucher », pour faire volte-face, un personnage débarque chez sa mère et lui dit que tout le quartier a parié sur lui. Il lui dit que ce n’est pas sérieux, mais l’autre insiste et la réplique qui tue avant de partir : « alors que les nazis massacrent les gens comme nous (Charley est juif), toi tu nous rends notre fierté, ici en Amérique ». On est en 1947, donc on sait que les juifs n’étaient pas seulement victimes de ségrégation, mais étaient exterminés… Effet garanti (même si le temps du récit est avant la guerre, peu importe, même avant, cette réplique aurait fait mouche). Ou encore l’idée si symbolique du portrait de Peg accroché derrière le meuble à bar, qui y restera plusieurs années, sans que le meuble à bar ne soit retourné…, symbole d’une époque révolue. Des détails qui seraient des erreurs dans une histoire banale où viendraient s’incruster toujours un peu trop facilement des personnages pour faire avancer l’action. Seulement voilà, aucun doute possible ici, le reste étant parfaitement maîtrisé : ce ne sont pas des erreurs ou des facilités, mais un usage à dessein des archétypes du genre.
Au niveau de la réalisation, je l’ai déjà dit, c’est propre. Rossen arrive à créer une atmosphère de conte en tournant tout en studio la plupart du temps ou en totalité. Parfois c’est évident (bar, boutique, toit). Les espaces sont resserrés, donnant une impression de cocon qui écrase sans doute Charley, lui qui a besoin de bouger. Chaque objet semble être à sa place : le décor est surchargé, au point parfois, que sur les murs, on ne laisse aucun espace libre. Même dans les rues, il faut mettre une grille pour donner du relief, pour donner une impression d’abondance organisée…
Magnifique.

Sang et Or, Robert Rossen 1947 Body and Soul | Enterprise Productions

