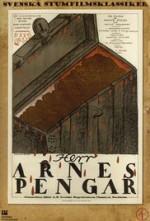Jeu sonore.

Bruit de la brosse post-synchronisé avec son du volet ouvert hors-champ par le soldat
Les voix postsynchronisées donnent l’immédiate impression d’un espace composé qui, s’il est au moins dichotomique, laisse supposer qu’il peut être infini. Même si le spectateur a conscience de la fausseté du procédé, il en accepte le principe, et la cohérence des raccords sonores images-sons ne le poussera de toute façon pas à sortir du film. Le procédé produit un effet étrange d’intériorité. Surtout, on retrouve une autre dualité de niveau qui comme en musique permet de les faire dialoguer à travers un jeu d’alliance, d’opposition ou de superposition : un « dans le champ » (ici espace visuel) et un « hors-champ » (ici espace sonore). Tout bruit anodin « faisant vrai » est effacé : le contexte, le hors-champ, l’ambiance, ce n’est pas du « bruit » ; la « piste » mélodique de contextualisation est toujours signifiante. Comme la musique, on ne sait jamais trop bien ce dont il est question, mais la cohérence s’impose d’elle-même. Un bruit sonore ne dit rien. On voit déjà (même si la postsynchronisation, dans les films de cette époque, passe pour une facilité technique — il était très difficile de faire des prises directes en dehors des plateaux sans avoir justement un « bruit » épouvantable) qu’ici, la contextualisation est gagnée à travers une restriction, un rétrécissement de la réalité, une sélection, un choix (on le remarque, la contextualisation est toujours affaire de discrimination, de choix, de préférence).

Bruits de détonation au loin et hors-champ : le soldat se retourne
Dialogues.
Beaucoup de personnages parlent hors champ, c’est-à-dire en dehors du champ de la caméra, mais dans le même espace scénique (pas de voix off). Si l’on peut imaginer que cela relève aussi parfois d’un impératif de montage pour éviter, du fait de la postsynchronisation les faux raccords sonores, l’effet produit est, là encore, efficace : une voix hors champ, cela enrichit… le hors-champ. Et pendant ce temps, qu’est-ce qu’on fait ? On regarde autre chose. Un quelque chose, là encore et toujours, qui doit rester signifiant. Non pas que ce qu’on regarde doive avoir un intérêt particulier, mais quelque chose doit se passer, doit être montré : un personnage qui s’assoie, qui écoute, qui prend une cigarette, qui s’éloigne, qui cherche quelque chose…, il est actif et le spectateur l’est avec lui. Deux espaces se jouent là encore : l’espace sonore (ou des dialogues) hors-champ et l’espace visuel du champ. Les deux se répondent et produisent ensemble l’univers commun et cohérent recherché.
La parole évocatrice.
Comme en littérature, le verbe s’avère prépondérant, parce que la seule puissance d’une phrase peut évoquer mille détails plus ou moins signifiants. Le principe des dialogues, et c’est surtout vrai au théâtre où le travail sur la contextualisation a toujours dominé d’autres aspects de la pièce du fait des restrictions spatiales, c’est de ne pas surjouer la trame et de proposer autre chose en brodant par-dessus une matière contextuelle d’une richesse sans fin puisque la force du langage, c’est d’évoquer ce qui n’est pas présent. Montrer un personnage servir un verre à un quelqu’un et lui faire dire « tu en veux ? », c’est surjouer, c’est jouer deux fois la même idée, c’est donner de l’importance à une idée qui n’en a aucune. Harmonie et mélodie racontent la même chose et se superposent pour annihiler toute possibilité d’un ailleurs. Les deux ne doivent se rencontrer qu’à des moments clés pour souligner les virages dramatiques ; le reste du temps, il faut se tenir à l’idée que l’image raconte une chose et que les dialogues en racontent une autre. Ils peuvent évoquer des événements passés, l’intention ou les désirs des personnages à agir, évoquer un espace lointain ou juste là dans l’autre pièce (si la langue ne permet pas d’illustrer comme pour le temps, un espace plus ou moins lointain, eh ben, c’est… le contexte qui suggérera proximité ou éloignement), ou bien encore évoquer un objet (qu’on a déjà ou qu’on verra bientôt dans le champ). Cela peut paraître accessoire, mais ça concourt énormément à se représenter un univers à partir de petites graines prêtes à germer lancées à l’attention du spectateur. Ça donne l’impression qu’il y a un ailleurs cohérent qui dispose de sa propre vie, et c’est ce monde-là qu’il est important de suggérer en en évoquant des éléments en permanence. L’accessoire ne se trouve pas forcément là où on le croit. L’assemblage de détails en apparence anodins crée toute une panoplie d’éléments qui, assemblés, donnent une impression de réalité bien plus que les rapports souvent figés et prévisibles des personnages.
Objectifs de jeu et vie propre des corps.
L’acteur s’applique à aller au-delà de la simple retranscription d’une réplique ou d’une humeur. Avant que le cinéma apparaisse et modifie la perception et les exigences de cohérence du spectateur, les acteurs se contentaient de déclamer leur texte à la manière des chanteurs d’opéra, et le jeu corporel et scénique avait comme objectif de proposer à l’œil du spectateur une suite de tableaux visant à illustrer grossièrement et pompeusement la situation induite par la pièce (on retrouvera au cinéma cette influence avec la pantomime). Tout a changé au tournant du nouveau siècle quand Stanislavski a mis en scène les pièces de Tchekhov. Parmi les nombreux procédés pratiques que compte la méthode du metteur en scène, un était essentiel : la nécessité pour l’acteur de se fixer des objectifs. À chaque instant, un acteur doit savoir ce qu’il fait sur un plateau. Par la psychologie et par sa traduction corporelle, l’acteur propose ainsi une forme de sous-texte en cohérence avec les objectifs généraux de son personnage et qui enrichissent considérablement la matière donnée à voir au spectateur. Dans la tradition française, au théâtre comme au cinéma, on néglige souvent cet aspect (quand on ne l’ignore pas totalement) en se contentant de « jouer le texte ». Ce n’est pas le cas de nombre de productions de l’Est. Paradoxalement, quand les acteurs et le metteur en scène donnent trop à voir, cela peut tourner à du théâtre filmé (souvent d’ailleurs lors d’adaptation de pièces), mais d’autres fois comme ici, le film comptant assez peu de scènes à personnages multiples et les deux personnages principaux ne parlant pas la même langue, c’est une impression de fort naturalisme et de justesse qui se traduit à l’écran. L’histoire qui ne se traduit pas à travers des mots doit bien être reproduite quelque part. Le spectateur est bien plus susceptible de se représenter un personnage « en dehors du cadre et de l’action » si l’acteur parvient à retranscrire dans son jeu une forme de continuité et de logique dans son comportement : il est capable non seulement de jouer le premier niveau de lecture imposé par la situation, mais des humeurs, des intentions, plus générales, ou au contraire parfaitement passagères et anecdotiques. Un personnage qui coupe du bois, un autre qui ramasse des feuilles mortes, etc. des personnages possédant une vie propre (ou en donnant l’impression) donnent une matière précieuse au spectateur pour qu’il vienne à imaginer le contexte dans lequel les personnages évoluent. (Je n’insiste pas là encore sur l’évidence d’une opposition entre deux niveaux, le jeu dramatique dont les constituants font avancer la situation et la trame, et le jeu « d’ambiance », plus à même de provoquer une impression de réalité ; leur dialogue aidant le spectateur à se représenter un monde riche et signifiant.)

Vue depuis l’intérieur vers l’extérieur
Longues focales.
L’intérêt des petites focales, c’est de proposer à l’intérieur du champ tous les éléments constitutifs de l’histoire, comme on le ferait dans un tableau. Le hors-champ est alors pratiquement inexistant. Au contraire, l’utilisation des longues focales permet de se concentrer sur un espace donné, et par la même occasion, d’augmenter l’importance du hors-champ (sans compter les flous qui apparaissent à l’écran et qui sont de petites taches de hors-champ dans le cadre). Dès que l’on propose une focale plus longue que celle de la vision humaine, on fait le choix d’insister sur un élément de décor, un personnage, et cela bien sûr en discriminant le reste. Le hors-champ est presque alors induit par la « focalisation » en direction de ces éléments, et comme toujours, un dialogue s’effectue entre ce qu’on montre et ce qu’on cache. Et souvent même, ce qu’on cache, c’est la perception d’un personnage regardant un autre. Avant même qu’on vienne à proposer le contrechamp du personnage en train de regarder, la longue focale suggère déjà qu’on a affaire à une vue subjective d’un personnage (ou d’un narrateur). Dans le film, le personnage masculin observera une fois au loin le personnage féminin avec des jumelles ; le reste du temps, avec les mêmes focales, ces effets permettent d’insister sur l’opposition des deux personnages. Entre celui qui regarde et qui désire, et celle qui se laisse regarder sans trop de plaisir et qui cherche plus ou moins à échapper à ce regard (elle pourrait aussi en jouer pour prendre l’autre à son propre piège). Le hors-champ, ici, représente moins un univers recomposé extérieur que l’opposition psychologique (donc intérieure) entre les deux protagonistes. Avec des focales plus courtes, le champ retranscrirait plus les personnages dans un même espace et peinerait à suggérer leur opposition à travers ces champs-contrechamps sans dialogues. Ne parlant pas la même langue, leur histoire s’écrit principalement à travers un jeu de regards ou de présences se répondant l’un et l’autre. On imagine moins le monde au-delà du manoir où se concentre notre histoire que le monde intérieur fait de pensées, de désirs, d’intentions, feintes ou cachées, des personnages.



Découpage/remontage.
Quand on opte pour des grandes focales et que l’espace se réduit, on peut encore accentuer l’impression de hors-champ à travers le montage. Un plan fixe en grande focale, on a beau être plein de bonne volonté, on finit par se lasser de devoir nous représenter un monde hors champ si l’on ne nous le livre pas au regard de temps en temps… Les champs-contrechamps bien sûr, mais aussi et surtout les plans de coupe ou les ellipses. Le découpage tranche, provoque un choix, et le montage assemble, et produit un dialogue entre les images. Plan après plan, le montage vise ainsi à nous dévoiler un espace sous divers angles. Bribes après bribes, l’univers fragmenté prend peu à peu corps dans notre esprit. Comme pour le reste, la difficulté réside dans la capacité à proposer une matière au regard. Un seul espace comme un manoir, ça peut paraître à la fois grand comme très petit si l’on ne sait pas où placer sa caméra ; le tout est de se situer à la distance adéquate et de varier les éléments du décor apparaissant dans le champ. Trop éloigné et l’on a une bonne vision d’ensemble, mais on peine à y entrer et l’on peut se lasser de voir toujours la même chose ; trop près, et l’on peine à reconstituer un espace cohérent en dehors du champ. Les ellipses à la fois temporelles et spatiales permettent de vagabonder en dévoilant les différentes pièces d’un puzzle de hors-champ, et de passer directement à l’essentiel (montrer un personnage passer cent fois le même vestibule a un intérêt limité et aide assez peu à se représenter l’espace). Le découpage est une manière de disposer dans un espace inconnu (le hors-champ) des petits cailloux lumineux (champ) pour ne pas s’y perdre. Les plans de transitions, courts montages-séquences, permettent aussi à l’extrême d’évoquer très brièvement un espace et une époque (il y a bien un hors-champ temporel comme il y a un hors-champ psychologique) et de laisser le spectateur utiliser sa logique pour en reconstituer la cohérence. À chaque séquence, c’est comme une nouvelle situation à découvrir, un territoire « hors champ » qu’il va falloir appréhender. Si la situation évolue sur la trame de l’histoire, elle éclaire à sa suite tout un espace cohérent dans lequel plonge le spectateur ; si tout est statique et répétitif, la cohérence s’effrite, et l’imagination claudique.
Inserts illustratifs
Passage hors/dans le cadre.
Si l’on peut changer de plan pour donner à voir et pour faire passer ce qui était alors hors champ dans le champ (et représenter ainsi un univers qui se reconstitue par le montage), il devient possible, dans le même plan, de suggérer la présence de cet espace hors champ en multipliant les va-et-vient dans le cadre. Un personnage qui entre dans le cadre traîne avec lui la part de mystère du hors-champ, et un personnage qui sort du cadre et c’est le spectateur qui s’imagine alors ce qu’il peut bien y faire… Pas la peine parfois de sortir physiquement du cadre pour suggérer le hors-champ : le simple fait de voir un personnage regarder ailleurs enduit le hors-champ (et ce n’est pas seulement valable pour les regards vagues au loin : un regard porté sur un personnage ou un objet hors cadre, mais dans le même lieu suffit — dans ce cas, au regard porté à l’extérieur du cadre, on répondra par le montage en proposant le « contrechamp »). Au début du cinéma, on pensait qu’il fallait tout retranscrire dans le champ comme sur une scène de théâtre ou dans un tableau vivant : quand on entrait dans le champ, c’était dans la profondeur, depuis les coulisses (une porte). Et puis, l’école de Brighton est passée par là, et dans leurs films de poursuite, on a commencé à voir des personnages entrer et sortir du champ (ces cinéastes ont d’ailleurs pratiquement tout inventé en matière de hors-champ et de montage). Le procédé s’avère tellement simple et évident que l’on ignore peut-être sa réelle efficacité à suggérer un espace qu’on ne voit pas, mais que l’on imagine. Pour renforcer la contextualisation, on peut donc multiplier les allées et venues, puis varier avec des panoramiques qui dévoileront une part du hors-champ.
Préférence marquée pour deux niveaux de grosseur de plan rapprochés.
Plan rapproché avec panoramique d’accompagnement sur personnage actif (un seul plan, l’autre personnage temporairement hors-champ).
La particularité de la mise en scène de Vlacil, dont les effets peuvent être plus subtils et plus discutables, c’est de se restreindre le plus souvent à deux niveaux (encore et toujours) de grosseur de plan. Des positions assez intermédiaires pour ne pas être extrêmes (façon western spaghetti), mais assez éloignées l’une de l’autre pour pouvoir se répondre : à l’extrême, on trouvera des plans moyens très rapprochés (rarement en pied) et des plans rapprochés allant rarement jusqu’au gros plan. Monter l’un après l’autre deux plans à la même échelle, on peut imaginer en effet que les plans ne se répondent pas, un peu comme deux lignes parallèles vouées à ne jamais se rencontrer et possédant, l’une et l’autre, leur propre spectre (comme deux hors-champ jamais amenés à se rencontrer pour créer une cohérence d’ensemble). L’intérêt des plans rapprochés, c’est de pouvoir s’en servir là où d’habitude on aurait tendance plus souvent à utiliser un plan plus large ; c’est le panoramique qui rend cela possible. Le panoramique permet d’accompagner un personnage, et de le laisser sortir du cadre pour s’intéresser à autre chose… L’échelle de grosseur de plan varie ainsi souvent en fonction des mouvements de personnages et des panoramiques, mais en restant toujours dans ce cadre restreint. La caméra semble butiner d’un élément à un autre, balayant du même coup le hors-champ pour l’intégrer au champ (du moins dans ce qu’on imagine au second plan), et l’effet produit est une fausse impression de vérité et d’improvisation, car quand la caméra se détourne, c’est rarement pour proposer un élément peu significatif ou répétitif. Les rares plans moyens en pied, plus fixes (mais ne s’interdisant pas au bout d’un moment à proposer un panoramique pour suivre un personnage qui se décide à bouger et pour casser avec l’impression de plan maître, jamais bien créatif) peuvent répondre aux plans plus rapprochés, comme une respiration, ou une mise à distance par rapport aux sujets. Une manière, comme après un point, de repartir sur autre chose, ou de varier rime féminine et masculine, jouer sur les oppositions encore et toujours… Le paradoxe, c’est qu’en gardant ces grandes focales, les plans moyens tendent à se concentrer sur ce qu’ils décrivent (d’autant plus encore une fois qu’ils sont rarement pris réellement en pied, naviguant entre petit plan moyen, franc plan américain, voire à se transformer tout bonnement en plan rapproché). D’une certaine manière, les plans moyens interrogent l’œil du spectateur en l’invitant à se rapprocher quand les plans rapprochés tendent plus à être une confirmation ou un développement de nos interrogations (posez une question, et il en ressortira mille autres au lieu de répondre à la première). Ces échelles de plan à la fois strictes et fluctuantes permettent une grande invention à l’intérieur des plans et arriveraient presque à nous convaincre de l’inutilité d’un montage de divers plans fixes.
↓ Plans rapprochés avec geste signifiant d’illustration et d’ambiance ↑
Champ-contrechamp en plan moyen américain
Deux exemples pour illustrer l’emploi astucieux de la caméra. Quand le soldat arrive dans une salle de bains du manoir et découvre le corps criblé de balles de l’officier, on change d’axe (même grosseur de plan), on le suit en panoramique alors qu’il passe hors-champ dans la pièce d’à côté, et on le retrouve dans le champ à la fin du panoramique en l’ayant suivi hors-champ (dernier petit coup d’œil vers le corps sur le sol pour restituer parfaitement l’espace via un raccord de regard). Une manière, à un moment critique, de prendre à la fois de la distance avec lui et de se rapprocher de notre propre imagination. La caméra restant, elle, dans la salle de bains, et restituant à l’écran le mur derrière lequel on imagine le personnage troublé par ce qu’il vient de découvrir, on peut aussi interpréter ce procédé comme la volonté du cinéaste de suggérer à l’image que son personnage veut fuir sans trouver d’issue… Le hors-champ devient dans ce panoramique précisément ce qu’on voit à l’écran.






 Année : 1949
Année : 1949