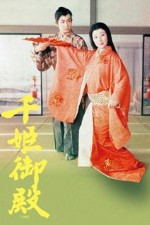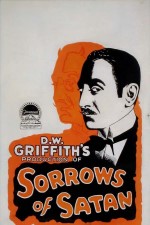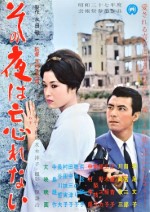L’art est-il cyclique ?
L’art, comme l’histoire, est-il cyclique ? Probablement pas. Du moins, pas en partie. C’est d’abord sans doute une vue de l’esprit, mais puisque c’est aussi une vue des esprits qui décident des choses de leur temps, il est probable que la perception qu’on se fait de son époque vienne à vouloir y répondre en prenant le contre-pied des usages alors en vigueur, initiant ainsi des mouvements contraires et un nouveau cycle.
Parmi ces modèles cycliques, le plus évident est peut-être celui de la Contre-Réforme. Après la Réforme et l’austérité du protestantisme, l’Église se lance dans une contre-attaque qui sera la Contre-Réforme : l’opulence répond à l’austérité, l’art baroque apparaît. Réforme/Contre-Réforme, un enfant de quatre ans peut comprendre la logique.
Selon le même principe, on parle parfois d’époque fin-de-siècle, et tout particulièrement au cinéma, on distingue une forme de classicisme imposé par les studios (notamment la MGM) dès l’époque du muet. Viennent ensuite les quelques avancées libérales en matière de mœurs et les scandales à Hollywood : c’est ce qu’on appellera plus tard, la période pré-code. Puis le code Hays sera appliqué au milieu des années 30 jusque dans les années 60 tout en étant de moins en moins suivi au fil des décennies. Les années 60 marquent une époque de crise des studios que certains qualifieront de « Hollywood décadent ». Le Nouvel Hollywood donnera un nouvel élan au cinéma américain avec une approche à la fois plus réaliste et tout aussi brutale. Cette période sera à son tour marquée par une sorte de tournant contraire quand ce cinéma jugé trop sombre par une poignée de réalisateurs, tels que Spielberg ou Lucas, s’adressera davantage aux adolescents soucieux de trouver dans les salles des divertissements enthousiasmants, pleins de fantaisies et d’optimisme. Une norme qui a encore cours actuellement.
Il n’y a donc pas de cycle…, mais force est de constater qu’un certain esprit de contradiction souffle souvent entre les générations et que par voie de conséquence, on est bien tenté de ne plus voir que ce qui jure par rapport à ce qui précède en regardant certains films hollywoodiens du milieu des années 50. L’ambiance fin-de-siècle, elle semble avoir en réalité touché Hollywood en plein milieu du siècle… Tourné juste avant La Fille sur la balançoire, on n’était déjà pas loin d’un frétillement (baroque) avec Les Inconnus dans la ville du même Fleischer : il y a quelque chose dans l’air qui laisse penser que quelque chose est en train de changer, quelque chose qui annonce les dérives ou les incompréhensions des années de crise qui suivront, et quelque chose qui semble donc répéter un schéma éprouvé :
Excès/Décadence/Réforme/Austérité/Contre-réforme/Excès/Décadence…
Et cela semble s’appliquer à pas mal de choses : les libertés sexuelles, les mouvements en art, la morale civile ou religieuse, les modes vestimentaires, etc. Bien sûr, toutes ces perceptions sont souvent un peu forcées, mais quand ces « mouvements » viennent aussi parfois explicitement en réaction à un usage devenu obsolète, on ne peut pas les ignorer.

« Prête à vous envoyer en l’air ? »
Assiste-t-on pour autant à une réaction volontaire à l’austérité appliquée depuis le milieu des années 30 à Hollywood avec ces deux films de Fleischer ? Certainement pas. La réaction sera beaucoup plus marquée quelques mois plus tard en France avec la nouvelle vague, en réaction, non pas à un code qui ne s’applique pas à son industrie, mais à une « qualité française » dont on peut toutefois reconnaître des similitudes formelles avec le cinéma de la même époque à Hollywood.
Mais c’est peut-être quand ces mouvements sont involontaires qu’ils sont peut-être les plus intéressants à décrypter. Parce qu’au milieu des années 50, si Hollywood fait le diagnostic qu’une réforme est nécessaire, il ne fait pas forcément toujours les bons choix ou ne reconnaît pas forcément son principal concurrent : la télévision était peut-être moins à craindre que l’émergence de nouvelles cinématographies venues d’Europe ou du Japon. Au lieu d’aller vers plus de simplicité, plus de réalisme (pourtant initiés par certains acteurs de la scène new-yorkaise, mais vite chassés comme des sorcières), Hollywood fera bientôt le choix des outrances. Ce sera rococo party. En dix ans, on basculera peu à peu des audaces acidulées des Plaisirs de l’enfer aux excès grotesques de La Vallée des poupées, et de La Vallée des poupées aux surenchères parodiques (ou pas) de Beyond the Valley of the Dolls.
En 1955, on n’en est pas encore là. La Fille sur la balançoire précède de deux ans Les Plaisirs de l’enfer. Tous deux restent donc dans les clous. Mais Hollywood est en train de créer sans le savoir les conditions qui favoriseront ses échecs futurs… tout en tendant la main à quelques cinéastes (puisque tout désormais devra passer par eux) qui auront les clés pour sortir de l’impasse dans les années 70.
Fait notable : contrairement aux Inconnus dans la ville, La Fille sur la balançoire n’est pas un film contemporain. Il raconte l’histoire vraie, sordide, d’un fait divers ayant fait la une des journaux au début du siècle. Le film est donc réalisé à une époque où on sent le classicisme, ses codes, ses usages commencer à se fracturer. Mais le fait de raconter une histoire pleine de brutalité prenant place à une époque qui illustre un moment charnière d’une époque qui basculera bientôt dans la guerre ne fait que renforcer, comme en écho, cette impression que ce sont les années 50 et toute la haute société américaine qui pourraient imploser comme elle l’avait fait un demi-siècle plus tôt.
La Belle Époque sur la côte est des États-Unis n’est peut-être pas la Belle Époque qu’on a connue à Paris, mais telle qu’elle nous est représentée dans le film, ça y ressemble… Ce petit parfum de scandale permanent qui amusait encore jusqu’à la fin du siècle qui précède quand des hommes riches et célèbres s’affichaient avec des horizontales, des demi-mondaines, des comédiennes qu’on prenait pour maîtresses et qu’on entretenait, quand ces petits arrangements entre dominants/dominés poussent au crime, cela ne fait plus beaucoup rire grand-monde ; et la société semble découvrir à l’occasion d’un grand déballage et d’un procès toute la vulgarité et les outrances de son époque (et de ses élites). Derrière le parfum vulgaire des cocottes, c’est toute la misère humaine qui finit par vous claquer d’un coup à la figure.
Parler de cocottes n’a peut-être pas de sens appliqué à la société new-yorkaise de la Belle Époque, on évoquera alors plutôt les Gibson Girls, mais leur sort était probablement identique. Avec la guerre, au moins en apparence, ce sera une tout autre société (avec ses nouveaux usages, ses nouvelles modes) qui s’imposera. (Et avant que les Ziegfeld Girls, showgirls ou chorus girls prennent le relais.)
Cette ambiance « fin-de-siècle » bavant jusqu’au milieu des années de la première décennie du siècle, avec ses outrances d’une époque qui ne peut plus cacher ses limites, les outrances de ses élites, ses hypocrisies et ses destins brisés, c’est un peu l’ambiance qui commence à poindre à Hollywood au milieu des années 50, et c’était déjà celle des années 20 jusqu’à l’application du « code ».
(Et c’est un peu celle que l’on connaît aujourd’hui, parfois dépeinte, encore timidement, dans la fiction, qu’elle soit volontaire — comme dans Don’t Look Up, The Boys ou Extrapolations — ou involontaire — comme dans Matrix Resurrections, Avatar 2, Star Wars : L’Ascension de Skywalker, Doctor Sleep, Once Upon a Time in… Hollywood, Le Loup de Wall Street… Reste à savoir jusqu’où on peut aller dans les outrances, la surenchère, la répétition, avant que quelque chose de réellement neuf apparaisse et amorce un nouveau tournant…)

« Juste un doigt ? »
En 1955, le classicisme a fait son temps. Les thrillers se font désormais en couleurs ; le Cinémascope s’impose aux séries B ; et Fleischer dévoile même dans son premier film une passion adultérine sans que cela fasse des deux amants pour autant des criminels (Child of Divorce). Ce que certains appellent « modernité » pointe le bout de son nez. Aldrich, Fuller et donc un peu Fleischer donnent les clés qui ouvriront les portes d’un cinéma sans limites. Pourtant, chez Fleischer en tout cas, ce que certains appellent modernité, je m’amuserais plutôt à décrire ça comme étant du « baroque ». Fini, la mesure du classicisme, la mise à l’honneur des bonnes âmes (surtout quand elles appartiennent à la classe supérieure) ; fini, les dérives que l’on acceptait seulement quand elles appartenaient au monde interlope des personnages louches et qu’on ne saurait montrer positivement ou impunies ; fini, les rapports stéréotypés et convenus. C’est la foire aux monstres. Place à la névrose, aux ambitieux, aux pervers, aux alcooliques, aux escrocs ou aux truands (pas de l’ombre, comme il était admis de les montrer, mais de la haute société) ; et au lieu de montrer les demi-mondaines, à leur balcon, cracher discrètement du sang dans un mouchoir, on les montre chassant les cœurs des hommes mûrs au portefeuille garni ou à la réputation bien faite. Le vice, partout, tout le temps, et en Technicolor s’il vous plaît. Le vice comme effet spécial des années 50 et 60 est censé attirer les foules dans les salles de cinéma. Hays est mort, vive le vice !
Selon Bernard Benoliel qui présentait la séance à la Cinémathèque, le film aurait laissé coi Darryl F. Zanuck, le patron historique de la Fox. On le serait à moins. Si le film précédent avait déjà un côté sadique qui jouait sur ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, La Fille sur la balançoire suggère fortement certaines situations qui frôlent la vulgarité. Le ton aussi frappe par sa noirceur. Et si les cocottes apparaissent traditionnellement dans les fantaisies du cinéma classique toutes fraîches et innocentes, et ce, jusqu’à Gigi peut-être (façon hypocrite de montrer la prostitution et de créer des stéréotypes auxquels les petites filles polies et sages seront appelées à s’identifier), l’image que l’on donne d’elles ici est bien plus scabreuse.
Evelyn est ambitieuse, et malgré ses seize ans, pas tout à fait innocente : si le scénario de Brackett, Walter Reisch, et Fleischer laissent entendre qu’elle aimera son amant et protecteur, on peut douter de son honnêteté (la véritable Evelyn aurait officié sur le film en tant que conseillère technique). Comme beaucoup de petites filles pauvres de l’époque, devenir actrice, se faire repérer par un riche protecteur et gagner ainsi son indépendance dans un monde qui ne leur promet en dehors de cette situation que la misère, c’est hautement compréhensible. Difficile à accepter aujourd’hui ou en 1955 : c’est peut-être paradoxal, mais pour ces filles pauvres, se faire l’esclave d’un riche protecteur était surtout l’occasion de gagner leur indépendance à une époque où l’accès aux études était impossible et où surtout les femmes n’avaient tout bonnement pas les mêmes droits que les hommes.
C’est une lutte des classes, peut-être, mais d’abord, surtout, une lutte individualiste, une quête personnelle vers l’émancipation. Le riche a ce qu’il veut quand il se laisse séduire par une cocotte, et la cocotte, en échange de la fraîcheur de ses joues, gagne sa « liberté » dans une prison dorée.
La réalité montrée est brutale, terriblement sombre malgré les couleurs chatoyantes et les décors somptueux du film, et c’est sans doute déjà ça qui a pu interloquer le public habitué aux reconstitutions donnant une bonne image de la haute société d’alors et idéalisant leurs bonnes manières comme le code ne cessait de vouloir le répéter depuis vingt ans. Fini les frous-frous, les grands sourires de façade, les ronds de jambe affriolants, les rangées de chorus girls et les fantaisies : le luxe est toujours là, mais on passe désormais aussi à la couleur. Les vraies couleurs, celles de la vérité. Et la vérité de l’époque n’est plus « belle » à voir. C’est un monde qui s’écroule sous le poids de ses artifices, un monde qui se dévoile dans toute sa grossièreté et son hypocrisie derrière les détails scabreux d’un fait divers. Le film s’ouvre sur une image du procès et une présentation des faits, donc on ne nous ment pas sur l’inéluctabilité du drame qui se noue devant nous. Les personnages, eux, ne verront rien venir.
Les allusions sexuelles parsèment chaque séquence du film. Cela reste toujours plus subtil que les dérives « décadentes » des films futurs produits à Hollywood, mais on en annonce déjà un peu la couleur… Tout commence par le titre (beaucoup plus explicite, moins euphémique, en anglais) qui renvoie à une séquence et à un décor d’une symbolique sexuelle évidente. (Même si on laisse encore le spectateur innocent jouir d’une autre interprétation).
En le disant, cela passera toujours moins bien que dans le film où, parfois, plongés dans la situation, on n’en mesure pas forcément l’outrance grossière (qui n’est pas celle du film, mais bien celle du personnage, représentant bien réel des outrances de sa classe et de son époque) : un riche architecte tout ce qu’il y a de plus respectable, une sommité de son temps, dispose d’un appartement secret dans l’arrière-salle d’un magasin… de jouets. Il y reçoit des amis pour faire la fête et, on le devine assez bien, régulièrement, des actrices. Ouvrez la porte d’un premier secret, c’est presque un labyrinthe gigogne à la Fellini (ou à la Break-Up, érotisme et ballons rouges) qui se déploie devant vos yeux. Derrière une seconde porte, une perversion un poil plus tordue vous attend : monsieur n’est pas architecte pour rien, une porte, un escalier en colimaçon, et après une dernière porte, une garçonnière, un loft reproduisant sous une grande voûte une forme de jardin symbolique. En son centre, pas un lit, non, on n’est pas dans La Vallée des poupées, on prétend encore à la subtilité, même si on s’apprête à en casser joliment le plafond de verre… Pas un lit donc, mais une balançoire. Après le magasin de jouets, la balançoire… Tu le sens le malaise ?
(À toutes fins utiles, je précise que le scénario a été coécrit par Charles Brackett et que le riche protecteur est interprété par un de ses acteurs fétiches, Ray Milland, qui avaient « commis » treize ans plus tôt avec leur complice, Billy Wilder, l’excellent, mais un peu tordu, The Major and The Minor.)
Le clou du spectacle, il se trouvera donc là, sur cette balançoire en velours rouge suspendu à la voûte du luxueux nid d’oiseaux de monsieur l’architecte. L’oiseau voulait y entrer ; Evelyn y découvre l’amusante balançoire ; son hôte la rejoint ; séduite pour un rien, à peine présentés, elle lui demande de l’embrasser… ; et là où tous les films jusque-là coupaient et imposaient une ellipse qui ne trompait personne, on nous fait bien savoir que l’objet suspendu détourné de son sens initial est bien ce que l’on avait suspecté : on ne suggère plus, on montre. Tout en se réfugiant derrière la métaphore.
Le film ne cédera qu’une seule fois à cet excès, et en ça, on peut dire que le baroque de Fleischer frôle le rococo sans s’y vautrer. Il annonce en tout cas les excès beaucoup plus répétés des films de la décennie suivante. Vas-y que je te pousse, et tiens, essaie de toucher avec ton pied la lune que tu vois là-haut. Et la lune en question est une sorte d’oculus translucide, une membrane blanche ouvrant vers le septième ciel qu’elle tente donc de toucher à force de poussées répétées… Plus l’architecte la balance, plus on se demande (et on craint) qu’elle ne perce cet œil translucide, symbole presque de sa virginité… O colus persus/in nubilis devenus, comme on dit dans la langue de Virgile.
Je ne sais pas si c’est de l’audace ou de la vulgarité, mais j’aurais presque envie de dire à Brackett : « Attention, l’oiseau va sortir ! ».
On évitera de nous rappeler cet épisode édifiant de la balançoire au tribunal que les journaux de l’époque n’ont sans doute pas manqué, eux, de rappeler, mais à la fin du film, on évoquera très subtilement (enfin, pas tout à fait) cette séquence censée représenter un grand moment de joie pour elle (c’était sa première fois, hein), façon Lola Montès, et dans une scène qui se rapprocherait pour le coup plus du chef-d’œuvre des exhibitions pré-code : Freaks.
Zanuck, perplexe, dites-vous ?

« Gare aux cigares qui sifflent dans vos bouches, petites garces… ! — Oh, je m’égare ! Pardonnez ces écarts ! »
Le film connaît par ailleurs d’autres grands moments de « modernité » ou de « rococo », si on peut dire, avec l’épisode du cigare : Evelyn allume le cigare de son riche architecte, ce dernier s’étonne de la voir si habile, et la jeune fille lance alors dans un petit sourire : « C’est que je les ai souvent allumés pour mon père. Il me laissait même parfois en prendre quelques bouffées. Et jamais je n’ai recraché la fumée. »
Rococo comme de la fumée sortant en arabesque folle de la bouche d’une enfant… Que font les ligues de vertu ?
Bref, je reprends mon idée saugrenue de départ. S’il y a quelque chose de cyclique en art comme en histoire, il s’agit toujours de venir « reformer » la période précédente, si bien qu’au bout de deux réformes, on en vient finalement à une révolution. Un petit tour par atavisme et puis s’en va.
L’émancipation des années 70 et 80 qu’on peut lire chez Maupassant, puis les excès arrivant façon « atmosphère fin de siècle », ceux-là mêmes qui sont dépeints dans le film, puis la guerre et son austérité, puis les années folles, populaires, jusqu’aux excès d’une certaine Europe et au conformisme dans le cinéma hollywoodien, puis l’austérité d’une nouvelle guerre, la flamboyance du renouveau d’après-guerre, la couleur, les audaces nouvelles avec ses excès…, et cela jusqu’à aujourd’hui, où on se demande quand tout cela prendra fin.
Et aujourd’hui, comme en 1905, comme en 1955 à Hollywood, on s’habitue à la médiocrité. Pourtant, rien n’atteint les élites : ceux qui autrefois s’entretuent en duel pour les beaux yeux d’une cocotte, ceux qui se livraient à des « crimes passionnels » en public, on ne les voit jamais vaciller face au scandale. DSK s’en tire à bon compte ; les petites fortunes à la Epstein se suicident en prison ; mais le peuple, au lieu d’appeler à une contre-réforme se laisse prendre par les fausses pistes de la désinformation et regarde ailleurs. Au lieu de vouloir la tête de ces élites quand elles fautent, au lieu de leur demander des comptes à l’heure des crises qui se suivent alors qu’elles sont l’occasion pour elles de s’enrichir, le peuple succombe aux mythes de la désinformation et regarde ailleurs.
C’est peut-être ça finalement la fin de l’histoire. Faire en sorte que tout se perpétue comme avant, voir que, malgré les crises, les classes dominantes se « régénèrent » au détriment des plus faibles. En 1905, le scandale augure d’un changement d’époque. En 1955 aussi. Il faudra attendre dix ans à chaque fois. Aujourd’hui, on attend encore. Le cinéma illustre de cette stagnation : plus rien ne surprend, on ne réforme plus rien, on régénère les succès d’hier. On préfère les franchises à l’honnêteté. Jusqu’à quand ? Faudra-t-il une nouvelle guerre pour que les élites soient remplacées par d’autres, pour que la société, l’art, se réforme ?
Les « jeunes Turcs » d’autrefois, on leur dirait aujourd’hui de rentrer chez eux, dans leur pays. Mais cela voudrait dire quoi au juste de notre temps ? Est-ce le conservatisme ou l’excès qui prévaut ? Il est peut-être là le souci. Un peu des deux. Entre 1955 (où le public serait resté perplexe devant un film aussi misanthrope dressant un portrait guère flatteur du monde où chacun, quelle que soit sa classe, tire un bénéfice de l’autre) et 2024, il n’y a pas tant que ça de différences. Difficile aujourd’hui de se laisser émouvoir par le sort de l’amant tué, lui, l’hypocrite bien éduqué qui prétendait vouloir résister au charme de sa cadette, mais qui mettait tout en œuvre pour que de jolis oiseaux viennent se perdre dans la cage dorée qu’il avait bâtie pour elles. La balançoire, elle est faite pour les amies de sa femme qu’il prenait pour maîtresse peut-être ?…
Émus, on aurait pu l’être en voyant chez Evelyn une victime de l’appétit des hommes, une victime de la classe dominante ne lui laissant pas l’occasion d’être autre chose qu’une proie. Mais en fait, non. Evelyn est bien trop volontaire pour être une innocente victime : hameçonner un gros poisson, c’était sortir d’une misère assurée, presque commune. Malgré sa déchéance et son brutal retour à la normalité, plaint-on réellement la femme d’un assassin qui a touché du doigt (ou du pied) la vie de confort espérée en échange d’un amour supposé et bienvenu avant de livrer son cœur à un autre plus offrant ? Est-on victime quand on a eu ce qu’on cherchait ? Les jupes des cocottes étaient-elles trop courtes en 1905 ?
Donc, oui, sans doute, pour nous aussi, autant qu’en 1955, on se réveille du cauchemar des autres sans avoir su à qui donner notre sympathie. C’est l’humanité dans son ensemble qui en ressort écornée. Au fond, comme dans une guerre, il n’y a jamais de gagnant. Dans cette lutte de classes ou dans cette lutte des sexes, tout le monde y perd. Et c’est peut-être mieux qu’un seul justement n’en sorte jamais vainqueur. À la société de limiter les conditions favorisant les scandales qui provoqueront sa chute… Force est de constater qu’on fait aujourd’hui tout le contraire. La réforme arrivera fatalement un jour, reste à savoir sous quelle forme : guerre, faillite, lent essoufflement…
Je parierai sur un essoufflement, une implosion sans vague. Le film annonce les crises futures des années 60, mais il n’aura fallu que quelques années pour que Hollywood s’écroule, et se relève presque aussitôt. Farley Granger a de méchants airs de Hayden Christensen, tiens. Si la série des films Star Wars a été le point de départ d’une ribambelle de films à grands effets spéciaux et à superhéros, on se demande aujourd’hui si tout cela aura en réalité une fin. À quand l’implosion du système hollywoodien (et des autres) au profit de propositions et d’approches nouvelles ? N’a-t-on pas déjà dépassé les limites ? Ou la « régénération » invoquée par certains nous a-t-elle déjà irrévocablement rendus amorphes ?

« Cul-y, cul cuit. »
Tiens, pourquoi ne changerions-nous pas les rôles, rien que pour voir ? Plaçons Ray Milland sur la balançoire et faisons en sorte que Evelyn le pousse, encore et encore, jusqu’à ce qu’il casse le plafond de verre et fasse une révolution. Excessif ? De quoi précipiter la chute de l’empire occidental ? Que serait un Anakin Skywalker dans l’excès (si, c’est possible) ? Un superhéros de The Boys ?… Même pas. C’est affolant. Tous les excès ont déjà été faits. Cela voudrait donc dire que l’on vit une période… conservatrice ? Non, je suis perdu.
Bref, je ne sais pas si c’est la fin de l’histoire, la fin d’un cycle, en tout cas, cela semble bien être le chaos.
— Oh, j’ai la tête qui me tourne ! Arrêtez de pousser ! Cessez, je vous dis ! Vous poussez l’audace bien trop fort !
— Comment ? Mais n’êtes-vous pas venu pour cela ?
— De l’air. Faites-moi descendre.
— Un cigare ? J’ai cru comprendre que vous ne crachiez jamais la fumée.
— Oh, non ! De l’air ! De l’air !
— Ouvrez l’oculus. Si vous arrivez à l’atteindre, peut-être auriez-vous un peu d’air. C’est bien ce à quoi toutes les femmes aspirent ?
— Ah, vous croyez ? Là, comme ça ?
— Oui, un peu plus fort. Là, encore.
— Mais cela fait mal, voyons ! Et je m’essouffle d’autant plus.
— Encore.
— J’ai la tête qui tourne.
— Encore !
— Qu’hymène me suive ! Oh, que dis-je ?
— Le cigare vous monte à la tête, Evelyn.
— Quel cigare ?
— Celui que vous avez dans la bouche.
— Ah !
(Elle casse l’oculus en forme de lune. L’architecte la fait descendre de la balançoire.)
— Vous avez tapé trop fort.
— Non. Ce n’est pas ça.
— C’est fait. Voyez, l’air peut passer maintenant. Vous respirez complètement. Vous êtes une femme désormais.
— Ah, goujat !
— Un bonbon ?
(Elle se redresse.)
— Oui, merci. Oh, comme c’est joliment torsadé ! Parfaitement rococo.
— Tout ici n’est que sucrerie. Ceux-ci, ce sont des berlingots.
— Des berlingots ?
— Oui. Regardez celui-ci. C’est mon sucre d’orge.
— Oh, comme il est mignon !
— Le suceriez-vous pour moi ?
— Oh, je préférerais le croquer !
— Faites donc, ma jolie ! Maintenant que vous avez décroché la lune, tout vous est permis.
— Tout ?
— Tout. Mais c’est un secret. Ne révélez à personne nos petits secrets !
Doit-on vraiment en arriver là ?
Bref. Il n’y a pas que le music-hall (le vaudeville) qui a tiré misérablement profit (avec la principale intéressée) du scandale de cette histoire. Dix ans après, le cinéma s’était lui aussi engouffré dans la brèche :

Une preuve que la guerre n’a rien résolu et que les cycles sont des vues de l’esprit ? (Le film est aujourd’hui perdu.)