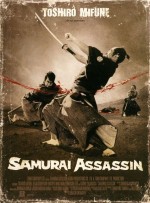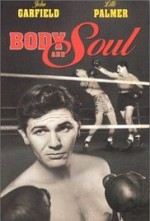Si l’idée de départ est louable (montrer l’influence des thèses psychanalytiques de Freud dans la naissance du marketing — ou service de relations publiques — puis son évolution au cours du XXᵉ siècle et notamment comment les entreprises et les politiciens ont usé de ces méthodes pour manipuler les « masses ») le documentaire souffre malheureusement d’un grave défaut. Si l’influence ne fait aucun doute, jamais il n’est pris suffisamment de recul pour faire la critique de telles méthodes dont l’efficacité est contestée. Du coup, on n’échappe pas à une forme de vaste théorie du complot dans laquelle les masses seraient manipulées par de savants manipulateurs travaillant au service des entreprises ou des partis. La critique est moins portée comme elle le devrait sur les capacités réelles de telles pratiques, que sur leur moralité. Du « ça ne marche pas, mais c’est bien problématique que tout un monde fonctionne à travers des niaiseries » on arrive à « ce n’est pas bien que l’on se fasse manipuler par des savants fous ! ».
Le documentaire retrace donc chronologiquement l’histoire de ces techniques, suppose que par leur influence elles n’ont cessé de faire évoluer le monde, et prétend que l’idée d’un consommateur au cœur de la société est le résultat direct de cette volonté des compagnies d’exercer sur lui un contrôle presque machiavélique. L’histoire est belle, et si elle est belle, forcément vraie : le grand pape de cette pseudoscience est Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud. Il serait à la fois celui ayant participé à développer les thèses du gourou de la psychanalyse en Amérique et celui qui s’en inspirant aurait donc développé l’idée d’une propagande faite par les entreprises dont les techniques seraient directement issues des thèses du bon vieux tonton Freud. La belle histoire continuera quand, à la mort de Freud, ce sera sa fille Anna qui reprendra le flambeau et finira d’évangéliser l’Amérique à travers la bonne parole expiatoire de son père. L’idée qu’un génie ou qu’un savoir secret, mystérieux, puisse n’être détenu que par les membres d’une même famille laisse déjà à désirer, pourtant dans la logique du documentaire, ça semble être la chose la plus naturelle au monde. Aucune remarque ou critique vis-à-vis de cet étrange et grossier biais ayant fait de la psychanalyse une pseudoscience aussi séduisante, si prisée des entrepreneurs, des politiques et des artistes…
Il n’apparaît jamais possible ou probable, à travers les quatre épisodes de la série, que la prédominance de la psychanalyse dans les méthodes de vente et le contrôle supposé des masses puisse être aussi crédible que de voir un graphologue décrire la personnalité d’une personne à travers son écriture, un astrologue prévoir les résultats du loto, un futurologue être capable de prédire l’avenir, ou encore un économiste éviter les crashs. Non, l’efficacité des méthodes est supposée réelle. Ce serait même étonnant de se poser la question tant la réponse semble être évidente. Semble. Or, tout ça tient essentiellement à de la croyance. Bien sûr, les méthodes ont leurs résultats. Mais l’astrologue peut aussi prédire sans se tromper. La voyante peut également viser juste avec un peu de bon sens et de la… « psychologie ». Cela ne veut pas dire qu’il faut attribuer ce succès aux méthodes qui sont censées comme par magie influencer le comportement « des masses », et du « consommateur ». La psychanalyse, et donc sa petite fille, la méthode de vente, érigent en système des principes qui, soit sont totalement irrationnels, soit ne font rien d’autre que de faire appel au bon sens. Mais en réalité leur réussite, et l’avènement du consommateur roi au XXᵉ siècle, tient à des facteurs historiques étrangers à la psychologie, et affreusement banals : le développement croissant de l’industrialisation et donc de la société de consommation. Une société ne tourne jamais aussi bien que quand il y a un consommateur pour faire tourner les machines. Dire que la psychanalyse a une telle influence sur le consommateur, c’est en gros prétendre que tout le développement et les progrès propres au XXᵉ siècle sont les résultats de la psychanalyse… L’orgueil de Freud vous remercie ; les ingénieurs, les innovateurs et les scientifiques rient jaune.
Le documentaire, lui, s’il est inspiré par quelque chose, c’est bien des thèses conspirationnistes. Chaque commentaire laisse planer un doute, suggère une menace invisible que l’analyse méticuleuse de son œil-caméra serait capable de dénoncer… « Nous allons vous montrer l’histoire véritable du XXᵉ siècle, l’histoire de la manipulation de masse, ou comment vous, consommateurs, avez été trompés par les marques que vous achetez et par les politiciens que vous élisez. Car en vérité je vous le dis : il y a une volonté nauséabonde des puissants à manipuler les masses ! » Ah ! Merci, grande découverte ! Les puissants chercheraient à manipuler les moins puissants. Mais mieux, l’histoire est encore plus belle à raconter, car non seulement ces puissants ont toujours eu des intentions malsaines à notre égard, mais surtout ils sont parvenus à leurs fins ! Oui, citoyen, tu es manipulé, sache-le !


Effet Koulechov
Ce n’est pas une grande découverte. De là à dire que le développement du dernier siècle est la preuve que ces méthodes… « marchent », c’est un peu grossier. En fait la volonté des puissants à manipuler la population ne date pas de la psychanalyse. C’est une idée qui existait déjà à la naissance de la démocratie moderne. Qui de fait, a toujours été une forme de conspiration contre le peuple. Une forme. Parce que la démocratie moderne n’a jamais été faite que par la bourgeoisie, pour la bourgeoisie. Aux États-Unis comme en France et partout ailleurs, la démocratie n’a rien de la démocratie directe d’Athènes ; c’est au contraire une forme d’oligarchie contrôlée par les bourgeois pour s’assurer la pérennité de leurs affaires, de leurs acquis et de leurs biens. On retrouve factuellement toujours la même organisation dans les institutions démocratiques. Ce sont déjà les puissants qui œuvrent au profit des puissants. Et qui sont ces puissants bourgeois ? Ceux-là mêmes qui deviendront les entrepreneurs du XIXᵉ siècle et qui accéléreront encore plus le progrès, l’industrialisation, et malgré tout, propageront une idée de la liberté. Cette idée d’émancipation, illusoire ou non, cette manipulation prétendue de l’individu, précède la psychanalyse. Et elle est bien le résultat de la révolution industrielle, technique et scientifique des siècles précédents. Pour contrôler les masses, nul besoin d’élaborer de savantes méthodes psychologiques pour prétendre pénétrer leur inconscient : l’idée du bonheur émancipateur, était déjà là, dans les institutions. Et c’était déjà les mêmes qui en profitaient. C’est une croyance sans fondement que de penser qu’une quelconque science puisse manipuler les masses à travers des systèmes sophistiqués ou des connaissances mystérieuses connues des seuls spécialistes. Bien sûr que comprendre le fonctionnement intérieur des individus aide à améliorer les techniques de vente, mais est-ce que la psychanalyse, ou une quelconque science dédiée à l’étude de la consommation, peut, systématiquement, mieux faire qu’un vulgaire vendeur de voitures d’occasion utilisant son instinct ou son bon sens pour augmenter ses profits ?
Penser ou présenter la psychanalyse comme le règne de la rationalité (comme c’est souvent rappelé dans le film) est d’une grande bêtise. Les idées de Freud n’ont rien de rationnel. C’est au contraire le pape de l’irrationnel. C’est un peu comme s’émouvoir devant la beauté faussement logique de l’astrologie, devant ses calculs savants dont la complexité semble donner une image du monde prévisible et contrôlable, donc rationnelle, mais qui tient sur du vent et rien d’autre. Que les puissants aient été influencés et croient à ces balivernes ne fait aucun doute ; encore une fois, il faut voir à quel point les spécialistes de la communication polluent aujourd’hui la « conscience » des politiques. Mais les plus crédules, ce sont bien ceux qui croient en l’efficacité de telles méthodes. Des méthodes difficiles à évaluer dans un cadre historique. Alors les astrologues du marketing, devant répondre d’un échec, iront étudier les causes de cet échec et y trouveront, forcément, des signes, des « raisons » imprévues, mal interprétées, qui les ont amenés à se tromper. Après coup, on a toujours raison. Futurologues, prévisionnistes, ou économistes peuvent de la même manière revoir leurs prévisions… fausses, et affirmer comprendre pourquoi ils ont eu tort. De l’astrologie, rien de plus. Et le « ce qui marche », même avec des techniques plus ou moins évoluées, se limite à du bon sens ou à de la chance.
L’exemple de la cigarette que le vendeur de tabac voulait imposer aux femmes est intéressant. On juge et on interprète a posteriori de l’histoire d’une réussite. Mais c’est sans compter toutes les fois où le « marketing », cette propagande qui ne veut pas dire son nom, s’est planté. On nous explique donc que pour la psychanalyse, la cigarette est un pénis ; les femmes étant dépourvues de pénis (à ce qu’il paraît), il fallait donc créer cette envie d’indépendance… Arrivent donc les suffragettes, et hop, on récupère l’image de la femme active, indépendante, et le tour est joué. De là à nous expliquer que les cigarettiers sont à la base de la révolution des droits de la femme dans nos sociétés, on n’en est pas loin. Il y a une différence entre suivre le mouvement et l’initier. Encore heureux que des entreprises arrivent à accompagner le développement des sociétés, mais croire qu’elles puissent influencer ainsi les foules, c’est du délire le plus complet, tout simplement parce que ça implique trop de facteurs, et que la volonté des marchants à voir un produit se développer plus qu’un autre n’est qu’un facteur parmi tant d’autres. On parlera alors de tous les exemples qui ont marché, censé prouver l’efficacité d’une méthode, quand on oublie sciemment ou non toutes les fois où la méthode s’est plantée.

The Century of the Self, Adam Curtis 2002 British Broadcasting Corporation (BBC), RDF Media
C’est certain, quand on met en place un service de relations publiques, on tend à améliorer ses chiffres. Comme c’est étrange… Rien de bien surprenant en fait, quand on cherche à convaincre, on a sans doute plus de chances de le faire en y mettant les moyens plutôt qu’en se tournant les pouces… Faire de la publicité va de toute façon aider un produit à se vendre, qu’importe la méthode. Faire de la communication à travers l’entreprise à l’attention des employés va améliorer les conditions de travail, qu’importe la méthode, et quand on fait du lobby on s’en tire certes toujours mieux que quand on n’en fait pas… Merci pour ces évidences.
Le documentaire procède lui-même à travers une méthode simple pour nous convaincre de la force et de l’importance dans l’histoire de ces techniques. Les intervenants sont toujours les mêmes, souvent des proches tout acquis à la cause défendue par le doc (à savoir la capacité de manipulation des puissants sur les non-puissants), et on ne cesse de les voir rabâcher que ces « spécialistes » (papa, tonton Freud) étaient capables de manipuler les masses. Bien sûr, répéter cent fois la même chose aide à convaincre. Plus c’est gros, plus on aura tendance à y croire parce que tout paraît plus simple. On y croira davantage si aucune contradiction n’est apportée, puisque c’est présenté comme un fait entendu, une manipulation réussie, presque machiavélique, sans faille. Et on y croira donc encore davantage, si ce sont les propres membres de la famille de Freud ou d’Edward Bernays, d’éminents psychanalystes, qui soutiennent cette idée (assez peu flatteuse mais pourquoi pas) d’une capacité des PR à manipuler les masses autant que nécessaire. Règne toujours, donc, cette atmosphère de complot dont on sait le spectateur friand ; ici, ce serait un peu comme voir des criminels nazis se vanter de leur crime, il y a comme un plaisir et un intérêt malsain à voir s’exprimer des proches juger eux-mêmes ces méthodes peu recommandables (parce qu’ils croient surtout en leur efficacité — il faudrait psychanalyser tout ça, il y a comme un plaisir pervers à s’attribuer un tel pouvoir de manipulation). Bref, ce n’est pas parce qu’on martèle cent fois la même connerie qu’elle en devient vraie. On est dans le domaine de la croyance pure, pas de l’étude rationnelle. Il aurait été donc intéressant au moins d’apporter un regard plus critique, plus contradictoire à ces hurluberlus.
Car, c’est en fait la pire des manières de faire de l’histoire. Opter pour un angle, une version, et s’attacher à démontrer cette version en rejetant systématiquement ce qui pourrait s’y opposer. Aucune modération des propos, aucun espace laissé à la contradiction. Chaque intervention doit rabâcher sans cesse la même chose : l’évidence de l’implication et de l’influence de ces techniques dans l’histoire. C’est de la sélection d’informations, on capture tout ce qui va dans le sens de notre version, et on juge fausses toutes celles qui iraient dans un sens contraire. Imaginons qu’au sein d’une organisation, un dirigeant influent ait produit un rapport concluant à la nécessité d’employer telle ou telle méthode ou procédure, pour atteindre un but précis, mais que l’ensemble de sa hiérarchie, tout en ayant lu ce rapport en rejette les conclusions. Eh ben, un historien qui serait amené à chercher des preuves allant dans le sens que ces méthodes et procédures étaient effectivement utilisées, et tombant sur ce rapport, en conclurait que, compte tenu de l’autorité dont bénéficiait son auteur au sein de son organisation, l’ensemble de l’organisation qu’il représente en a accepté les conclusions. Le rapport, sans avoir eu aucun impact puisque rejeté, serait utilisé comme preuve. Dans un film, l’effet sur le spectateur serait évident, et la méthode pour le convaincre tout aussi simple et prédictible qu’un génie du marketing pourrait l’imaginer : on produirait le rapport en montrant dans le film un ou deux extraits particulièrement significatifs et édifiants. Et voilà ! Preuve est faite que l’organisation en question utilisait ces méthodes… En réalité, qui manipule qui ? Ceux qui sont censés manipuler les masses, ou ceux qui prétendent qu’il y a un vaste complot de conspirateurs aidés d’un petit manuel d’interprétation des rêves de Freud manipulant les masses à travers leurs désirs refoulés ?

Une femme perdue, manipulée, dans la fumée de sa cigarette
La seule opposition livrée au spectateur en fait vient ironiquement de Wilhelm Reich (dont je n’ai pas lu précisément les travaux mais dont il ressort qu’il était encore plus timbré que les psychanalystes). Et quand il est question des contestations des années 60, il est rapporté qu’elles ne venaient pas contredire l’idée de l’efficacité de telles méthodes, de leur irrationalité ; au contraire, on nous les présente comme des « masses » se révoltant contre la volonté de ces « marques » ou entreprises à vouloir diriger leur vie, donc à les manipuler, donc d’user de rationalité, d’user de sciences du comportement pour les manipuler… L’idée hautement crédible d’un brainwashing en somme (idée ô combien populaire dans les populations soutenant les thèses conspirationnistes). Ça ne fait toujours qu’aller dans le sens de la « méthode », la présentant toujours comme « rationnelle », et donc apporter du crédit à ces balivernes, et finalement conforter l’idée d’une vaste conspiration secrète des puissants contre les non-puissants… Mieux, le film nous montre comment les entreprises, les politiques et tous ceux censés vouloir contrôler les masses à travers la psychanalyse vont répliquer aux mouvements de contestation des années 60 et produire une sorte de contre-réforme du capitalisme. Encore et toujours la théorie du complot : les puissantes entreprises ou politiciens connaissant les arcanes de l’esprit humain d’un côté, et de l’autre, les pauvres consommateurs qui ont tout à coup pris conscience qu’ils étaient manipulés et qu’il fallait se révolter… Ce n’est pas de l’histoire, c’est du mythe. On est dans Metropolis. Du délire.
En fait, dire que c’est la psychanalyse qui a permis le développement économique à travers le développement du moi, de la satisfaction permanente des désirs, de la création de nouveaux besoins, est un contresens, et on oublie sciemment la marche logique du monde poussée par le progrès technique, scientifique et industriel, qui est pourtant pour la grande part responsable d’un monde presque exclusivement tourné vers la consommation et le culte du moi. Ce serait un peu comme prétendre aujourd’hui qu’une nouvelle forme de prise de conscience est en train de prendre forme en réaction à toutes ces idées du XXᵉ siècle alors qu’elles ne font que se développer à cause justement d’une crise prenant ses sources dans un ensemble de facteurs extérieurs, et en particulier à cause des crises énergiques et environnementales dont on doit faire face. Aucune prise de conscience différente, seulement, à cause ou grâce à l’environnement bien différent (ou qu’on perçoit différemment), ces idées tendent à se généraliser. En fait, la vision du documentaire place l’évolution du monde comme le résultat d’une lutte permanente entre puissants et consommateurs, sans intégrer le concept d’environnement (au sens large) dans cette « étude ». Je ne parle pas seulement de la crise environnementale, mais bien de tout un tas de facteurs extérieurs mal identifiables jouant un rôle dans la marche du monde. Mais un rôle qui sera toujours plus grand que ces méthodes prétendument révolutionnaires, et un rôle bien moindre que possèdent les progrès techniques et scientifiques.
La démonstration aurait un sens si elle ne s’appliquait qu’à illustrer les grandes lignes du culte de l’individualisme au XXᵉ siècle, mais l’idée de suggérer que ce culte ait été volontairement pensé par une méthode, utilisée par le capitalisme, pour faire des citoyens des consommateurs, et qu’en fonction des évolutions du siècle, ce capitalisme (autant dire les instigateurs d’un complot) ait dû revoir sa copie pour s’adapter aux critiques des « masses » et ainsi à nouveau les asservir à leur volonté, c’est une position difficilement tenable car impossible à prouver. Croyance, volonté de croire, idée du complot…, tout y est.
Par exemple, dans son dernier épisode, le documentaire a l’idée de montrer, à la même époque en Grande-Bretagne et aux États-Unis, l’émergence d’une même nécessité, celle d’un parti capable de répondre à l’appel du peuple, à son aspiration à plus d’individualisme… Bel exemple de sélection d’informations. On sous-entend ainsi que cette émergence, puisque vaguement apparue au même moment dans deux pays du monde, était comme inéluctable, prévisible, bref, un peu comme si l’histoire avait une finalité et répondait toujours aux mêmes codes, et que ceux capables de les décrypter seraient en mesure d’accéder au pouvoir. C’est une idée qui ne peut plus tenir quand on élargit sa vision. En France par exemple, c’est tout le contraire qui s’est passé ; quand Thatcher et Reagan tenaient les rênes du pouvoir, c’est Mitterrand qui l’était en France. Ça n’a donc pas beaucoup de sens, et ça n’en aura pas plus en comparant la gauche de Blair et celle de Clinton censée arriver au pouvoir grâce à l’utilisation de ces mêmes méthodes autrefois utilisées par la droite…

L’arrière-petit-fils de Claude Évin
Le documentaire met donc la place des publicitaires et des communicants à une place qui est certes la leur depuis bientôt un siècle (une place importante dans la vie publique), mais sans jamais critiquer l’irrationalité de leurs méthodes, au contraire, et paradoxalement en en faisant la victoire de la rationalité, celles des prétendus spécialistes du comportement humain et du subconscient, sur le développement du monde. En réalité, le succès qui leur est attribué, et les intentions qu’on leur prête, rappelle la place de l’astrologie chez les souverains jusqu’au Moyen Âge. Astrologues contre astrologues, on en trouvera forcément un bien sûr dont les méthodes et les prédictions se révéleront gagnantes…, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par un « meilleur » astrologue. Bref, l’idée que les méthodes de marketing par exemple puissent évoluer pour s’adapter à une époque tient surtout plus de la supercherie que de la manipulation de masse. Ces méthodes quand elles marchent font appel au bon sens, de la chance, profitent des circonstances, et ont probablement autant d’efficacité qu’un placebo livré à une autruche souffrant de constipation.
Qui pourrait juger de l’efficience de ces méthodes ? Personne en fait. Impossible à évaluer. Pour autant, dire que ces astrologues des temps modernes n’ont aucune emprise sur le monde, sur les compagnies ou les politiques, serait tout aussi idiot que de croire en un vaste complot de ces puissants contre le pauvre peuple consommateur. Mais leur pouvoir tient surtout à la place qu’ils ont tenue et qu’ils tiennent encore, plutôt que par la détention d’un savoir sophistiqué capable de manipuler Pierre, Paul et Jacques. Dans une défaite politique ou dans le désastre économique d’un produit, on préférera alors chercher une cause imprévisible que les experts auraient mal évaluée. Après coup, on a toujours raison. Contrairement à ce que prétend donc le documentaire, leur pouvoir tient surtout à l’irrationalité de leurs méthodes. Et leur génie tient plus à convaincre leurs clients, politiciens et compagnies, à les embaucher en dépit du bon sens qu’à manipuler efficacement les masses.
Les entreprises peuvent, certes, inventer de nouveaux besoins, mais ceux-ci évoluent en fonction de l’évolution des techniques, des usages, et de modes qui sont, contrairement à ce qu’ils prétendent, hautement imprévisibles et très liés aux évolutions technologiques ; il sera toujours impossible de créer un « produit » répondant seul à un besoin qui ne préexistait pas chez le consommateur.
Les compagnies dépenseront des ressources, du temps, et de l’argent pour définir et atteindre un cœur de cible, promouvoir un produit, et elles trouveront n’importe quelle excuse extérieure (ou intérieure, car psychanalytique) pour trouver une raison à l’échec de ce produit au lieu de se demander s’il répondait à un besoin réel. Et les politiques de leur côté sont pourris par leurs conseillers en communication au point que leur discours n’a plus aucun sens et que les votants n’ont plus que leurs lassitudes à exprimer.
Quand le monde connaît un vaste développement, il est facile d’attribuer les mérites de cette réussite à des génies de la communication ou aux grands savants astrologues. L’énergie perdue à forger des méthodes plus ou moins efficaces est vite engloutie dans l’enthousiasme général d’une prospérité qu’on croit éternelle. Et on attribue tout le mérite à ces méthodes participant ainsi à leur développement. En cas de crise, si on est tenté de multiplier ses efforts sur des méthodes irrationnelles, on ne fait qu’accentuer l’inertie qui nous empêche déjà de remonter la pente : au lieu de booster le moteur, on s’applique à vouloir avancer à coups de pensée magique… On pourrait alors penser que le rationnel devienne la norme et que ceux qui réussissent sont justement ceux qui n’utilisaient pas ces méthodes ; sauf que si tout le monde les applique, il y aura toujours des gagnants se trimbalant avec ces casseroles au cul et continuant à penser que ce sont elles qui les font avancer.

Une femme avec son nom incrusté à l’écran, elle doit avoir fait des choses bien
Alors oui, l’influence de ces forces (magiques) est puissante, mais ce sont, en réalité, des forces contraires foutrement handicapantes pour la société. Tandis que le souverain a les yeux tournés vers le ciel et que son astrologue lui en révèle les secrets, le souverain n’a que faire des réalités pratiques de son royaume. Il en est de même pour les politiques de notre siècle. L’obstination des partis ne devient plus (même si elle l’a sans doute toujours été) que de gagner le pouvoir ; s’ils le font à travers des méthodes fallacieuses, en manipulant sciemment ceux pour qui ils sont élus, cela finit par se voir et l’incrédulité des populations face aux politiques ne fait qu’augmenter. Et si la part de l’influence des compagnies n’a cessé au contraire de s’accroître au détriment des politiques, ce n’est pas parce qu’ils avaient de meilleures méthodes, c’est que, dans une certaine mesure, les politiques les ont laissées prendre le pouvoir et que personne n’a jamais été capable ou désireux de retourner le rapport de force qui tournait toujours plus en faveur des entreprises. Cette prise du pouvoir des entreprises dans la société est sans doute plus le résultat des facteurs conjugués de l’industrialisation et de la mondialisation, qu’à des méthodes de propagande héritées de la psychanalyse… Il est tout de même assez frappant de voir dans ce documentaire que jamais le progrès technique n’est cité comme facteur de développement et d’évolution sociétal ; c’en est pourtant le principal moteur. C’est donner bien trop de crédit à l’idée d’une capacité de certains hommes à manipuler d’autres hommes. Quand on rend capable le transport des produits d’un bout à l’autre de la planète, quand les besoins évoluent en fonction des développements technologiques et en fonction des capacités de production, quand on vit avec l’idée d’une prospérité sans fin passant par la consommation des produits nouveaux, inutile d’user de publicité ou de propagande pour voir émerger des nouvelles envies et voir la société évoluer, poussée par ces progrès sur lesquels les secrets de la psychologie humaine a finalement assez peu d’impact. Donner du crédit à ces méthodes, c’est croire qu’une science de la prédiction puisse persuader le hasard à changer de camp, comme un astrologue auquel on demanderait quelle impulsion donner à sa pièce pour qu’elle retombe toujours du même côté. C’est aussi une croyance pernicieuse parce qu’elle corrompt ce pour quoi les politiques sont élus et parce qu’elle révèle en fait la nature de ce que sont en réalité les partis : des machines à gagner, à prendre le pouvoir, non à répondre aux besoins, bien réels, des populations. Un pari risqué, car les populations sont, dans une très large majorité, conscientes de se faire manipuler. Pas de la manière que ces astrologues de la psychanalyse le prétendraient. Mais simplement parce que les politiques sont coupés de la réalité. C’est d’ailleurs un reproche qui leur est très largement fait et auquel ils tentent bien souvent de répondre à travers la communication… Un non-sens dangereux.
La merveilleuse idée en fait que le documentaire défend et illustre, c’est la croyance selon laquelle la manipulation de masse puisse être une science, et donc être rationalisée. Belle usurpation. Comme l’astrologie, cette pseudoscience a toute l’apparence de la rationalité, mais le marketing, la manipulation de masse, le conseil en communication, tout ça c’est tout le contraire de la rationalité. Le film nous rappelle sans cesse que Freud, ce « docteur » comme ironise son neveu, croyait que les hommes étaient essentiellement poussés par des pulsions irrationnelles… « Croyait », oui, c’est là tout le problème. Freud était hanté par ses propres croyances et aimait faire de sa propre analyse une généralité appliquée « à tous les hommes ». Son neveu doit surtout sa réussite à son opportunisme, à son habileté, à son bon sens, comme n’importe quel astrologue, gourou ou voyant. Cette réussite ne prouve en rien que les techniques mises en place marchent, parce qu’elles marchent avant tout dans un monde plongé dans une course à la modernité. L’être humain n’est ni irrationnel ni rationnel, il est les deux à la fois ; et il appartient à chacun de s’adresser à la part rationnelle qui est en chacun de nous dans un souci de réelle efficacité, voire d’honnêteté. Les usurpateurs et les pseudosciences ont, certes, encore de beaux jours devant eux.

Un symbole phallique mouillant dans les eaux du pouvoir