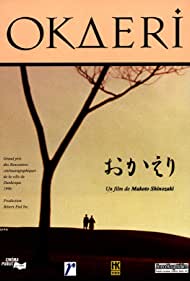Étrange, mais remarquable film branché sur courant alternatif. Si le dernier acte s’enfonce tristement dans un romantisme qui flirte avec le mélodrame et s’il échoue à trouver une fin qui coïncide avec les attentes initiales, la première heure de film offre au spectateur une tonalité singulière et plutôt bien vue en jouant sur les codes du thriller et du film d’enquête à la limite de l’absurde. On vient avec le personnage principal à la recherche des effets de la bombe sur les habitants d’Hiroshima dix-sept ans après la catastrophe, et on n’y trouve désespérément rien de bien tangible pendant une bonne partie du film (la meilleure) : « Patron, il faut que je reste encore quelques jours à Hiroshima. — Pourquoi ? — Attendre Godzilla. Il n’est pas venu. — C’est vrai. Tu n’as rien trouvé encore de quoi écrire de sensationnaliste. Continue. »
À l’image d’un dialogue fameux d’Hiroshima, mon amour écrit par Marguerite Duras pour le chef-d’œuvre d’Alain Resnais en 1959, une seule phrase semble se répéter en écho tout au long du film pour se moquer du journaliste en quête d’un sujet qui ne cesse de lui échapper : « Tu n’as rien vu à Hiroshima ». Pendant toute cette première partie, le film interroge ainsi habilement le regard porté sur les effets de la bombe, et tout particulièrement sur ces hibakushas, les victimes des deux villes martyres ayant survécu aux premières heures de la bombe atomique.
Les effets de la bombe sont encore là, encore faut-il savoir où regarder et arrêter peut-être d’être soi-même un monstre pour finir par trouver ce que l’on cherche…
L’entrée en matière est ainsi, somme toute, assez classique, mais le récit adopte parfaitement certains codes de thrillers, voire de films catastrophe (à venir) ou d’horreur dans un contexte qui ne s’y prête pas vraiment : un journaliste fait le voyage vers Hiroshima à l’occasion de la 17ᵉ commémoration du bombardement de la ville et se met en tête de faire état à ses lecteurs des effets des irradiations sur la population après toutes ces années. Une fois dans la ville, l’atmosphère est pesante alors que tout paraît calme en apparence et respire la normalité. Le journaliste scrute le moindre signe pouvant révéler l’horreur passée, et en quête d’informations, à force de prêter attention au moindre détail pourtant anodin, il finit par se sentir épié et pas forcément le bienvenu : espaces vides, bruits angoissants, répétitifs ou intempestifs, murmures sourds et indistincts, musique mystérieuse (boîte à musique) ou angoissante, errances dans la ville à la recherche d’indices, champs-contrechamps impersonnels, tout inspire le mystère, le calme avant la tempête. Il insiste et se mêle aux habitants afin de révéler enfin la mémoire tragique de ce passé que chacun semble avoir oublié ou ne pas connaître. Même son de cloche : on vit à Hiroshima comme dans n’importe quelle ville, on s’amuse, on flirte, on boit, on travaille, et l’évènement à venir de la commémoration annuelle dédiée à la catastrophe n’y change rien. « Tu n’as rien vu à Hiroshima. »

Le journaliste retrouve un ami qui travaille à la télévision à un match de baseball, bon vivant, celui-ci est accompagné d’une jeune femme suffisamment jeune pour que le bombardement n’évoque rien pour elle. « Il ne s’est rien passé à Hiroshima. »
Tous trois se rendent alors dans un bar, et le journaliste y reconnaît un médecin travaillant pour l’ABCC, un centre de suivi des victimes d’irradiations (un pur produit de l’occupation américaine) qu’il avait rencontré dans l’espoir de pouvoir retrouver des victimes. Le médecin est accompagné d’une femme qui attire son attention par sa beauté. Il apprend que c’est la tenancière du bar. À chacune de ses rencontres dans la ville reconstituée, il entend le même type de réponses évasives : plus personne ne semble plus souffrir des effets de la bombe qui avait détruit la ville. « Où peuvent être les victimes d’Hiroshima ? »
On en serait presque à suspecter un complot, en tout cas, tout dans la mise en scène concourt à cette impression. Encore une fois, le récit joue habilement avec les codes du thriller, ici, plus spécifiquement avec les enquêtes où un personnage (policier, détective ou journaliste le plus souvent — dans Kiri no hata, par exemple, Chieko Baishô y jouait la sœur d’une victime du système judiciaire japonais) s’immisce dans un milieu fermé dans lequel, avec ses questions et son sans-gêne, il passe vite pour un intrus et un remueur d’immondices. Ce que le journaliste s’obstine à rechercher, ce sont en fait les effets ostensibles de la bombe à long terme : des déformations congénitales, des brûlures, ou au moins des victimes éplorées et des histoires sordides à transmettre à ses lecteurs. Mais non, rien. Le temps semble avoir balayé toutes les traces de la bombe sur la ville. Il a beau visiter des malades à l’ABCC, il n’y rencontre que des malades alités passant leur temps à construire des grues en origami. « Tu n’as rien vu à Hiroshima ? — Non, j’ai attendu en vain Godzilla. Il n’est pas venu. »
À moins qu’on lui cache quelque chose.
Il se rapproche du personnage de la tenancière qui entretient une relation trouble avec un jeune homme qui ne lui inspire pas une grande confiance (encore un élément de film de thriller : les relations louches et inavouables que l’on tente de cacher, mais que l’on ne peut rompre parce qu’on y est contraint ou parce qu’elles définissent qui nous sommes), mais personne ne semble connaître la véritable nature des liens qui unissent ces deux personnages (on apprendra bien plus tard que peut naître ainsi une certaine forme de fraternité entre les victimes, souvent seules survivantes d’une même famille, du bombardement).
Quand le journaliste raconte à la patronne de bar qu’il était venu dans la ville dans l’optique de dévoiler à ses lecteurs les conséquences actuelles de la bombe et qu’il exprime son désarroi en avouant ne rien avoir trouvé pour illustrer un tel article, toujours dans cette logique de thriller nihiliste, la mise en scène et l’interprétation d’Ayako Wakao jouent admirablement bien le double jeu, la suspicion, les non-dits. Le journaliste venait à Hiroshima avec l’espoir morbide d’y trouver Godzilla marchant sur ses habitants et crachant du feu, et il aurait presque l’impression d’être tombé tout au contraire dans Le Village des damnés ou dans L’Invasion des profanateurs de sépultures où la paranoïa et un mur de silence auraient remplacé l’horreur dévastatrice du monstre.
Si la mise en scène joue parfaitement de ces codes en montrant la voie au spectateur pour lui signifier que « l’horreur » n’est peut-être pas celle que l’on craint (l’horreur ostensible), le journaliste, lui, comme dans n’importe quel film d’horreur, évolue encore, incrédule et naïf, sans comprendre que certaines blessures ne sont pas aussi visibles qu’on pourrait d’abord le penser. Il pense ainsi être victime du silence des habitants quand c’est lui plus probablement qui refuse d’écouter ce qu’ils ont à dire, de comprendre ce qu’ils ont légitimement le droit de cacher par lassitude, par honte et par crainte d’être stigmatisés. C’est lui sans aucun doute qui reste aveugle face aux blessures des victimes d’Hiroshima qui ne sont peut-être pas celles attendues ; c’est lui, toujours, qui refuse de comprendre que réaliser des grues en origami, ce n’est peut-être pas si anodin que cela en a l’air (c’est un symbole de paix antinucléaire initié par les victimes parfois agonisantes de la bombe et faisant référence à un mythe plus ancien selon lequel, plier ainsi des grues en papier permettrait d’augmenter son espérance de vie). Après dix-sept ans, se sont peut-être aussi ajoutées aux précédentes, des blessures psychologiques, des humiliations… « Tu n’as rien voulu voir à Hiroshima. »

Le journaliste poursuit son enquête, et à mesure qu’il persiste dans sa volonté de trouver des hibakushas susceptibles de lui parler, la tonalité du film semble paradoxalement s’adoucir et quitter peu à peu le thriller absurde et vain pour trouver un sens, une morale que le journaliste peine encore à comprendre. On se rappelle que le journaliste avait rencontré très vite une victime dont le visage était partiellement brûlé. La musique angoissante s’était arrêtée, et nous, spectateurs, on était restés bluffés par sa joie de vivre (on dirait aujourd’hui « par sa résilience »). Le journaliste, lui, au contraire, ne semblait pas comprendre ce que cette première rencontre semblait déjà lui dire. La transition était assez habile dans la narration, parce que s’il était évident à ce moment que la mise en scène allait peu à peu arrêter de voir derrière la suspicion des habitants à son égard une forme de menace ou de présence inquiétante, il en serait tout autrement pour le journaliste.
Ainsi, plus le récit avance, et plus on prend nos distances avec l’obstination absurde et aveugle du journalisme pour nous rapprocher des habitants. Bientôt, leur présence ne nous paraît plus menaçante, et on comprend que les précautions prises avec le journalisme sont parfaitement nécessaires et légitimes. Plus question de « damnés » ou de « profanateurs de sépultures », ce sont des victimes qui fuient les curieux, qui ont honte et qui souffrent tout autant parfois du regard de la société sur eux, du manque de considération, que des effets visibles et spectaculaires de la bombe.
Retournement habituel dans un récit où on fait intervenir un premier niveau de révélations et où on inverse la nature et la perception des monstres. Est-ce que les monstres, ce ne serait pas plutôt ceux qui s’obstinent à trouver chez l’autre des marques ostensibles susceptibles d’être exposées aux regards des autres ?… Est-ce que les monstres, ce ne sont pas ceux qui permettent que les victimes d’un odieux crime de guerre soient ainsi invisibilisées dans la société, mal considérées, rejetées, mal suivies ? En creux, dix-sept ans après, c’est la politique du gouvernement et de l’occupant qui est exposée ainsi à la critique.
Notre candide journaliste continue de fréquenter la tenancière sans se demander pourquoi, il la retrouve opportunément jamais bien loin de l’ABCC. On a connu plus perspicace comme enquêteur, mais jusque-là son relatif aveuglement sert encore plutôt bien le récit. Les spectateurs que nous sommes a déjà probablement tout compris du personnage interprété par Ayako Wakao, mais il ne faut pas oublier à qui était adressé le film. En 1962, propagande et censure de l’occupant obligent, honte oblige, discrimination oblige, les Japonais en savaient finalement assez peu sur les conséquences de la bombe et des préjugés, des craintes, pouvaient circuler. Ce que les Japonais, dix-sept ans après la fin de la guerre, n’étaient pas si éloignés de ce que le journaliste pensait y trouver en venant dans la ville martyre : certes, tout le monde savait que les deux bombes avaient fait plusieurs centaines de milliers de victimes au moment de son largage, d’autres encore, lors des jours qui suivirent, et le statut des hibakushas était loin d’être gardé secret. On connaissait leur existence, mais on ne voulait pas les voir. Surtout, la propagande ne manquait pas de taire la réalité sur la nature de leurs maux. Si le journaliste ne s’intéresse qu’aux effets visibles et spectaculaires des irradiations, c’est peut-être aussi parce que c’est l’image que s’en faisaient les Japonais, image que voulait bien laisser filtrer le gouvernement sous influence américaine. Apparemment, les effets sur la santé (leucémie, cancers, notamment) semblaient être largement tus dans la population. Il faudra encore quelques années de lutte des associations de victimes ou de personnalités (comme le prix Nobel, Kenzaburo Oé) pour que les effets sur la santé des irradiations soient mieux connus et révélés au grand public. En parler ainsi aussi directement au cinéma a sans doute plus une valeur symbolique qu’autre chose : il y a ce que la censure dit, et il y a ce que l’on veut voir. Dès la première séquence avec le médecin, celui-ci lui évoque les effets sur la santé, pourtant, le journaliste n’en tiendra jamais compte. Seuls les effets visibles l’intéressent.
« Tu n’as pas vu Godzilla à Hiroshima. »
Faute d’être prises en charge correctement, face à des peurs irrationnelles devant des maladies mal connues, les victimes n’avaient souvent d’autre choix que de se cacher ou de cacher leur condition d’hibakusha. Si le film ne dénonce pas encore explicitement la responsabilité des autorités japonaises et d’occupation américaine dans l’absence de prise en charge des victimes ou dans l’information sur les conséquences des bombardements (faute de pouvoir le faire en 1962), il permet déjà de faire prendre conscience à la population japonaise qu’aux blessures anciennes s’ajoutent de nouvelles : elle a aussi (la population) une forme de responsabilité dans la manière de regarder et de considérer les victimes de ces deux jours tragiques d’août 1945. Le regard à la fois aveugle et indiscret du personnage du journaliste, c’est le même que porte le Japon tout entier sur les victimes d’Hiroshima et de Nagasaki.
Le film prend ensuite un tournant mélodramatique, voire grand-guignolesque, dont on aurait pu se passer. C’était bien utile de nous avoir expliqué pendant une heure que les blessures laissées par la bombe n’étaient pas que spectaculaires et visibles pour nous proposer un revirement prévisible pour le moins grotesque et inutile puisqu’il venait en parfaite contradiction avec ce que le récit semblait nous dire jusque-là. Même le titre du film effeuille un peu trop la nature de cette révélation, et on rêve d’une nuit où Godzilla aurait fini par ne pas montrer le bout de son nez et où, au contraire, les dialogues se seraient éternisé comme dans Hiroshima mon amour. Certains films font la promesse à leurs spectateurs de certaines « scènes à faire », expédier ces scènes sans y dévoiler finalement l’essentiel peut laisser une étrange impression d’amertume et d’inachèvement. Cela n’est qu’un avis personnel bien sûr, mais il aurait été bien plus efficace d’expliquer les raisons des vertiges du personnage d’Ayako Wakao (dévoilés avant ça dans le train) par une leucémie ou un cancer qui annoncerait une mort prochaine, et de poursuivre en insistant sur la conflictualité qu’une telle relation, forcément à court terme, pourrait induire pour l’un et pour l’autre. L’une aurait alors été tiraillée par l’idée de vivre une histoire d’amour avant de mourir, celle d’imposer sa maladie à son amoureux ou d’être sujette à la pitié d’un homme qui jusque-là n’avait pas montré beaucoup de compassion et de compréhension à l’égard des victimes de la bombe ; et l’autre aurait essayé de la convaincre que la maladie n’aurait pu corrompre son amour et que son amour était sans rapport avec un quelconque sentiment de pitié… « Tu m’as vue à Hiroshima. »
Mais non.
« J’ai finalement vu Godzilla à Hiroshima. Il marchait sur le port et crachait du feu en avançant vers le centre-ville en détruisant tout sur son passage. Je suis resté avec lui toute la nuit. »
Couillon, tu n’as rien vu à Hiroshima.

Le point faible du film, c’est donc son aspect romantique constitué sur le tard. Après avoir passé tant de temps à jouer sur les non-dits, les mystères, les monstres invisibles ou fouineurs en quête de sensationnalisme, après avoir interrogé la nature de l’horreur et joué indûment avec les codes du thriller pour nous les renvoyer à la figure, difficile de retomber sur ses pattes et de convaincre le spectateur que le film finira sur une passion contrariée à laquelle on ne peut jamais croire réellement.
Pour illustrer ce tournant et tenter un lien avec ce qui précède, l’idée des pierres d’Hiroshima (pierres qui se fissurent à la moindre pression : allégorie de la condition des victimes de la bombe) est bien jolie, mais elles masquent à peine le fait que le journaliste n’aurait jamais dû trouver ce qu’il était venu chercher. Comme dans la plupart des films reposant sur un mystère, il est préférable soit de faire en sorte que l’enquête se transforme en initiation et que le personnage se retrouve à faire la découverte de tout autre chose, soit de décider de ne jamais lever le voile sur le mystère. Une fois que le mystère retombe et qu’on force un amour auquel on ne peut croire, le film change pour de bon de tonalité et tombe dans le mélo. Le film aurait gagné à faire preuve de plus de subtilité en refusant la facilité d’un dénouement (ou dénuement) allant dans le sens de la curiosité déplacée du journaliste. Il aurait alors fallu sans doute opposer plus longtemps l’intérêt que l’un porte à l’autre, interroger les raisons de son attirance (intérêt morbide ou amour véritable) et le besoin malgré tout de l’autre à se sentir aimé. Passer à côté de cette conflictualité, en rester au thème du « monstre » ou de la « défiguration » au lieu d’investir plus franchement la thématique de la maladie invisible (ce qui n’interdit pas le mélodrame), c’est dévoyer peut-être un peu trop les qualités premières du film et ramener une histoire qui avait vocation à être universelle à une autre plus personnelle qui n’a plus beaucoup de sens.
Dommage. — T’as rien vu à Hiroshima. Sinon Love Story. T’as voulu voir Godzilla, et on a vu Godzilla. T’as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. J’ai voulu voir Hiroshima, et on a vu mon amour. Comme toujours.
Mais il faut croire que j’aime les films monstrueux. Ce ne sont pas quelques griffures en fin de partie qui me retiendront d’aimer le faux thriller du début et son horreur telle qu’elle a toujours été la plus efficace : en en montrant le moins possible, en suggérant plus qu’en levant le voile sur des difformités visibles. Les vraies horreurs sont celles que l’on masque ou que l’on ne veut pas voir. Le film peut alors être vu comme un hommage aux victimes de l’apocalypse nucléaire qui après l’horreur d’un mois d’août 1947 ont subi les horreurs des mauvais traitements, de l’indifférence et du mutisme des autorités et des administrations ou du regard obscène de ceux qui ne les considéraient plus comme leurs semblables.
« Chauffe, Marcel, chauffe. La bête arrive. Elle est là. » (Il se frappe la poitrine)