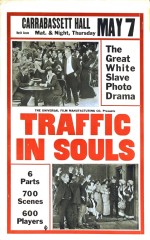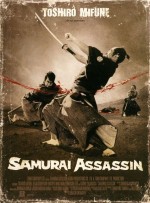Quatre Étranges Cavaliers, Allan Dwan (1954) Silver Lode | Benedict Bogeaus Production, RKO Radio Pictures
Quand on n’a pas de star, on soigne ses seconds rôles. Payne n’est pas vraiment une star et ici ceux qui tiennent le film, ce sont bien ces acteurs de seconde zone prouvant qu’ils ont tout des acteurs de premier plan. Un mal pour un bien, car une étonnante homogénéité se dégage de la distribution. John Payne est une sorte de grand frère obscur de James Stewart à qui manquerait le charme maladroit, ou l’assurance tout à coup boiteuse et guillerette de John Wayne. Payne reste de marbre, inflexible dans son imperméabilité toute mouillée, et offre imperceptiblement le même regard en coin, histoire de suggérer tout un panier d’expressions tout-en-un, de la menace, au désir, en passant par la méfiance, l’introspection ou la circonspection… Il est bon John, et en se contentant d’être Payne, il est ne fait pas d’ombre au reste de la distribution. Son génie, on dira. Ou celui de Dwan.
C’est qu’il faut du flair, de l’intelligence et du savoir-faire pour réunir toute une brochette d’acteurs de talent qui, jusqu’au moindre figurant, se moulent dans un même univers, un même ton. Certains aujourd’hui y verraient de la théâtralité, mais c’est qu’il faut bien envoyer de la réplique et savoir se mouvoir devant une caméra et évoluer parmi ses copains pour donner à voir, raconter une histoire. Le réalisme, contrairement à ce que peuvent rêver toute une flopée de critiques n’ayant jamais foutu les pieds sur une scène, n’est pas la réalité. Mais une illusion de la réalité, une reproduction. Le vrai est peu de chose au cinéma, il n’est qu’une illusion pour ceux qui se laissent tromper par les images. En revanche, la justesse est tout. Et voilà ce qui caractérise à la fois l’interprétation des acteurs, mais aussi la dimension, la saveur, le ton, la couleur… moderne que le réalisateur parvient à inoculer à son film. Pas de stars donc, mais des acteurs pleins d’assurance et d’autorité (à ne pas confondre avec l’autoritarisme des acteurs qui forcent, s’agitent, comme s’ils cherchaient où mener leur personnage, alors que ceux qui font preuve d’autorité — et ça peut concerner des personnages n’en ayant aucune — ne cherchent pas : ils ont déjà trouvé — le ton juste). C’est la marque des acteurs intelligents, aguerris, ceux qui ont acquis des certitudes dans l’expérience mais aussi une modestie dans l’approche d’un rôle. Certains préféreront dire que ces acteurs ont de la personnalité. On peut dire ça aussi oui, ça permet de nier tout le travail qu’il y a derrière, celui qui, pour le coup, n’a rien de moderne pour des critiques entichés de l’idée du vrai. Cette intelligence des acteurs, elle s’évertue pourtant, non pas à se mettre en avant, mais à se confondre dans une distribution pour, ensemble, proposer une vision… juste du monde qu’on veut représenter. C’est une combinaison d’intelligences et d’expériences mises au profit d’un même but. Un travail de collaboration, d’échanges, hérité de la scène, qui est à mille lieues de la notion d’auteur tant prisée par les critiques. Si Dwan dirige, donne le ton, ce n’est pas lui qui joue. Et il n’a pas plus écrit la partition de ce qu’il fait jouer, que programmé la lecture que devra s’en faire tout spectateur. Si le metteur en scène interprète ce qu’un scénariste, une histoire, lui apporte, pour trouver une cohérence, il en produit une qui restera le plus souvent étrangère aux spectateurs. Tout le reste est silence… ou au contraire, paroles vaines. Un film, à travers son « auteur », ne propose aucun discours clair. Dans une forme de discours indirect, peut-être, on pourrait dire que le cinéaste crée un discours montré. Mais montrer n’est pas dire. Et c’est bien pourquoi toute interprétation future ne saurait être autre chose que personnelle. Bref, tout ça pour souligner l’importance du rôle tenu par l’interprétation, sous toutes ses formes, et que cette interprétation est conditionnée par le savoir-faire, l’intelligence subtile, d’un metteur en scène et de sa bande d’acteurs, seuls capables de restituer, ensemble, et au mieux, la complexité d’une histoire. Si le film paraît si… moderne, ce n’est pas la volonté de « l’auteur » Dwan, mais bien la concordance de différents points de vue sur un sujet précis. Allan Dwan dirige, possède le dernier choix, mais il n’est pas l’auteur de son sujet. Derrière la volonté supposée d’un cinéaste, il y a avant tout une histoire, reposant sur des faits factuels et des personnages plus ou moins grossièrement dessinés. Si la trame peut difficilement être tordue (certains le font habilement pour faire correspondre une « morale de l’histoire » à leurs propres goûts, désirs et intentions), le rôle du cinéaste, à la manière d’un chef d’orchestre, est d’en faire ressortir la, ou une, cohérence. Cela reste l’orchestre qui joue et le compositeur qui compose.

Il faut donc, pour que tout ce petit monde puisse s’exprimer et tirer dans le même sens, une matière commune qui est l’histoire. La subtilité commence là. Le western est là, avec ses chevaux, sa ville isolée, ses shérifs, ses sales mioches, ses ivrognes, ses prostituées et ses filles bonnes à marier, pourtant c’était comme si tous les codes du genre étaient inversés. C’est là qu’est la subtilité, dans ce jeu (le meilleur proposé depuis Shakespeare) qui est celui des apparences. Faux-semblants, méprises, mensonges, vérités de plus en plus floues, arnaques, corrupteurs corrompus et corrompus corrupteurs… Rien n’est plus facilement identifiable. Ni noir ni blanc, ni même tout à fait gris. Le brouillard des illusions. Identifie-toi, Hamlet !
Ainsi, pas besoin de lever la voix. Pas de grands instants de bravoure. Ni ironie ni exubérance, ni folklore. La musique reste discrète, il faut presque la bousculer comme on réveille la fanfare, pour qu’elle s’y mette. Pas de coup d’éclat dans la mise en scène, pas d’esbroufe. L’éternelle modernité du classicisme en somme… Un classicisme de film noir. De ces films noirs qui s’affranchissent au mieux de l’inspiration expressionniste et qui se focalisent sur ses « héros ». Une forme d’incommunicabilité avant l’heure peut-être. Qui es-tu vraiment, John Payne ? Ou plutôt, Dan Ballard ? Si on n’échappe pas aux scènes de poursuite et de la confrontation finale, avant ça, on est dans un récit de type analytique. Comment faire moderne avec du vieux, messieurs les critiques ? Œdipe avait déjà tout vu (façon de parler). Ainsi, au lieu de suivre le développement d’une action en train de se nouer sous nos yeux, comme dans tout bon western qui se respecte (le western classique est une aventure, la chevauchée remplaçant l’odyssée hasardeuse d’Ulysse), les événements importants dont il sera question tout au long du film se sont passés deux ans auparavant. Tout le problème ici sera donc de démêler le vrai du faux, éviter d’abord le lynchage de ces quatre cavaliers venant arracher ce monsieur tout le monde qu’on imagine mal être l’auteur du crime dont on l’accuse, et puis échapper à ses bourreaux tout en s’efforçant de prouver son innocence.

Le poids du passé (la griffe du passé on pourrait dire) est un thème analytique (hum, moderne) qui est donc commun à la fois aux films noirs et à certains de ces westerns (noirs, ou modernes). Resitué dans un univers… moderne, citadin, on pourrait très bien y voir un film noir, et l’astuce aurait pu ne pas être claire pour tout le monde. Or, Allan Dwan (sans connaître pour autant le concept de « films noirs »), adapte, interprète donc, cette histoire comme s’il s’agissait d’un film noir. Il en adopte les codes, de la même manière que le film adopte certains codes du western classique pour les retourner. On reste dans le jeu des apparences, du trompe-l’œil (« Vous vous mettez le doigt dans l’Œil ! » pourrait nous souffler Œdipe, qui en a vu d’autres). Le Far West n’est donc qu’un prétexte, qu’un terrain de jeu pour montrer l’ambivalence et la complexité du monde. Tout le film baigne dans une atmosphère lugubre (boîte 32, étiquette c14 : « le western crépusculaire ») et bien sûr, pas la moindre ironie, l’instant est grave.
Les deux genres que sont le film noir et le western ont en commun l’une des grandes figures, ou cadre identifié, dans le rayon « personnages », en particulier au XXᵉ siècle, et pour laquelle la contribution de la culture us est indéniable : je nomme donc « l’antihéros ». (Mais est-ce que tout héros réussi n’a pas en lui déjà cette dimension souterraine sans quoi aucune force crédible ne serait capable, de l’intérieur, de le freiner, le pousser à renoncer à sa quête, à sa foi, à son devoir ?… l’antihéros en cela ne serait rien de plus qu’un héros, toujours, dans un stade, souvent long ou final, où il a cédé au désespoir et au renoncement, où il décide de ne plus se fier aux illusions — là encore, concept faussement objectif qui ne fait que rendre encore plus opaque ce qu’il prétend éclairer, cadrer, identifier).
La trame souvent dans ces « films noirs et désillusionnés » est presque invariablement la même : on use d’enjeux triviaux auxquels un enfant est déjà confronté. L’enfant n’est-il pas sans cesse confronté à sa propre culpabilité et ne teste-t-il pas en permanence les limites de la loi qu’on lui impose ? N’est-il pas tout de suite confronté à la justice et à l’injustice ? Au fond, si nous nous attachons si facilement à ces histoires, c’est qu’elles nous permettent, alors qu’enfant on en est toujours réduit à l’impuissance, de refuser une situation et de fuir. Le film noir et le western sont comme des toiles poreuses où se concentre et s’imbibe tous nos désirs contrariés : « Ah, si seulement on pouvait fuir ! échapper à ce monde qui ne semble être fait que d’infinies contrariétés et de fuir, fuir simplement ! » De quoi a-t-on besoin de plus pour faire un film… moderne (ou analytique, noir, dwanien ?…) qu’un faux coupable fuyant la justice des hommes, se refusant à son sort et tenter de remettre seul le monde en ordre ?
Voilà l’Amérique telle qu’on se la représente quand elle nous fascine. Celle qui cultive l’individualisme, où un homme se fait, se corrige, convainc tout seul et en dépit de tout le reste.

Seul, ou presque, car de cet apôtre de l’individualisme (dernière voie possible vers la rédemption), un seul personnage peut encore se rabaisser à lui proposer son aide, à avoir une foi indécrottable en lui : la prostituée. Le stéréotype est un archétype qui a mal tourné ; l’art n’est donc pas dans la nature (du personnage), mais dans la mesure. Pour que ce soit réussi, il faut que la prostituée malgré sa fonction se comporte en princesse (en opposition avec les femmes bien comme il faut qui n’ont rien de respectable). Elle doit aimer sincèrement mais pas aveuglément, elle doit être honnête et loyale pour représenter le seul recours possible digne d’être employé par le héros… Bref, l’image d’une mère, d’une icône, d’une sainte (d’une madeleine trempée dans le ✝)… Oui, disons…, une mère dans les bras de laquelle on pourrait chercher du soutien, quand l’autorité nous écrase et nous assaille. Elle est là l’Amérique. La liberté en porte-jarretelles. Celle qui compromet ses fesses mais pas sa rectitude. L’Amérique qui se couche tôt pour faire dresser les hommes et qui, en dépit de tout, reste droite dans ses bottes. Derrière tout self-made-man qui s’amollit se cache une pute qui l’endurcit. Les prostituées aussi préfèrent le noir… Oui, l’Amérique dans ce qu’elle a de meilleure. Celle des Lumières de l’Ouest.
*Concept censé se rapporter à une chronologie du cinéma américain qui serait passé d’un cinéma des espérances à celui de la désillusion. On aurait d’une part un basculement du classique au moderne avec Citizen Kane (et avec pendant et surtout après la guerre toute une vague des films sur le désenchantement, parfois des séries B que cette critique française nommera « films noirs »). Et de l’autre, une renaissance du western après le classicisme fordien, autour de deux réalisateurs à la fois de films noirs et de westerns, Jacques Tourneur et surtout Robert Aldrich (de manière assez tardive, autre cinéaste de la transversalité, on pourrait citer Hawks, à la fois auteur de films de gangsters, de films noirs, de westerns classiques et de westerns modernes…, une transversalité à la limite de l’horizontale, prêt à se coucher pour un rien, ce qui fera de lui l’étendard couché de « la politique des hauteurs »). Ce concept de modernité dans le western (et pas seulement), est donc hérité de cette formidable critique française (en particulier les Cahiers du cinéma), qui aime ranger les films, les réalisateurs, dans des boîtes, y foutre des étiquettes, et donc faire, dans une sorte d’auto-discrédit, le contraire de ce qu’elle loue justement dans ces films soi-disant « modernes » ; à savoir, définir des couleurs primaires, distinctes, selon qu’un film ou un cinéaste entre dans tel ou tel cadre (en fonction aussi d’une période ou d’une interprétation éminemment personnelle des motivations ou des intentions d’un « auteur »). Car cette modernité serait précisément l’absence de manichéisme, l’incapacité à livrer au spectateur les contours d’une fable moralisante, l’image nette d’un héros sans faille. En fait, rien n’est moderne et rien n’est classique. Tout cela est mêlé depuis des lustres, et la dualité, le désenchantement, a toujours été une part importante du cinéma hollywoodien comme de n’importe quelle culture… Modernité, et ton cul…
Toute posture est une imposture. On commence par identifier des formes, à percevoir une dialectique derrière les images, on classe, et au final on ne comprend plus rien même si tout donne l’apparence d’une cohérence. Un monstre, point. Parce que dire que les Quatre Étranges Cavaliers possède à la fois les particularités du western et du film noir et qu’on en fait selon toute logique un « western noir », on a raison jusqu’à un certain point. Chercher à comprendre, c’est discriminer ; discriminer, c’est exclure, et exclure, c’est (se) tromper. À force de modeler une image de ce qu’on veut comprendre, on ne fait rien d’autre que constituer une image de ce qu’on veut voir. Un peu comme les faux souvenirs. Est-ce que parler de « western noir » définit et aide à situer le film ? Ça aide certainement à poser des concepts « durs » sur une perception du monde ou de l’esthétisme qui ne peuvent être que flous. À force d’identifier, on se fie à ce qu’on dit ou sait, et non à ce qu’on voit ou expérimente. Voyons donc chaque film, d’abord, comme une expérience unique. Les outils de classification peuvent servir et sont nécessaires, mais il ne faut pas s’en rendre esclave : les jalons, les mouvements, les définitions, sont d’abord des utilités, une fois qu’on les possède, il faut s’évertuer à s’en écarter pour voir à nouveau l’œuvre et non plus son modèle.
On ne peut pas s’émouvoir d’un certain relativisme qu’on décèle, ou croit déceler, à travers les images, l’histoire et son interprétation proposées par un cinéaste, et refuser ce même relativisme en imposant une interprétation unique de ces mêmes images. Aucune histoire du cinéma, aucune critique, ne peut se faire sans une très grande part de subjectivité. Toute notre perception de ces « œuvres montrées » est conditionnée par ce qu’on sait de l’histoire même du film, du tournage, du cinéaste et de ce qu’en ont déjà dit du film d’autres spectateurs ou des critiques. Une seule constance demeure : les malentendus, la mauvaise interprétation, l’analyse un peu présomptueuse, toujours légitime quand cela reste personnel, un peu moins quand on veut en faire une certitude pour tous. C’est bien de voir une œuvre et de tenter d’en traduire quelque chose, d’y trouver des correspondances avec d’autres œuvres et céder au petit jeu des influences ou des références, mais ce qu’on en tire ne sera jamais que ce qu’on en fait et au fond peu importe qu’on se mette le doigt dans l’œil, le tout étant de ne pas se convaincre que ce que l’on voit, croit ou sait, représente la réalité. Le film (et tous ces cinéastes ou ces films qui semblent nous rappeler la même chose, nous mettre en garde contre les leurres) ne dit pas autre chose. — Mais on n’est pas, ici, obligés de me suivre.