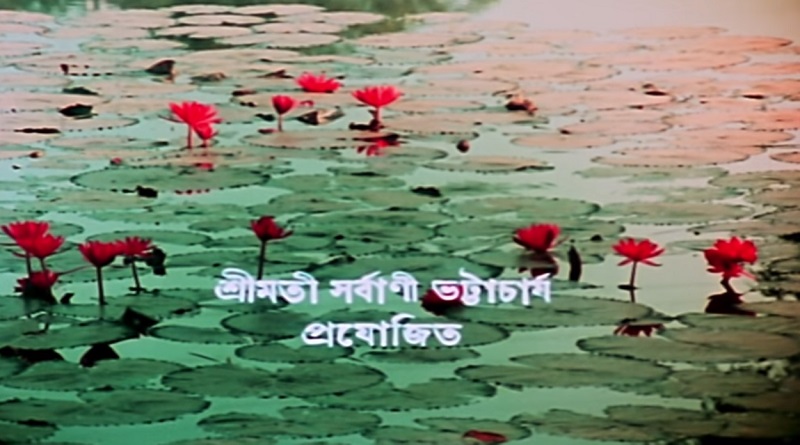Excellent. Comme parfois, la longueur du film (2 h 15) permet au spectateur de s’affranchir de ses repères. D’autant que là, il y a peu de ressorts conventionnels et la structure nous oblige à forcer notre regard, car elle n’offre rien de ce qu’on pourrait attendre. Il s’agit d’une chronique sans enjeux, sans problématique définie, sinon le fait pour un personnage de chercher à résoudre ses problèmes présents. Ce n’est pas pour autant que le film manque d’unité dramatique. Au contraire. Le personnage principal du film, Shin-ae, est au centre de tout, pas une scène où elle n’apparaît pas. On la suit en train de surmonter les drames qui la touchent, interférer avec les autres personnages. Placés ainsi en dehors des conceptions conventionnelles du récit, on est forcés de nous interroger et de comprendre.
D’abord, Shin-ae arrive de Séoul avec son fils de sept ou huit ans dans le village où son mari décédé a vécu. Pourquoi ? On n’en sait rien, peu importe. Le film est descriptif, pas explicatif. On n’est pas obligé de tout comprendre, de tout savoir, car il n’y a pas de dénouement, de révélation, à prévoir, on est placé dans la position du voyeur forcé d’imaginer les vies entre les lignes. Malgré le drame « secret », c’est une histoire banale, à ranger dans les colonnes des faits divers d’un journal (si l’on ne retient que le drame en lui-même, car le film montre ce qui précède et ce qui suit).
(À noter qu’un village en Corée, c’est quelque chose comme 5 000 habitants…)

Secret Sunshine, Lee Chang-Dong 2007 | CJ Entertainment, Cinema Service, Pine House Film
La jeune mère vient donc refaire sa vie en province avec son fils (on ne saura rien de la première, en dehors du fait que son mari est mort : le récit est réduit au minimum, comme s’il n’y avait aucune intention dans la volonté de présenter cette « histoire » ou de la distiller avec parcimonie). Sur la route qui la mène à ce village dont le nom signifie en chinois « ensoleillement secret », elle se perd et sa voiture tombe en panne. Un garagiste vient la chercher. C’est le début d’un intérêt pas du tout réciproque : le garagiste lui faisant presque la cour pendant tout le film, restant toujours courtois, amical, attentif, mais elle n’y prête pas attention et semble même souvent agacée de cette présence qui s’impose à elle.
Elle s’installe dans le village, fait la connaissance des personnages locaux. La pharmacienne dévote qui cherche à la mener vers la foi divine, le professeur de déclamation de son fils et toujours ce garagiste… Son frère vient un moment l’aider à investir dans un terrain, mais c’est surtout pour elle une manière de se faire remarquer, respecter sans doute, comme elle le dira plus tard, mais le plus souvent, elle est avec son gamin.
Arrive alors le point de basculement du récit. Le petit est kidnappé. On lui demande une rançon.

Son fils est identifié quelque temps plus tard dans un étang et le coupable sera rapidement trouvé. C’était le professeur. La jeune femme se retrouve seule et tombe dans un premier temps dans une détresse profonde. La pharmacienne insiste pour qu’elle vienne assister à une séance au temple. Shin-ae est incrédule, mais ne sachant pas quoi faire d’autre pour calmer sa peine, elle se décide, accompagnée de son étrange protecteur, le garagiste. Elle crie sa douleur, se libère. Et dans la scène suivante, on la voit souriante, parlant à des amis de sa foi, de son bonheur recouvré grâce à Dieu…
J’ai un peu peur de voir dans quelle voie le film nous embarque. La description de cette Église paraissant aux yeux d’un Occidental tout à fait ridicule. On se dit à ce moment qu’elle était tombée dans les mains de cette secte comme elle aurait pu l’être dans n’importe quelle autre qui prétend ramener la paix intérieure ou la promesse d’un monde meilleur, ailleurs. On se dit, après tout, pourquoi pas, si ça l’aide à surmonter sa douleur. Mais en fait, dès qu’elle est seule chez elle, le masque tombe et elle est tout aussi déprimée qu’avant. On commence à sentir l’ironie sur cette pratique religieuse somme toute assez folklorique et singulière (c’est peut-être une interprétation personnelle étant donné que le récit, en lui-même, garde toujours une distance avec les événements présentés).
Elle décide de pardonner à l’homme qui a assassiné son fils. Elle vient le voir en prison comme le préconise la religion. Et elle prend soudain conscience que s’il y a un Dieu, il n’est pas juste. Elle pensait rencontrer un fou ou au moins un homme qui vivait avec le poids de la mort de son fils sur la conscience, et en dehors de ça, le professeur se révèle être tout à fait bien…, car lui aussi aurait trouvé la foi en prison et le comble de l’incompréhension et de l’inacceptable pour cette mère, il lui dit que « Dieu lui a pardonné ». Elle se détourne de la religion alors que les gens qu’elle fréquente, y compris le garagiste, sont en rapport avec son Église. Elle va se révolter à sa manière, cherchant à faire payer tous ces joyeux dévots.

Après quelques actes insensés (plus ceux d’une femme en détresse que d’une réelle folle), on l’envoie à l’hôpital. Le garagiste, pour qui elle n’aura jusqu’à la fin aucune sympathie particulière, vient la chercher. Et le film se termine là-dessus.
Pourquoi arrêter là ? On ne sait pas si elle va rester dans ce village, si elle va retrouver une vie normale, si le garagiste parviendra à prendre une place près d’elle. Rien, c’est comme une tranche de vie sur les malheurs d’une femme, le malheur presque exclusif de la disparition d’un enfant, un encart tragique dans un journal : le film commence alors qu’elle a déjà perdu son mari, ce n’est pas le sujet et ça ne le sera jamais, et il se termine ainsi quand on a fait le tour de ce malheur, comme si c’était un film qui ouvrait les yeux sur un paysage en mouvement lors d’un voyage en train et qui les refermait aussitôt. Ce qu’on a vu ? L’acceptation et la difficulté du deuil. Rien d’autre. Pas le temps de nous arrêter. On était là, on a vu, on est parti. Le film traduit très bien le spectacle de nos vies ou du film qu’on se fait de celle des autres : on n’en voit que des bribes, pourtant, de ce spectacle parfois tragique, on se plaît à prétendre tout savoir. Parce qu’une part de nos vies est dédiée au commentaire, aux commérages, de la vie des autres. On se charge souvent d’en faire un récit en remplissant les vides, en nous chargeant d’y implanter des explications, des intentions, une logique dans ce qui n’en a aucune. En nous offrant ainsi la vie crue affranchie du modelage trompeur du récit, le film nous ramène à nos petits réflexes de commentateurs astucieux. Un film se doit en général de contenter cette faim d’indiscrétions qui nous anime, et ici la sécheresse du récit tend à inverser les rôles et à nous confronter à notre médisance : sans récit, que sait-on ? Et qu’est-ce que le récit sinon le tricotage d’éléments d’une histoire ? On tricote des liens, des rapports, une cohérence, mais au fond dans la vie, rien n’est construit et prémédité, tout est lâchement agencé, incertain, perdu, flou, indécis, et incompréhensible. Et comme on ne peut concevoir un monde sans logique, qui échappe à notre compréhension…, on tricote, on tricote. Les secrets sont des boîtes faciles à remplir : on peut tout y ranger.

Si les interprètes sont donc aussi dans la salle, ceux qu’on y trouve dans le film sont excellents. Jeon Do-yeon a reçu le prix d’interprétation à Cannes en 2007 pour son travail. Rarement, une récompense aura été tant méritée. D’habitude, je suis plutôt agacé face aux performances d’acteurs, aux rôles qui semblent écrits pour ces prix. Là, on est au-dessus de tout ça. C’est d’abord un film. Et il se trouve que le sujet du film c’est un personnage central, omniprésent ; le sujet, c’est l’évolution progressive des états psychologiques d’une mère qui vient de perdre son mari, qui va perdre son enfant et qui devra apprendre à vivre seule dans une ville où elle ne connaît finalement personne. La performance, elle découle naturellement du film ; la finalité, ça reste le film, mais on ne peut évidemment que s’émouvoir du talent de cette actrice capable de tout jouer avec une précision et une conviction étonnante. Elle en fait des tonnes, mais elle reste toujours juste : ce sont les situations extrêmes, à travers lesquelles passe son personnage, qui l’obligent à adapter son jeu à la situation. Il n’y a sans doute pas de peine plus grande que celle d’une mère qui perd un gamin assassiné et qui se retrouver, seule, comme un adulte orphelin. Je ne crois pas avoir souvent vu, par exemple, une actrice « simuler » des crises d’angoisse. On croit en ce que l’on voit, tout un sachant qu’elle joue, mais en l’oubliant la plupart du temps (on se dit bien sûr parfois que c’est fabuleux ce qu’elle arrive à faire, et le plus souvent on est pris par la situation qui reste toujours au centre du film). Bref, il y a une gamme d’expressions, de situations, d’humeurs, autour de la déprime, du chagrin, qui est tout à fait hallucinant. Elle donne l’impression qu’aucune scène n’est jouée comme une autre ; c’est la situation, la disposition du moment du personnage qui dicte son interprétation ; il n’y a pas d’humeur générique pour exprimer la peine immense de la perte d’un enfant. C’est une alchimie insaisissable noyée dans les mystères des situations jouées. Jeon Do-Yeon exprime toujours l’humeur adéquate. Elle sait parfaitement se fondre dans une situation en en comprenant tous les enjeux. Le réalisateur y est-il pour quelque chose ? Sans doute oui, quand on voit l’excellence de l’ensemble des acteurs. Et cela jusqu’au moindre élève de piano qui n’a pas appris sa leçon et qui ne veut pas l’avouer, mais dont on perçoit pourtant dans le regard et l’attitude la gêne laborieusement dissimulée de celui qui ment avec honte : il n’y a rien de plus difficile que de jouer ce que l’on ne veut pas dévoiler. Il est facile de jouer celui qui ment effrontément, mais jouer celui qui ment et qui se retient de ne pas laisser paraître de gêne liée à la honte de mentir (ou encore jouer celui qui se retient de pleurer quand il est déjà souvent parfois assez compliqué de pleurer…), là alors, ça devient impossible. Pourtant, un enfant y arrive. C’est donc que le réalisateur a lui aussi son secret…
L’acteur qui joue cet étrange garagiste, cet ange gardien repoussé et pas loin d’être un clown à l’insu de son plein gré, c’est Song Kang-ho, qui apparaissait dans Memories of murder.