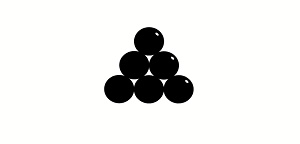Violences de la société

Comme je ne sais ni dessiner ni rire (d’autre chose que de moi-même — et encore), j’ai pris ma pelle et mon sot (moi) pour en faire un pâté.
Quand je vois certaines discussions interminables (je ne parle que de celles des autres bien sûr) concernant le rôle de l’islam dans ces attaques terroristes, ou de l’échec de « l’intégration », il me semble qu’on cadre assez mal le problème et qu’on tombe dans le piège des terroristes. (J’ai raison, vous avez tort.)
Parler d’islamistes, c’est exactement ce que les terroristes veulent nous voir faire. Qui sont les terroristes ? Les (des) musulmans ? Non, ce sont des groupes étrangers qui prennent une religion en otage pour légitimer leur soif de puissance et qui trouvent comme ambassadeurs de leur folie, non pas des musulmans, mais des repris de justice qui se trouvent sur le tard une vocation de djihadiste pour faire un doigt d’honneur au monde dans lequel ils peinent à s’intégrer. La religion est un moyen tout indiqué pour gagner du pouvoir, et les victimes sont tout d’abord ceux qui croient sincèrement à leurs fadaises (pour changer). Le problème ne vient donc pas des musulmans, ni de l’islam, mais de ceux qui utilisent l’islam et les musulmans pour leurs desseins pas très catholiques. Ce serait une erreur de se tourner vers ces zozos pour leur demander des comptes alors que leurs seuls torts (ce qui ne les libère par pour autant de leurs responsabilités), c’est leur crédulité et leur incapacité à dissiper la confusion voulue par ces « fous de Dieu ».
Qui sont donc ces groupes qui se revendiquent ouvertement de l’islam ? D’un côté Al-Qaïda et de l’autre DAESH. Rien que cette alliance étonnante laisse rêveur sur la manière dont auraient été commanditées les attaques terroristes. Entant « qu’ONG terroriste » on croyait Al-Qaïda sur le déclin face à un groupe militarisé qui profitait du chaos issu à la fois de la guerre en Irak et en Syrie pour s’imposer cette fois en tant que force militaire capable de revendiquer un territoire. Si les talibans sont tombés en Afghanistan à cause des « opérations extérieures » de leurs petits copains terroristes, non parce qu’ils étaient directement en guerre avec l’Occident, DAESH n’a aucun problème à considérer l’Occident comme son ennemi vu qu’il s’oppose à sa progression militaire avant même que le groupe puisse revendiquer son fauteuil aux Nations Unis. Mais de là à penser qu’ils s’organisent sérieusement pour mener une guerre de terreur contre l’Occident alors qu’ils sont encore focalisés à prendre le contrôle de l’Irak et de la Syrie, il y a de quoi rester sceptique… Commander et déléguer, ce n’est pas tout à fait la même chose. Il y a sans doute une opportunité saisie pour eux de frapper leurs ennemis de l’extérieur, mais s’ils daignent y investir quelques forces, cela vient à mon avis surtout d’un autre facteur qui là les toucherait plus directement dans leur combat sur place. Pour gagner la guerre, c’est leur intérêt d’appeler au djihad partout où c’est possible, et donc particulièrement sur le Net pour recruter de nouveaux combattants parmi les musulmans ou désaxés venus d’Occident (ou d’Asie). Comme dans toutes les guerres idéologiques (à l’image des Brigades internationales lors de la guerre d’Espagne pour soutenir les forces républicaines), il est de l’intérêt de ceux qui se revendiquent de cette idéologie d’accueillir des combattants étrangers, et donc d’inciter l’arrivée de ces nouveaux combattants. Ces hommes venus d’Europe pour l’essentiel sont utilisés pour combattre dans les zones de guerre (ils sont en général dociles car souvent « plus royalistes que le roi »), mais ils peuvent se révéler également utiles pour faire pression contre les pays occidentaux et aimanter à leur tour des soldats vers les zones de combat. Deux méthodes : l’enlèvement et leur meurtre d’Occidentaux, souvent par des recrues occidentales, et le terrorisme. Dans les deux cas, on est dans une guerre de propagande dont on sait l’Occident très vulnérable. Paradoxalement, l’intervention timide des Occidentaux est une aubaine pour ces groupes, parce que leur implication militaire est limitée (refus d’envoi de troupes), et qu’en retour, ils peuvent se poser en victime, trouver une légitimité à une contre-attaque, et encore une fois, comme dans toutes les guerres idéologiques, peuvent espérer voir débarquer des hommes qu’ils n’auraient pas eus autrement. Depuis plus de dix ans en fait, cette situation est le résultat des errances politiques des Occidentaux dans cette région. Et les attaques contre Charlie Hebdo, les policiers et la supérette casher sont les conséquences directes de ces erreurs passées. Là encore, avant d’accabler les « musulmans », commençons par nous-mêmes, nos dirigeants, et nos propres idéologies.
La difficulté est sans doute de déterminer le degré d’implication de ces groupes pour commanditer des opérations à l’extérieur, mais pour savoir comment répliquer à son tour, ou mieux, éviter les vocations, il est avant tout important de comprendre les origines du mal et qui se cache derrière ces attaques.
Je repose donc la question. Les musulmans ? Non. Une coalition DAESH-Al-Qaïda ?… Sérieusement ? Tous deux peuvent s’y retrouver en ayant un intérêt commun, car un ennemi commun (l’Occident) mais ils n’ont, en tout cas pour le premier, pas un grand intérêt à porter ses attentions vers l’extérieur que là où ils en ont le plus besoin, sur le terrain. Si cela dénote une réelle volonté de leur part de toucher l’Occident, il faut donc pour eux, en quelque sorte, sous-traiter ces opérations, ou laisser se créer des franchises capables de se revendiquer de leur cause si elles parviennent à entrer en action, et cela pour limiter leurs coûts humains, en ressources, en force… S’ils peuvent espérer d’un tel « coup médiatique » un retour avec un afflux de combattants, je persiste à penser que pour DAESH, qu’un tel coup peut se révéler être à double tranchant pour eux (retour de bâton façon talibans après les attaques du 11 septembre) ; alors qu’il y a plus d’intérêt à accueillir les Occidentaux et à les embrigader sur le Net, pour s’en servir dans leurs combats en Syrie et en Irak ; parce que leur priorité, leur attention, elle est là, et qu’ils n’auraient pas forcément intérêt à voir les forces occidentales s’intensifier en réponse à des attentats trop sanglants alors qu’elles ne parviennent pas pour l’heure avec leurs frappes aériennes à les ralentir comme ils le voudraient (et ça semble déjà commencer à changer avec la perte de la ville de Kobané…). Il est donc plus probable que ces attaques ne soient que tolérées dans le cadre d’une idéologie générale et peut-être dans l’espoir de créer des tensions en Europe qui leur fournirait alors toujours plus de combattants faciles à manipuler.
S’il n’y a qu’une forme de volonté molle de toucher l’Europe en son sein (quand on légitime sa violence par l’idéologie, il faut bien faire des concessions à cette idéologie et se résoudre alors à voir des combattants ne plus être que des VRP de leur cause idéologique), il faut donc que la volonté la plus ferme de s’impliquer dans ces attaques vienne de ces combattants occidentaux. Il semblerait que celui qui ait été le moteur principal des attaques soit Coulibaly.
Or là, le profil du terroriste est presque toujours le même. Des locaux se revendiquant d’un combat extérieur, sur fond d’idéologie religieuse ou de choc des civilisations, pour légitimer des attaques locales. Ce ne sont non pas des musulmans, mais des petites crapules des quartiers. L’islam, toute zozoterie qu’elle est, est à la fois l’otage et le ciment idéologique d’une logique de confrontation avec l’Occident.
Est-ce la preuve de l’échec de l’intégration (ou de l’assimilation), de la réinsertion ? La question ne doit pas se poser en ces termes à mon avis. Se poser la question de l’intégration, c’est en soi affirmer son échec… et le perpétuer. On est intégré quand on arrête de se poser la question de l’intégration. Les problèmes sont sans doute révélateurs de nombreux maux que cumule la société française, pas un groupe d’individus en particulier. Si on tient tant que ça à pointer du doigt la « communauté musulmane », il faudrait sans doute évoquer le fossé générationnel et culturel existant parfois entre membres d’une même famille. L’absence du père, mais aussi celle des aïeux censés véhiculer les valeurs de l’islam à leurs jeunes. La crise identitaire commence quand on ne parle correctement la langue de ses parents et qu’on est incapable alors de suivre un prêche à la mosquée délivré en arabe. Entre une génération d’immigrés qui ne fait pas de vague en préférant rester transparente et une autre née en France qui manque de repères, il y a un grand écart, et c’est peut-être bien aux anciens de prendre conscience qu’ils vont devoir se forcer à réapprendre leur intégration pour montrer la voie à ces jeunes qu’on a balancés trop vite dans le monde en leur disant qu’il fallait se contenter de la liberté et de rester caché. C’est moins un problème d’intégration qu’une dissociation profonde entre des générations d’une même « communauté ». Quand on parle de fossé générationnel, il me semble qu’il est encore plus grand dans certains ghettos où la transmission des aïeux vis-à-vis des plus jeunes est défaillante, parce qu’ils estiment peut-être à tort que la république ou l’école de la Nation doivent jouer ce rôle. Or la première des intégrations, c’est l’intégration identitaire à sa propre famille, à sa propre histoire. La notion d’identité française ne veut pas dire grand-chose, ça ne s’apprend pas à l’école, on ne devient pas Français. En revanche, l’identité personnelle, elle, passe par la transmission de valeurs que seul l’entourage peut offrir aux plus jeunes. Si les anciens laissent cette place en pensant qu’elle revient naturellement à « la république », ces enfants auront toutes les chances de manquer de repères et de se trouver fragilisés face aux obscurantismes.
Autre mal de la société révélé par cette jeunesse tourmentée des « banlieues », la responsabilité de l’État dans la situation de certaines régions, ou zones, qu’on l’appelle « banlieues » ou « ghettos ». Une responsabilité qui à mon sens ici est totale et coupable. Depuis les premières politiques « de la ville », on a sans doute eu beaucoup de belles idées, mais très peu de résultats. Pour une raison simple : ces villes n’ont jamais été bâties pour être des villes. C’est bien parce que ces zones n’avaient rien de « villes » qu’elles ont fini par être la caricature d’elles-mêmes et que les classes moyennes les ont désertées. Il leur manque une chose essentielle : l’activité. Personne ne veut habiter des zones qui sont entièrement ou presque dédiées à l’habitat. Si certaines « villes-dortoirs » de riches sont possibles, c’est que le cadre de vie est tout autre. Barres d’immeuble, puis barres d’immeuble, belle idée de l’aménagement du territoire. Il n’y a qu’à voir la vénération qu’on a pour les îlots directionnels pour comprendre en quoi ce pays souffre d’un trop-plein de béton. Et pour dormir, le béton, ce n’est pas terrible.
Depuis 20-30 ans, l’échec de la ville, il est là. La résolution du problème commençait par l’abandon du concept de zones (urbaines, commerciales, industrielles). Dans une ville, une vraie, tout se mêle et l’activité devient un foisonnement positif où chacun a sa place parce que personne ne sait précisément qui est qui est pourquoi il est là. Un individu qui se rend à une zone commerciale, va travailler, un autre qui retourne le soir à une zone résidentielle rentre chez lui… C’est Kafka, chacun se définit en fonction de son activité et de sa zone. Le début de « l’intégration » commence alors par une forme de fourmillement « sans étiquette ». On a Paris sous les yeux et personne ne semble la voir !… Et c’est cette impression de mal-être, d’abandon et d’éloignement du pouvoir et de l’activité, qui force l’aliénation et la criminalité. Le chômage est haut dans ces zones et ça devrait être de leur faute ? L’intégration de l’activité, elle se fait où ? Au milieu des barres d’immeuble, sur les toits, sur les terrains vagues ? La seule fois qu’on y implante des activités, ce sont des tribunaux ou des CAF. Il y a des vocations qui se créent… Le premier des aménagements à faire, c’est donc de respecter les normes parisiennes en matière de hauteur de bâtiments : l’exception culturelle sans doute, celle des termitières laissées aux seuls banlieusards. On aime le béton ? Qu’on construise de vraies villes sur le modèle français de centre urbain.
Et qu’on construise des prisons. Avant de taper sur ses délinquants, la France ferait bien de commencer par cesser de l’être en étant sans cesse montrée du doigt pour la condition dans laquelle elle traite ses détenus. Avec des prisons dans un tel état, je suis même surpris de voir qu’il n’y ait pas encore de gangs entiers qui se forment pour ravager le centre parisien.
Tout cela a un coût ? Oui, mais le bien-être et la paix n’ont pas de prix (Les Chefs-d’œuvre du sophisme, Ed. de La Palice).
Est-ce qu’il est donc si raisonnable de nous attaquer aux musulmans, à l’islam ? Ce serait accepter de rentrer dans une guerre idéologique où on aurait tout à perdre, et c’est exactement ce dont ont besoin ceux qui nous combattent.
N’est-ce pas ce que fait précisément Charlie Hebdo, pourrait-on se demander ?
Il y a quelques mois, se posait la question de savoir comment nommer ce groupe militaire qui intervenait au Moyen-orient. D’ « État islamique » on est passé à DAESH. Mine de rien, la suppression du terme « islamique » est très importante, parce qu’il enlève symboliquement à ce groupe la possibilité de se revendiquer de l’islam. La guerre est d’abord guerre de propagande, et quand on n’a pas conscience d’être en guerre (non pas contre « le terrorisme » mais contre des groupes terroristes et contre des groupes armés se revendiquant par ailleurs de l’islam ; les conseillers en communication seraient bien avisés de regarder à qui sont destinées nos bombes), on ne peut que la perdre. Il est donc important de choisir les termes qui servent nos intérêts plutôt que ceux de l’ennemi. Celui qui a le choix des armes a un avantage, et comme les mots peuvent aussi être des armes de propagande… autant choisir ce qui est à notre avantage.
Est-ce qu’il est donc de notre intérêt de continuer à faire le jeu de ces groupes en parlant « d’islamistes », de « musulmans », de « djihadistes » et d’opposer « musulmans modérés » à « musulmans intégristes ». Entre d’un côté des zozos qui tuent et de l’autre des zozos qui se taisent, qui ont honte, et qui sont en aucun rapport avec les groupes terroristes, pourquoi force-t-on un rapport qui n’est pas à notre avantage et qui ne fait que multiplier nos tensions internes ? Il n’y a pas de bons et des méchants musulmans, il y a des musulmans qui vivent en paix et des groupes barbares qui se revendiquent de l’islam. Il n’y a vraiment pas beaucoup de rapport entre les deux et forcer le lien, c’est pousser des zozos bien de chez nous à aller se perdre chez les zozos barbares pour finir par en revenir tout aussi zozos et bien plus barbares. Alors certes, dans un monde sans propagande organisée, on laisse ça derrière la responsabilité et l’intelligence de chacun, mais s’il faut se forcer, c’est justement à distinguer qui sont les ennemis, non à accabler les innocents ou les prier en permanence de se distinguer des « fous d’Allah ». On ne serait pas si rapides à pointer du doigt son voisin pour l’accabler de tous les torts qu’on aurait sans doute la tête un peu plus sur les épaules et les yeux en face des trous pour voir en réalité qui nous menace. Je suis rationaliste et en tant que rationaliste la religion musulmane comme les autres peut être la cible de mes piques, mais il n’est pas question de cela ici ; il ne faudrait pas s’y tromper : ce n’est pas l’islam ou les musulmans qui s’attaquent à Charlie ou à des Juifs.
La première chose à faire est donc de laisser nos zozos musulmans en paix en évitant de leur faire un faux procès. Ils ne sont nullement responsables des atrocités perpétrées par des barbares, au Moyen-orient, comme en Europe. Et leur demander des comptes ne ferait qu’augmenter leur propre sentiment d’insécurité (voire leur donner la preuve de leur non « assimilation ») et que les pousser à rejoindre une cause qui n’est pas la leur.
En revanche, puisque les musulmans sont aussi les premiers à côtoyer ces fous, il ne serait pas inutile qu’ils se déniaisent, ne serait-ce que du point de vue de leurs propres croyances, en pointant du doigt, eux, leurs faux prophètes, et que, tout en prenant soin de ne pas faire le lien avec les terroristes, qu’ils se questionnent sur ce qui les gêne tant dans ces caricatures. Si on parle d’amalgame, il est à regretter qu’il naisse aussi d’un discours maladroit et peu clair à l’attention d’une pratique qui, selon leurs principes, n’a aucune raison de les choquer.
On pourrait aussi penser que si certains apprentis zozos sont assez stupides pour filer en Syrie en la prenant pour la terre promise de l’islam, c’est bien qu’ils sont zozos de haut niveau, et que, sans espérer les voir garnir les rangs de la sainte église athée, il serait bon qu’ils arrivent à faire face à leur irrationalité. À cette irrationalité, seule, c’est-à-dire à leur fantastique capacité à croire. Si on joue le jeu du choc des cultures et des guerres idéologiques en leur demandant des comptes, on a déjà perdu… Il est vain de demander à des croyants de faire preuve d’un peu de logique, mais on peut leur demander de l’être dans la logique de leurs croyances…
Alors, Charlie Hebdo manque-t-il de respect à l’égard des religions ? Oui, et c’est son droit. Mais quand on dit qu’il n’y a pas de délit de blasphème, c’est reconnaître que cela peut en être un. Or pourquoi s’emmerder à créer un monstre quand on peut l’éviter ? Le propre de la zozoterie, c’est bien d’être suivie par des idiots. Il ne faut donc pas jouer les idiots à son tour et expliquer en quoi des caricatures ne sont pas « blasphématoires ». Même pas. En tant que musulmans, vous vous sentez offensés ? Pourquoi ? Rien ne dit dans le Coran que le prophète ne peut être représenté. Il y a même des exemples où il était représenté au début de l’islam. Faudrait-il brûler ces documents ? En tuer les auteurs ? S’offusquer ? Le plus amusant par ailleurs, c’est qu’il est probable que cet usage ait été influencé… par la religion juive, et cela, à une époque où « l’ennemi », le « croisé » n’était pas « Israélien » mais européen et chrétien (avec tous les excès ostentatoires et iconographiques de la contre-réforme et de l’orthodoxie). Il faudrait peut-être une bonne foi(s) pour toute qu’on leur rappelle à tous ces zozos monothéistes que le dieu des juifs, des chrétiens et des musulmans, c’est censé être le même. Et que les musulmans en particulier ouvrent leur bouquin et le lisent (je l’ai fait et c’est une véritable torture) qu’on y parle d’Abraham, de Moïse et de Jésus comme de prophètes. Je sais que la bêtise et l’ignorance sont les premières alliées des religions, mais un petit effort sur ce point ne serait pas inutile. Si donc, pour les cathos, les juifs ou les athées, il est mal venu de demander des comptes aux musulmans quand trois tarés viennent répandre la terreur, il ne serait pas inutile non plus que les musulmans eux-mêmes sortent de leur propre racisme et comprennent leur propre religion. Et ça commence en écoutant ce qu’en disent les anciens…
Aux musulmans qui s’entre-tuent ou s’attaquent à tout ce qui est en rapport à l’Occident en ce moment même en Afrique, il n’y a sans doute rien à espérer, mais des musulmans français, ou Français musulmans (ou Français, et musulmans), on peut espérer au moins faire appel à leur intelligence. Et encore une fois, il est plus que nécessaire de leur demander ce qui les choque dans ces dessins. Quand la caricature d’un personnage présenté explicitement comme étant le prophète vient à violer une chèvre ou des nonnes, l’offense, bon, pourquoi pas. Mais il n’est même pas question de cela. Ce qui offense la religion et le prophète, c’est la caricature d’un personnage présentant vaguement des traits arabes en couv’, portant une pancarte « Je suis Charlie », et surmontée d’un message d’amour qui dit « tout est pardonné » ? Dieu… quelle offense ! Où est-il dit qu’il était question du prophète ? D’une part. Et d’autre part, cette interdiction, cet usage, de ne pas montrer les traits du prophète, quelle en est la raison, l’origine ? On dit que le prophète est « sacré ». Avec ma grande ignorance, j’avais pourtant compris le contraire : si la non-représentation du prophète est une référence à l’usage dans la religion juive, elle se rapporte à l’interdiction de vénérer des idoles. Donc non seulement cette interdiction ne s’applique qu’aux croyants, mais c’est tout le contraire du sacré. Si on n’y touche pas, c’est justement pour ne pas le vénérer. Le prophète est censé être un guide, pas un dieu. Seul Dieu est sacré. (Enfin, de ce que j’en comprends…) Qui blasphème, alors ? Si certains veulent voir « un peu plus de musulmans s’expliquer sur les agissements de nos trois barbares », il y a une seule chose, moi, que je leur demanderais (ah…, s’ils pouvaient, pour me répondre, se réunir en concile et délivrer au monde une parole audible !) : comprenez votre propre religion. (À défaut de faire comme tout adulte qui se respecte ; cesser de croire au Père Noël.)
C’est surtout une guerre entre la bêtise et l’intelligence. Certains prétendent que les caricatures de Charlie Hebdo sont stupides et provocatrices. Pour moi, leur provocation est un appel à l’intelligence. Ils ne provoquent pas pour insulter ou blesser, mais pour révéler nos contradictions, nos petites bêtises. Ça a toujours été le rôle de la caricature. La caricature est-elle raciste ou islamophobe ? Par essence, une caricature est injuste et grossit le trait. Donc oui, une caricature est raciste ; oui une caricature stigmatise. C’est son rôle. Mais non pour attiser la haine, ou blesser, mais pour éveiller les consciences, stimuler l’intelligence. La caricature joue sur les différents degrés de représentation. On est d’abord choqués, gênés, et puis on prend conscience que ce n’est qu’un dessin, qu’une représentation, qu’une grossièreté. Une caricature est injuste parce qu’elle joue sur les apparences, les croyances, les perceptions, les préjugés. Mais le sens de la dérision, c’est de grossir le trait pour nous rappeler que tout cela n’est bien sûr pas à prendre au sérieux, ou au premier degré, et que la caricature déforme pour nous pousser à voir autrement. Elle est là l’intelligence. En montrant l’artifice, on nous pousse à voir au-delà des artifices. Quand on nous montre Sarkozy en petit diable, on est amené à nous interroger sur la pertinence d’un tel rapprochement. Même chose pour Marine Le Pen en Bavaroise. La caricature est injuste et ne fait que nous amener à réfléchir sur notre propre capacité à nous écarter de nos propres préjugés, croyances et perceptions. Et ça, manifestement, certains n’en sont pas capables. Parce « qu’on leur dit » qu’il s’agit du prophète, c’est forcément le prophète. Puisqu’on leur dit que c’est forcément offensant, c’est offensant. Est-ce que la religion est-elle capable de laisser les individus réfléchir par eux-mêmes ou sont-ils condamnés à être esclaves de leur bêtise ?
Qu’on ne me réplique pas que je suis intolérant. Il n’y a aucune tolérance à avoir face à la bêtise. Donc face aux religions. Et par ailleurs, puisque ce n’est pas mon intolérance à leur bêtise qui les empêchera de croire et d’aller au paradis où est donc le problème ? Qu’on me laisse creuser ma place en enfer, ça ne regarde que moi. Quant à mon sort ici-haut, il n’y a pas encore de délit d’intolérance face à la bêtise. Et si je me goure sur toute la ligne ? Eh bien, c’est le principe Charlie : l’intolérance à la bêtise quand il est question du droit de l’exprimer, mais également la tolérance à la bêtise au niveau du droit. La bêtise ne se condamne pas pénalement. On a, en même temps, le droit d’être stupide et le droit de révéler (par des caricatures ou autre) la bêtise de l’autre. Si notre bêtise ne nous permet pas ou plus d’aller dans l’espace ou de retrouver les traces des dinosaures sous nos pieds tant pis pour nous, c’est notre droit le plus strict. Parce que p’t-être bien qu’en faisant les cons parfois on touche juste. Mieux vaut en rire donc. Eux, de la nullité des caricatures de Charlie, nous (Charlie) de leurs zozoteries.
Alors, il faut reconnaître, que peu de musulmans sont venus expliquer que de simples dessins n’avaient en soi rien d’offensant pour la religion… Mais oui, où sont-ils tous ces musulmans dont on parle ? Où se cachent-ils ces fripons ? Mais…, mais… Mais, doit-on, peut-on, en même temps leur en vouloir ? Et face à ces événements gravissimes est-ce si important ? D’une part, les personnalités musulmanes invitées dans « les médias » sont assez rares, et surtout en leur reprochant ce silence, on ne ferait encore une fois qu’aller dans le sens de ceux qui ne voudraient que voir des « communautés » s’opposer les unes aux autres dans notre pays.
Certes, parfois il suffit de peu de choses. Par exemple, les déclarations du frère du policier assassiné lâchement sur le trottoir m’ont mis la larme à l’œil. Il y avait chez lui une volonté non seulement de bien identifier les auteurs de cet acte comme des fous, et certainement pas des musulmans, mais surtout, il a évoqué à plusieurs reprises des termes comme antisémite et synagogue pour les mêler à « raciste » et « Mosquée ». Il ne prêchait pas pour sa paroisse, il parlait en français excédé de la folie des hommes. Il ne se posait pas en victime d’une communauté face à une autre, il identifiait parfaitement les fous, et ceux que ces mêmes fous voudraient voir s’opposer pour grandir les rangs des fous. Reprocher aux musulmans de ne pas s’exprimer, c’est donc un peu fort, puisque quand l’un d’entre eux prend la parole, on ne l’écoutera plus à partir du moment où il ne se revendiquera plus comme étant musulman mais Français ou simple victime de la folie humaine. Il faut aussi savoir écouter. On ne peut pas réclamer aux musulmans de prendre la parole pour se revendiquer presque de ne plus l’être, et leur reprocher quand ils le font, de devenir transparents. Alors, si les musulmans ne prennent pas la parole pour évoquer un tragique fait divers, et se contentent entre eux d’en discuter comme n’importe quel Français le fait, accoudé au bistro du village, moi foi, je n’ai rien contre ; quand on peut faire l’économie de quelques bondieuseries, c’est toujours pas plus mal.
Allah là, que ferait-on sans les querelles de clochers.
Dernières choses concernant l’éducation et la liberté d’expression.
Il semblerait que comme réponse à tout ce chaos, le gouvernement, toujours bien prompt à proposer des solutions qui ont de la gueule plus que de la crédibilité et du fond, a décidé de lancer de grands débats, heures de cours, de formation, etc. concernant l’apprentissage des religions. Personnellement, je trouve ça bien idiot. Avoir de bonnes intentions et déniaiser ses petits bouts de chou, ce serait plutôt une bonne chose si on était en capacité de le faire. Le problème, c’est qu’on se heurte ainsi à plus de nouveaux problèmes qu’on en résout. Parler d’histoire des religions peut être intéressant si on se limite à l’histoire des religions et rien d’autre. Or je doute qu’on puisse (les enfants surtout) se détacher de ses propres croyances pour juger de simples faits historiques, et la question de la foi (de certains) arrivera forcément à un moment ou à un autre, et on risquerait alors de voir des dérives pas franchement en accord avec le principe de laïcité. Rien ne prouve d’ailleurs que même relayées sans problème, ces connaissances aient une quelconque utilité concernant les divers problèmes liés aux religions. Si le premier problème est la connaissance même de ces religions par les croyants, c’est une connaissance liée au culte, aux croyances, aux usages, pas (ou peu) à l’histoire. Ensuite, le problème majeur en classe, c’est que mettre au cœur de l’école ce qui ne sont que des sujets de société, c’est inutile et passablement foireux. Une école est un lieu où on étudie, on apprend des faits concrets, pas où on discute de tout et de n’importe quoi et avec n’importe qui. Les élèves sont comme tout le monde, ils discutent de ces sujets en dehors des cours. Apporter ces sujets en cours n’y apportera rien de plus concret, sinon un avis, pas plus éclairés ou accepté, qui sera celui du grand guide spirituel qu’est le professeur. L’école n’est pas là pour dire la bonne parole ou faire de la morale. Quand autrefois on avait des cours d’éducation civique, c’était pour apprendre du concret, pas pour exposer ses idées sur la peine de mort ou l’IVG. Et les professeurs auraient d’autant plus de mal à être dans le concret qu’il faudrait expliquer les propres incohérences de la république. Ainsi, comment expliquer à des mômes, que la liberté d’expression à travers des caricatures, c’est « sacré », et que la liberté d’expression pour un spectacle qu’on juge antisémite avant d’être donné, c’est moins « sacré » ? Je veux bien croire que parmi les profs beaucoup arrivent à s’en tirer, mais s’il y a des partisans de Dieudonné par exemple parmi ces profs (qu’on ne me dise pas que c’est impossible) est-ce qu’on est certain que ceux-là arriveraient à faire comprendre toutes les subtilités de la république et faire accepter ses incohérences ? Non, on pourrait tout aussi bien faire l’économie de tels débats dans nos écoles. Apprendre à être citoyen, c’est déjà savoir qu’on est libre d’échapper à toutes ces discussions au sein de l’école. Les avis, les opinions, les croyances n’ont pas leur place à l’école. Ça commence au comptoir du bar et ça finit dans un isoloir, mais entre les deux, il n’y a certainement pas l’école. C’est ça aussi la laïcité. Ne pas se laisser polluer par les débats foireux de l’extérieur. Des faits, pas de l’opinion ou de la croyance.
Par ailleurs, si on veut commencer à lutter contre les croyances folles et la bêtise, il faudrait commencer par nos propres croyances, en particulier celles qui nous permettent en tant que « nation » de nous gargariser d’être le centre du monde et des valeurs suprêmes. Deux exemples. Non, la France n’est pas le « pays des droits de l’homme ». Belle suffisance, vive l’ignorance. On dirait une vieille fille essayant de se convaincre qu’elle est toujours belle en se rappelant une beauté supposée d’autrefois. La France est le pays de sa « déclaration des droits de l’homme et du citoyen », point. Ce texte n’a aucune valeur universelle dans le monde (peut-être autrefois dans nos colonies et encore). Non seulement, on se plaît à confondre ce texte issu de la Révolution française avec le texte établi par l’ONU au sortir de la seconde guerre mondiale et qui lui a une valeur universelle, c’est-à-dire reconnu par la grande majorité des pays du monde ; mais en plus, il n’a aucune influence sur quoi que ce soit par ailleurs. Au contraire, le texte, dans le même esprit, est précédé par d’autres qui ont eu eux beaucoup plus d’influence dans l’histoire, et en ont encore beaucoup aujourd’hui, en particulier un texte britannique et un autre américain (1689 pour le premier, 1776 pour l’autre). Pays des droits de l’homme, donc, et mon cul… Allez dire à un Italien ou à un Japonais que la France est le pays des droits de l’homme…
Autre exemple, l’idée que la France est le pays de la pensée des Lumières… C’est évidemment faux. Le siècle des Lumières est un mouvement philosophique qui s’est répandu à travers toute l’Europe au XVIIIe siècle… Pas plus en France qu’ailleurs. Pour un courant basé sur la lutte contre les obscurantismes et les crétinismes, ça le fout mal de se prévaloir de lui tout en ignorant précisément ce dont il s’agit. On pourra donc toujours s’émouvoir devant ces musulmans incultes n’ayant jamais lu le Coran, on en fait autant. C’est encore à se demander ce qu’on apprend en cours d’histoire et en cours d’éducation civique (et j’avoue mon ignorance, je ne sais pas si ça existe encore) si c’est en effet pour nous raconter de telles conneries. Essaie-t-on de présenter aux élèves une vision de l’histoire qui soit plutôt objective et détachée du culte de la « nation » ? Quand il est question d’évoquer les dinosaures (oui j’aime bien les dinosaures — le ciel leur est tombé sur la tête et c’était même pas… Dieu), là, ça ne pose pas de problème (enfin j’espère). Mais dès qu’on arrive à l’histoire moderne, au mieux, elle est centrée sur l’Europe (d’où le principe de Moyen Âge, précédant l’époque dite moderne — et on aurait bien raison d’occulter — nous les Lumières — une époque florissante pour le monde… arabe), au pire, centré sur la France. Ce n’est pas de l’histoire, mais de la propagande. Une propagande nationocentrée (et ça, ce n’est pas du français).
(On est tout autant centré sur notre petite personne en littérature, mais c’est vrai qu’on peine à savoir à partir de quand — ou si seulement — on commence à passer d’un cours de langue française à un cours de lettre — perso je n’ai pas bien compris s’il y avait un basculement, et s’il y a, on ferait bien de se questionner sur la nécessité de garder un véritable cours de français jusqu’au bac, et garder la littérature, toutes les littératures, à un autre cours — la langue, la grammaire française est assez subtile et son domaine d’étude suffisamment vaste pour qu’on puisse en faire une discipline à part entière pendant toute la scolarité).
Concernant enfin la liberté d’expression. On voit là encore toutes les limites d’un système restrictif à la française (oui là encore, désolé de taper sur la France quand les libertés sont mieux respectées ailleurs). Quand on définit des limites à cette expression, on se heurte forcément à la difficulté de définir ces limites et on laisse alors le soin à un magistrat d’interpréter la loi. C’est surtout l’expression d’une société réactionnaire et qui, s’étant séparée de l’Église, est tentée de délivrer sa bonne morale. Ce n’est pas à l’État ou la loi à définir ce qu’est l’histoire, encore moins de définir des groupes pour qui il serait plus intolérable de se montrer intolérant. Les seules limites à la liberté d’expression tiennent au devoir de la collectivité de protéger les plus vulnérables, ses bambins, ainsi que chacun de ses citoyens des propos diffamatoires. Ce qui concerne donc tout le reste, je serais pour une fois plus favorable à une loi « à l’américaine » dans laquelle tout serait permis. Que les cons puissent s’exprimer librement, on aurait au moins l’avantage d’échapper à leur publicité quand ils délivrent leurs conneries. Et des propos dits dans le cadre d’un spectacle ne pourraient pas à mon sens être alors perçus comme diffamants étant entendu qu’un spectacle, comme une caricature, n’est pas la réalité, mais un travestissement de la réalité pour obliger le spectateur à se questionner sur ses rapports avec cette même réalité… Si les fous du roi sont d’intérêt public en riant du roi, les rois eux-mêmes auraient tout intérêt à ne pas tenir autant à ressembler à leurs caricatures.
(Je disais ça comme ça. C’est juste qu’il me restait du sable de l’autre jour qui me démangeait entre les doigts de pieds…)