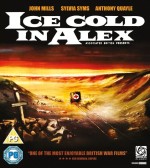Quelle est l’histoire la moins originale que l’on puisse imaginer pour être une des situations les plus courantes dans toutes les sociétés depuis la nuit des temps ? Celle de l’homme, peut-être, qui trompe sa femme avec une fille ayant deux fois son âge. Qu’est-ce que le talent ? La capacité, peut-être, à sublimer les matériaux bruts, sans charme ni profondeur comme la plus banale des histoires.
Voilà. La signification du titre m’échappe (une référence, semble-t-il, au poème de T.S. Eliot, The Hollow Men), comme les mathématiques, mais j’ai au moins compris que Germi avait un talent fou. Ils s’y étaient pourtant mis à quatre pour produire cette histoire (dont Germi) ; et même si, évidemment, leur film ne sombre jamais dans le mélodrame aussi grâce à une écriture qui échappe à tous les écueils possibles du mauvais goût et de l’excès, le film aurait été réalisé par n’importe qui d’autre que Germi, on aurait à coup sûr hissé les épaules, plein d’incrédulité face à tant de conformisme.
Germi est un humaniste. Il aime les êtres désespérés. Mais au lieu de venir exposer ces créatures emplies de remords et de doutes au public pour les prendre à témoin et leur soutirer des larmes, Germi fait tout le contraire. Il se tait et laisse chacun sentir le poids de l’inextricabilité des relations qui se nouent, mesurer les forces de l’indicible qui, si elles lâchent, verront le monde s’écrouler autour d’elles. Des âmes mortes errant dans un ailleurs qui ne compte plus, le cœur vide, rempli de mousse… ou de paille.
Eh bien, tu vois que tu as compris le rapport avec T.S Eliot…
Il peut être question de l’histoire la plus ordinaire du monde, Germi et ses acolytes y mêlent quelques éléments singuliers au milieu d’épouvantables banalités (peut-être intentionnelles, d’ailleurs). Les mélos touchent plus volontiers les classes supérieures. Les auteurs parlent de ce qu’ils connaissent. Comme souvent, Germi choisit un milieu ouvrier. Andrea n’est toutefois pas un petit ouvrier, on dirait aujourd’hui un « ouvrier qualifié ». Une situation qui lui permet d’avoir un bel appartement dans la capitale et d’aller à la chasse tous les dimanches. Un ouvrier de première classe (si on peut dire) aurait eu cinquante enfants et son appartement aurait été tout crasseux. Cet ouvrier-là, d’ailleurs, Germi et ses scénaristes le caricaturent peut-être sous les traits du père de celle qui deviendra sa maîtresse. Et il a un peu perdu la boule. Rita (son futur amour de passage donc) n’appartient pas non plus au pire de la classe ouvrière : elle est dactylo. Pas le pire des situations au milieu des années 50. Autant dire qu’il est question ici de monsieur et de madame tout le monde. Ni réels ouvriers ni bourgeois. Monsieur et madame Smith. Cette volonté d’éviter « les extrêmes » (dirait-on aujourd’hui – ou pas) se manifeste de la même manière dans le style du film : réalisme pur. Ni mélo ni néoréalisme. Ni de gauche ni de droite. On se demanderait presque si Germi ne prend pas un soin tout particulier à éviter de tomber dans un genre spécifique : la comédie y est aussi présente par touches subtiles. Ça ne ressemble tellement à rien que ça pourrait être du Flaubert. (C’est un compliment.) Ou du Hollande. (Ce n’est pas un compliment.)
En même temps.
Le pire, auquel on ne peut malheureusement échapper, il faut le trouver dans une certaine forme de male gaze. Je suis loin d’être un grand partisan de cette théorie selon laquelle les hommes cinéastes poseraient un regard typiquement masculin sur les choses (et en particulier les femmes*), mais force est de constater qu’on nous offre ici un point de vue exclusivement masculin qui, malgré toute l’humanité dont il peut par ailleurs faire preuve quand les personnages sont à l’écran, invisibilise à mon goût un peu trop la souffrance de la véritable ou principale victime de cette histoire : la jeune femme de 22 ans, trompée à sa manière par l’homme dont elle est sottement tombée amoureuse.
* Je viens d’écrire que les femmes sont des choses. Ne prêtez pas trop attention à mes maladresses. Je pleure les jours de mes anniversaires et je parle fort aux enterrements. Maintenant que l’on sait (vous et moi) que je suis loin d’être fréquentable, merci de finir le paragraphe.
Je peux même déflorer la fin parce qu’elle révèle beaucoup de cette violence implicite, peut-être évidente à notre époque, moins pour des auteurs et un public, tous italiens, du milieu du siècle précédent dans un pays fortement catholique. On peut être socialiste, humaniste et par ailleurs manifester des réflexes petits-bourgeois… On dirait aujourd’hui que Germi est d’extrême centre sans doute. Autant allié de la gauche (dont Germi semble se revendiquer) que de la droite. Ensemble. Un bourgeois en devenir peut-être. Et pourquoi pas après tout. La prospérité devrait être pour tout le monde. Si l’on parle de progrès, toutefois, parce que pour ce qui est des valeurs, c’est peut-être bien là où ça coince.


Dans un film japonais, on aime bien que les choses reviennent en ordre à la fin des petites tragédies. Tout ça pour ça. Le Repas illustre parfaitement cette tendance. Et de la même manière, dans L’Homme de paille, on trompe, on ne se dispute pas ; mais on se quitte, on se fout en l’air sans « hystérie » (sans échapper toutefois à la qualification pour expliquer un geste d’humeur) ; et à la fin, tout revient en ordre. En ordre… pour la petite famille bourgeoise en devenir. La dactylo passera, elle, par pertes et profits (sans « pertes et fracas »).
Le film use habilement de la voix off, comme pour introduire le récit d’un drame dont Andrea est à la fois le héros malheureux et le principal témoin (et la cause) d’un plus grand drame encore. Mais celle à qui cette voix fait référence passe un peu facilement à la trappe. Plus troublant : à la fin, pour la première fois, me semble-t-il, c’est la femme d’Andrea qui se joint dans sa voix off pour conclure ce récit. Étrange manière d’évoquer une disparue. On vous invite à un enterrement, et vous en profitez pour vous raccommoder avec votre ex-femme (peut-être en parlant un peu trop fort.) Pour le dire autrement : le film commence par le récit d’une idylle qui n’aurait jamais dû se faire, une relation dont le ton de la voix off dévoilait déjà tout de sa tragique issue, et pour achever votre histoire, vous honorez l’amour indéfectible d’un couple de mariés plutôt que d’avoir une pensée pour la victime. C’est moi et je retourne pleurer pour mon anniversaire ou l’on frôle le faux pas petit-bourgeois ?
Bref. Toutes les femmes que j’ai aimées, je leur ai écrit de longs commentaires… sur ce qu’il ne me plaisait pas en elles. Je fais la même chose avec les films.
Quatre paragraphes pleins pour critiquer Germi et sa bande, alors que j’étais parti pour louer leur bébé.
Je sèche mes larmes, rafistole ma chemise pour cacher la paille qui commençait à poindre, et je repars.
Peu avant que Rita sente qu’Andrea commence à lui échapper, elle lui dit qu’elle l’aime. Elle n’attend aucune réponse de son amoureux parce qu’elle baigne dans le bonheur. Amour avoué est à moitié pardonné. À 22 ans, on a la culture de l’instant. Tout peut prendre des proportions dramatiques. Quand, dans une scène suivante, elle espère une réponse, il est déjà trop tard. Vous pouvez tromper votre femme tout le temps ; vous pouvez tromper tout le monde un certain temps ; mais vous ne pouvez tromper votre maîtresse bien longtemps.
Pas convaincu ? Alors, je m’empresse de dire en termes simples en quoi Germi est au-dessus de la banalité de l’histoire qu’il raconte : la délicatesse.


Flaubert aurait fait un roman de cette histoire, aucun lecteur n’aurait seulement songé à défendre Andrea. Dans ses actions, c’est un goujat. Un homme d’âge mûr, beau, avec une bonne situation, et qui sait sans aucun doute le pouvoir d’attraction qu’il produit sur les jeunes femmes jouit d’un certain capital sur le marché des sentiments. Certes, Rita devait être déjà un peu toquée : elle ne se laisse pas séduire par hasard, car elle dira à Andrea qu’il l’avait vu s’installer avec sa femme. Quand elle le croise d’abord sur la plage, elle sait donc qui il est. Il est là le male gaze. Même avec ce type de personnages masculins, quelle jeune femme lui donnerait tous les signes d’ouverture possible ? Quelle femme avoue à son amant l’avoir repéré du coin de l’œil et ne pas être restée insensible à son charme ? Je veux dire… j’ai l’âge pour le rôle, ne suis ni qualifié ni beau et n’ai aucune idée à quoi peuvent ressembler des signes d’ouverture sinon quand on les voit au cinéma, mais là, difficile de ne pas concevoir cette situation autrement que comme un fantasme de cinéaste, de scénaristes, même (tous mâles). Aucune femme au monde ne donnerait à un homme, même s’il lui plaît, tous les signes possibles afin qu’il profite d’elle. Regarder du coin de l’œil, se laisser séduire de loin par la présence de l’autre, voilà un comportement typiquement masculin, non ?
Bref, je continue à massacrer le film, c’est dire si je l’aime.
Admettons que cette incohérence soit possible, qu’est-ce que fait Germi de ce goujat ? Un homme délicat, pris au piège, victime, incapable de résister à une force qui le dépasse : l’amour (on devient très sentimental tout à coup quand on a envie de tirer son coup). Il y a la délicatesse, mais il y a aussi l’exploit de parvenir à illustrer les premiers instants de l’amour naissant (Stendhal parlerait de cristallisation). Comme chez Zurlini : des regards qui se croisent et qui ne peuvent plus se quitter. Et des sourires aussi.
Les choses sont parfois étranges. Il y a le male gaze appliqué aux cinéastes, mais y a-t-il un male gaze du spectateur ? Certains cinéastes prétendent devoir tomber amoureux de leur actrice pour produire de bons films (comme c’est pratique), mais les spectateurs masculins tombent-ils un peu amoureux du charme des personnages féminins ? (Et vice versa concernant le héros masculin d’un film comme celui-ci. Mais si, même moi, avec des aptitudes en perspicacité limitées, y trouve une forme de male gaze, ce serait étonnant qu’une femme, habituée à tenir à distance les hommes, se laisse attendrir par le personnage joué par Germi. Quel que soit le charme par ailleurs du bonhomme.)
Ma première réaction devant l’actrice qui incarne Rita dans cette première séquence à la plage a été : « Tiens, elle a un côté Emmanuel Béart. Un air un peu sordide. Pas un grand charme. On ne la reverra probablement plus. »
Et soudain, lors de la scène suivante, on la voit sourire. « On ne va plus la quitter. »
Je parlais de la délicatesse dans l’approche de Germi. Même dans un simple sourire, il y a une manière de diriger ses acteurs dans un sens qui les rend humains, simples, charmants. Germi, l’acteur, à ce moment, répond par un sourire. Lui aussi est dans la délicatesse. Rien de graveleux, rien de prémédité ou de mécanique. On sait que ce sont des acteurs, mais leur simplicité, leur délicatesse nous laissent croire le contraire. Et alors, temps qu’elle sourit, on aime Rita avec Andrea. On « cristallise » avec lui. Et Rita sourit beaucoup.


Mais Rita sourit de plus en plus tristement…
L’astuce (peut-être bourgeoise) du film, c’est que la femme d’Andrea, Luisa, lance exactement les mêmes regards et sourires à son homme après des années de vie commune. Le message pourrait être subliminal et conservateur : les couples mariés s’aiment toute leur vie parce que Dieu a béni leur amour. Je préfère penser que tous les personnages de Germi sont touchés par la grâce. Parce que Germi est un humaniste, un homme délicat, et qu’il aime montrer les gens sous leur meilleur jour. Dieu n’est pas dans le ciel, il est, caché derrière un peu de paille, dans nos cœurs… Luisa aurait pu être une femme impossible, vieillie, et le spectateur aurait trouvé une raison facile à cet amour interdit. Non, Luisa est une femme formidable, encore belle, et tous les deux se regardent et s’aiment comme au premier jour. Alors, quoi ? Pourquoi ? Pourquoi céder à l’amour facile et passager ?
Parce que la vie est cruelle. Si Germi est délicat avec tous ses personnages, si vous ne trouvez aucun être réellement antipathique chez Germi, c’est peut-être parce qu’il sait que la vie est cruelle.
Et que les hommes sont… des hommes.
Quand Luisa se suicide, les hommes qui ont écrit cette histoire n’en ont que pour la peine et le désarroi d’Andrea. Germi s’attarde sur son ouvrier qualifié qui doit désormais porter le deuil d’un secret. Si vous ne savez pas pourquoi certains pleurent à leur anniversaire, songez qu’il y a des hommes qui pleurent leurs liaisons restées dans l’ombre. Personne ne connaît les raisons du suicide d’une femme de 22 ans. Vous, l’amant, vous savez.
Et puis Andrea, rongé par le remords ou la solitude d’un secret trop lourd pour lui, décide de révéler toute l’histoire à sa femme. Luisa arrête de sourire. Dix ans de vie commune, et jamais le soupçon d’une liaison, jamais la moindre jalousie. Un bonheur de dix ans. Une cristallisation impossible. Il y avait bien eu ce parfum sur le pull de son mari, et cela avait été l’occasion pour Germi de jouer magnifiquement (peut-être trop) sur la rupture et le non-dit. Sinon, rien. Alors quand Andrea soulage sa conscience pour en faire porter le fardeau sur elle, Luisa fait ce que toutes les femmes qui peuvent se le permettre font : partir. Comme dans les mélodrames bourgeois, Luisa jouit d’un privilège rare : ne manquer de rien et, par conséquent, si la nécessité s’en faisait ressentir, être en mesure de quitter le foyer conjugal. Si les quatre hommes qui ont écrit cette histoire savent se mettre à la place d’une femme dans ces conditions comme leur personnage masculin gère la maison en l’absence quelques semaines de sa femme, le manque de cohérence sociale à cet instant peut se comprendre. Maladresse et délicatesse peuvent faire bon ménage, que voulez-vous. Les auteurs gauches… pas assez à gauche ont leur petit charme.
Alors, si « toutes les histoires d’amour finissent mal en général », les histoires de drame de remariage ne devraient pas être des histoires d’amour : parce que les femmes finissent toujours par revenir à la maison. Happy End. Tout en délicatesse, mais happy end tout de même.
Et pas pour tout le monde.
Franca Bettoia, qui joue ici cette jeune dactylo, est décédée il y a peine un mois à Rome.