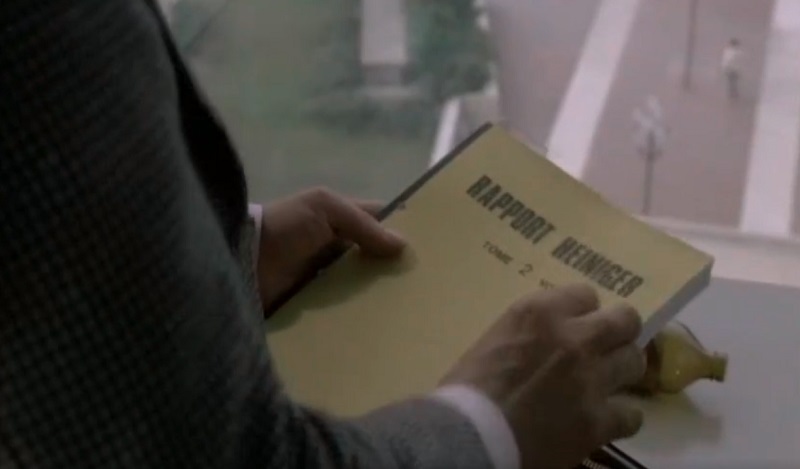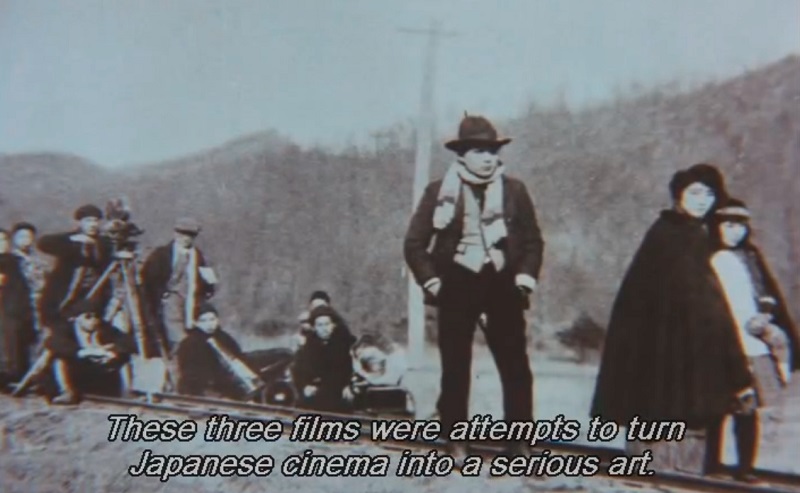Transcription de réponses faites essentiellement sur Twitter.

The Matrix Resurrections, Lana Wachowski 2021 | Warner Bros., Village, Roadshow Pictures, Venus Castina Productions
Réponse au podcast C’est plus que de la SF épisode Matrix Resurrections :
https://t.co/eQZhtMk3Tr
« L’époque n’est peut-être plus aux blockbusters mais aux séries. »
Les films cités, blockbusters contemporains sont presque tous des séries. James Bond, Spider-Man et tous les films Marvel/DC, Matrix… On est en plein dans ce qu’on appelait, il y a un siècle, et qui faisait déjà le succès de ces studios à l’époque du muet, le serial. Avec souvent ses recettes connues : l’aventure, le crime, le sentimentalisme, le complot, l’exotisme (la SF high-tech, voire le cyberpunk, c’est une forme d’exotisme). Même Dune à sa manière revisite le serial. Adapter une seconde fois (et pardon, toujours avec si peu de talent) un feuilleton littéraire SF, ça relève aussi de la logique du serial. Elle pourrait se résumer ainsi : un maximum de risques pris par les héros ; un minimum pris par les créateurs (voire le public pour qui les « révisions » de ses doudous passés, s’ils ne sont pas à la hauteur, sauront toujours au moins lui rappeler l’ivresse des hauteurs passées…). Sur les quatre intervenants, vous êtes trois à souscrire totalement à cette révision (ou reboute). Quand on aime sans doute, on ne compte pas… les suites.
Seulement, il y a quelque chose qui m’interpelle dans vos commentaires et vos analyses. C’est que vous ne voyez un film qu’à travers le prisme des intentions supposées d’un auteur, jamais de l’exécution.
C’est une constante chez les critiques, on le sait. On juge et défend des films, des cinéastes, en fonction de ce qu’on croit, ou sait, de ce qu’ils ont voulu dire. Avec cette approche (quoi, dialectique ?) on en vient toujours à trouver des justifications à des ratages. Quand le public n’est pas allé voir un film ou ne l’a pas apprécié, c’est qu’il ne l’a pas compris ; si le public court en voir un autre, il ne l’apprécie pas pour les bonnes raisons parce qu’il n’en a pas compris le sens (forcément).
D’abord, ça supposerait que les intentions d’un auteur (si tant est qu’il en existe un – on connaît la propension de certains critiques à faire de simples exécutants de studio des auteurs) nous soient accessibles. Il n’est pas rare de voir des cinéastes s’amuser des interprétations faites par certains professionnels, à quoi ces critiques ont vite fait de laisser entendre que des cinéastes peuvent révéler beaucoup d’eux-mêmes sans s’en rendre compte dans leurs films. Soit. Mais ce serait des interprétations d’autant plus faciles à faire qu’un « auteur » aurait réalisé plusieurs films, avec ses petites manies certes, ses petits secrets de fabrication (comme c’est amusant de remarquer que l’acteur est l’actuel mari de et l’ancienne doublure de : le sens caché des choses, toujours).
Mais ça supposerait encore qu’il y ait une réelle valeur à juger un film en fonction de ses intentions (cachées, supposées, interprétées, analysées, etc.). Pardon d’être radical : je pense que les intentions, c’est un peu comme l’imagination : tout le monde en a. Tout le monde est capable de créer un univers qui ne serait fait que « d’intentions » ou de « sens cachés révélés que par une poignée d’insiders, d’érudits ou de fans assidus ».
Les intentions, les bonnes comme les mauvaises, comme les idées, c’est gratuit. Au cinéma (comme en littérature), qu’est-ce qui fait la réussite d’une idée ? Quand elle est articulée avec d’autres, pas forcément bien originales d’ailleurs, et que tout un savoir-faire, une technique, se met à son service pour laisser supposer qu’il n’y en a pas de meilleure.

Rare photo de Lana Wachowski tentant de rejoindre les deux bouts : The Matrix, The Wachowski (1999) | Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Groucho Film Partnership
Et là, c’est cruel pour les commentateurs ou les analystes, parce que si l’on peut juger d’une intention ou d’une idée rien qu’en l’évoquant, c’est beaucoup plus difficile, et toujours discutable, de juger du savoir-faire technique et narratif d’un cinéaste. (C’est bien pourquoi rares sont ceux qui s’y aventurent. Les critiques proposent ainsi soit des commentaires descriptifs qui paraphrasent à leur manière ce qu’ils ont vu, ce qu’ils interprètent ou ce qu’ils jugent être de valeur dans un film, soit des analyses personnelles quasiment jamais techniques.)
Tout ça pour dire que s’agissant d’un blockbuster, le public se trompe rarement. Sauf, évidemment s’il se rue sur un film, faute de mieux (Spider-Man, en cette fin d’année). Pour des films plus confidentiels, j’aurais tendance à penser aussi qu’ils finissent toujours par trouver leur public et par être loués par les critiques…
Ainsi, je doute que des critiques ayant déjà souscrit à de précédentes resucées, à mon sens, ratées (je ne parle pas des intentions, mais de savoir-faire, ce qui est une manière assumée d’accepter l’immense part de subjectivité de nos jugements ; alors qu’une interprétation : Freud parle, il n’y a plus rien à dire^^), puissent juger un film, appartenant à une série précédente, différemment des autres. Au contraire, un nouveau film ira toujours nourrir un peu plus leur narratif (quoi, dialectique, j’ai dit ?). Qu’importe qu’un film soit bon ou non (avec ce que ça implique de subjectivité assumée encore une fois), qu’on l’aime ou non (pourquoi ne pourrait-on pas défendre des films, les aimer, tout en reconnaissant qu’ils sont mauvais ?) : un nouveau Nick Carter, un nouveau Fantomas, un nouveau Flash Gordon, un nouveau Indiana Jones, ça ne fait jamais que nourrir le mythe. Et quand un de ces « épisodes » est raté, cela n’est jamais alors parce que le film serait, intrinsèquement, jugé comme mauvais, mais parce que son « auteur » aurait présenté des « intentions » qu’eux seraient capables de juger non conformes au mythe (à la franchise) initial ou, au contraire, n’auraient su correctement le rebouter.

Qui se cache derrière Matrix, qui en est l’auteur ?…
Le gros du public (dont je suis) n’a pas apprécié le 2 et le 3, au risque déjà d’altérer le souvenir, et la vision, qu’il se faisait du premier.
Pourquoi, pour le gros du public, le premier avait-il été une claque et la suite d’épouvantables supplices ? Eh bien, j’ose le croire, parce que le premier relève du chef-d’œuvre technique, narratif. Il compte parmi ces films rares où tout semble s’aligner avec les bonnes personnes et avec les techniques arrivant à leur maturité au bon moment.
Les intentions des frangines ? Je m’en moque. Ce qui m’importe en tant que spectateur à ce moment, ce sont les intentions hautement spéculatives, et très largement influencées par la sidération que me procure le film au moment où je le vois. Quand on prend une telle claque en tant que cinéphile, les interprétations fusent, c’est même souvent à ça qu’on reconnaît un grand film. Personne ne voit le même film, et c’est peut-être ça, déjà, son premier niveau de lecture « meta ».
Pour le reste, l’essentiel, la réussite du premier film tient dans l’évidence encore compréhensible de son récit, dans la folle ingéniosité de ses trouvailles techniques, dans son design fou, dans le fait que pour la première fois enfin un film de SF arrivait à convaincre avec le cyberespace (Ghost in the Shell venait de montrer la voie). Dans les précédents ratés hollywoodiens, ce n’était pas les bonnes intentions qui manquaient… mais la bonne histoire, la bonne exécution. Le bon moment.
En matière de films SF, je ne crois qu’aux miracles. Je ne crois ni aux auteurs de SF, ni aux intentions, ni au savoir-faire (cf. Ridley Scott est-il un auteur ?). Tous les grands films de SF apparaissent comme des générations spontanées. Ils se perdent dans le temps comme les larmes dans la pluie… Ils sont rares. Et leurs suites, toujours, exploitent une œuvre initiale jamais égalée. Comme dans tout serial, on joue sur la répétition, sur les digressions vers des personnages déjà connus, sur ce qui se joue avant, après, au-dessus, au-dessous, etc., et sur la nostalgie aussi beaucoup. Que s’est-il passé avec ces vieux serials ? Certaines resucées médiocres, voire sans doute peut-être déjà des sabotages assumés, peuvent radicalement changer la perception qu’a un public pour une œuvre initiale. Jusqu’à l’oubli pur et simple. (Nick Carter ? Die Spinnen ? Les Exploits d’Elaine ?) Peut-être que le public d’aujourd’hui a plus de facilités que celui d’hier à avoir accès aux œuvres initiales, mais on peut aussi supposer que le public reste toujours plus enclin à s’intéresser à des films récents. Et pour ce public, viendra un moment où avoir plus facilement accès à Matrix 4 achèvera la possibilité pour eux de voir Matrix 1. Eux n’ont aucune nostalgie. Avec d’autres blockbusters sur les rangs en décembre, le film aurait encore plus été assuré de faire un four.
À voir si, à force de vouloir saboter le film (intention supposée), Lana ne prendrait pas le risque d’enterrer un mythe. Elle joue avec le feu, si pour moi, ni elle ni sa sœur ne sont véritablement « auteurs » du film (puisque je le range dans les « petits miracles spontanés du cinéma SF »), elle peut encore en être la fossoyeuse.

Y a-t-il quelqu’un au bout du film ?
Échanges avec trineor :
« Personnellement j’ai immensément aimé Reloaded à l’époque, beaucoup aimé Resurrections il y a une semaine, et toujours été assez convaincu que ceux qui avaient adoré le premier mais trouvaient que les suites racontaient n’importe quoi aimaient le premier sur un malentendu. »
> Et peut-être que si tu étais honnête avec toi-même, tu émettrais également cette hypothèse que ce malentendu peut aussi venir de toi. :)
Tout est toujours affaire de malentendus. On pourrait faire un sondage auprès des auteurs, leur demander s’ils pensent que leur œuvre a été comprise, et je serais prêt à parier qu’une grande majorité répondrait non.
En revanche, le spectateur a toujours raison. Il n’a jamais tort d’avoir compris ce qu’il a compris d’une œuvre. Ce qu’il a compris lui appartient. Ce que tu as compris t’appartient. Et je suis loin de penser que ce que les frangines ont compris elles-mêmes de leur œuvre ait un sens. Une cohérence.
On est peut-être nombreux à ne rien avoir compris du film initial qu’on adore, en revanche, sans notre naïveté, aucune de ces suites n’aurait été possible.
« D’où : 1. On ne peut prétexter du malentendu toujours, partout, pour tout dire d’une œuvre ; parfois il y a dans l’œuvre quelque chose qui dit explicitement non et résiste à ce qu’on en dit.
2. La fréquentation régulière d’une œuvre augmente la connaissance que nous en avons. »
>
Je suis d’accord. Mais je vais utiliser une allégorie(ou une comparaison, je ne sais trop) pour essayer de te faire comprendre pourquoi je n’adhère pas aux films qui jouent trop sur ces malentendus (et sans interdire à qui que ce soit de le faire). Pour moi, un bon récit, c’est comme une histoire drôle. Le ton, l’attaque, la lancée, l’ambiance, l’astuce qui la compose, sa durée et surtout sa chute, tout ça est important. Mais si au moment de la chute, on ne comprend pas. Tu peux toujours ramer, expliquer, la blague a raté.
Je suis désolé, je vois une parfaite cohérence dans le premier film. Un film qui n’a aucunement besoin des surenchères proposées dans les suivants.
Toi, tu aimes les films qui te disent quelque chose, quitte à y passer cinq ou six films, quitte à contredire ce que tu disais dans le précédent tout en arrivant après un bullet time théorique à retomber sur tes pieds, mais qui revient en fait à dire « vous pensiez avoir compris, je vais vous expliquer que vous n’y avez rien compris ». Bref, décrit ça comme tu veux, vois-y une cohérence d’ensemble inaccessible pour les intransigeants de mon genre, moi, je reste ferme sur mes principes : la cohérence, c’est le spectateur qui la crée.
En tant que spectateur, c’est mon droit de refuser qu’après avoir adhéré à une proposition narrative et esthétique qui tenait la route dans un premier film, on cherche à déflorer cette cohérence en imposant une surenchère ou une complexité inutile exploitée dans des suites.
Le nouveau siècle a été déterminant dans ce domaine, car les sœurs n’ont pas été les seules à se vautrer dans cette surenchère. J’ai adoré Nolan quand il proposait Memento, parce qu’il te retourne le cerveau, et parce qu’à la fin comme dans tout bon récit qui se respecte tout redevient cohérent et lisible pour tous. Pas de twist pour t’expliquer que ce que tu viens de voir dans un film qui tient la route, que ce que tu croyais être n’était pas tout à fait, et de devoir passer encore d’autres films pour trouver une nouvelle cohérence. Puis Inception est arrivé, et Nolan a commencé à vouloir ajouter une couche de complexité. Le twist est recherché en permanence, la volonté de perdre le spectateur aussi. C’est là que moi je dis, non, stop. Il ne faut pas confondre complexité et cohérence. Gigi Abrams fait pareil.
Dans un récit, une cohérence doit faire l’effet d’une évidence. Un dénouement, une résolution, doit rendre simple et claire ce qui ne l’était pas jusque-là. C’est mon droit de spectateur d’exiger cela des films que je regarde. Ce n’est pas un malentendu, c’est une exigence. Une exigence morale de spectateur. Si suite il y a, elle doit renouveler le plaisir du film initial sans renier les propositions narratives et esthétiques qui ont fait son succès. Si les suites servent à me dire que j’ai mal compris ou mal apprécié ce que j’ai vu : poubelle. Autrement dit, une franchise doit étendre son univers, pas le restreindre en remaniant (ou déconstruire) les éléments du premier pour les tordre vers une cohérence nouvelle. Étendre un univers, c’est ajouté des personnages, des histoires, respecter la proposition de départ.
Comme tout auteur, les sœurs ont tous les droits, mais c’est mon droit de spectateur de refuser d’adhérer à une proposition basée sur une surenchère des effets, sur une complexité réclamant une attention renforcée, et sur un reniement des qualités premières d’un film initial. Je peux prendre un exemple de surenchère : quand Néo se bat dans le premier, il est en apprentissage, il se bat d’abord contre lui-même, puis contre ses alliés, et enfin contre une poignée d’opposants parfaitement désignés. C’est clair, on ne fait pas plus classique comme récit. Arrive la suite, et l’on y voit un personnage principal avec des pouvoirs démultipliés, des alliés acquis à sa cause, une quête devenue tellement incompréhensible qu’elle en devient abyssale, et des opposants qui se comptent par milliers. Ce n’est pas un récit, c’est de la bouillie.
The Endrix Activation