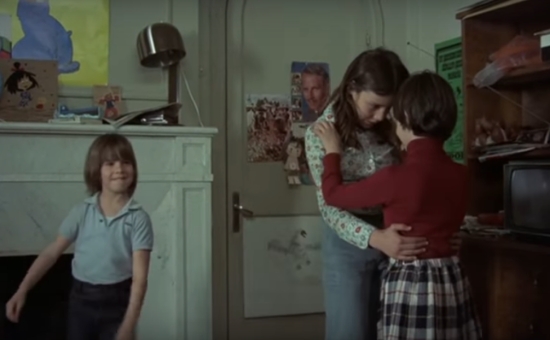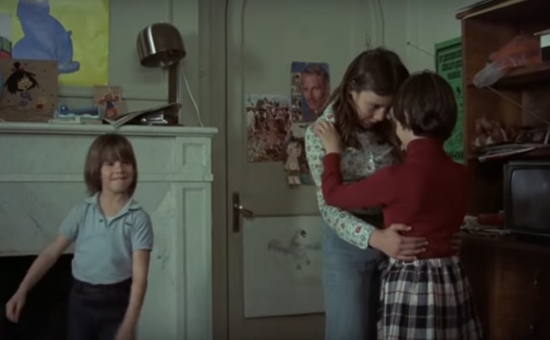Juin 2008
J’avais vu et apprécié sans plus Les Branches de l’arbre et Agantuk de ce même Satyajit Ray, il y a plus de dix ans. C’est dommage d’y avoir mis autant de temps pour y revenir parce que là, en voyant La Complainte du sentier, j’étais tout bonheur*. Finalement, on revient à ce qu’on a aimé quand on était enfant. Mes héros, c’était Luke Skywalker, Moïse et Bruce Lee… Trois personnages déracinés. Alors voilà, ça se traduit aujourd’hui pour un goût pour les films exotiques. Voir ces merveilles de films tournées au Japon (je ne parle pas de Kurosawa dont les films sont très occidentaux) ou en Inde, se coller à la tradition littéraire de ces pays (souvent ce sont des adaptations), se fondre dans ces cultures étranges, non seulement d’un autre lieu, mais également d’une autre époque, c’était une évolution de mes goûts toute naturelle.
*Comme Jean-Claude Van Damme, après deux heures passées loin de chez moi, j’invente des expressions.
Bref, qu’y a-t-il de si intéressant dans La Complainte du sentier ? Eh bien, par exemple, ce qu’on peut apprécier chez De Sica. S’il y a deux films auxquels celui-ci m’a fait penser, c’est le Tombeau des lucioles (oui, rien à voir avec De Sica), mais donc aussi le Voleur de bicyclette. Ray a une approche tout aussi réaliste, pour ne pas dire naturaliste du cinéma, mais ses sujets sont sensibles, voire mélodramatiques. L’histoire décrite est simple, presque descriptive, et s’attache à montrer les petites gens, les enfants en particulier, à travers des expériences qui peuvent d’abord paraître anodines, mais qui ont presque toujours un sens initiatique pour l’enfant et pour le spectateur. L’émotion est au centre de tout. La distance de la mise en scène, sa discrétion, permet de ne pas forcer sur la corde sensible. Un cinéma humaniste, sur la condition humaine, un spectacle de ce que nous sommes : des êtres humains. D’ailleurs, Ray aurait été influencé par Renoir et De Sica. Et ça se ressent. Renoir pour la mise en scène, le choix des focales ; et de Sica pour l’émotion, le réalisme et la distanciation. (C’est d’autant plus étrange que ces trois-là se soient intéressés aux gens du peuple parce qu’ils n’ont pas franchement souffert d’une enfance misérable.)

La Complainte du sentier, Satyajit Ray 1955 | Government of West Bengal
Une famille est installée dans un coin perdu, rural, du Bengale. Pas de grande ville, mais la campagne dense, peuplée, et la jungle pour se perdre et faire le lien avec le passé. Tous deux (jungle et passé) à la fois envahissants, impénétrables, mais dont on imagine la fragilité face aux menaces du monde moderne. Kipling n’est pas loin… La famille est installée dans une vieille maison qui tombe en ruine et dont on devine la richesse d’antan. Encore le symbole de cette mémoire menacée à laquelle cette famille semble se cramponner parce que c’est la seule chose qui lui reste. Le père est le fils d’une famille ancienne du village ; ses ancêtres sont des écrivains, et on le respecte encore comme on respecte chacun en fonction de sa caste. Mais lettré ou pas, c’est plutôt un bon à rien, et il a déjà dû céder aux voisins une partie des terres de la famille, en particulier le verger (symbole de prospérité et de connaissance). La famille est composée de cinq éléments : le mari, la mère, la vieille tante, la fille et le petit dernier, Apu, qui vient de naître et qui est au centre de cette trilogie (dite d’Apu).
On dit en Europe, « qui vole un œuf, vole un bœuf ». Malgré le caractère sacré des vaches en Inde, je doute que cette expression vienne de là-bas… Là, ce n’est pas du tout le sens de la fable. La morale de cette histoire va à contre-courant des croyances (ou du moins de l’idée de ce qu’on se fait de celles-ci). Ici, ce serait plutôt : « qui vole un œuf, sera puni sans attendre par les dieux, à tel point que son bœuf crèvera la dalle, et lui aussi ». Ça le fait moins en maxime, c’est sans doute pour ça qu’il faut un film pour l’illustrer.

Tout commence quand la fille, Durga, vole des fruits dans le verger d’en face pour les donner à sa vieille tante… Identification automatique : péché véniel de l’enfant, et désir de l’offrir à sa vieille tante. Tout est déjà là dans cette première scène (on comprendra par la suite qu’il devait y avoir également un peu d’orgueil parce que ce verger appartenait donc autrefois à la famille) : les termes de l’intrigue, l’enjeu, le drame qu’il contient. Le père n’a pas de travail (il est impensable pour un lettré de pratiquer des travaux manuels, et encore moins de se soucier de futiles considérations matérielles), et quand il en trouve, il n’est pas payé. Il est donc difficile de nourrir toute sa petite famille. Et on doute, comme sa femme, qu’il ait conscience des tracas que son inconsistance peut leur causer. Durga et Apu grandissent. Durga continue de voler (et plus elle vole, plus on l’aime, parce que tout comme sa mère, elle semble être la seule qui se bat pour se raccrocher à quelque chose qui ne leur appartient déjà plus), Apu va à l’école… On les suit dans leur quotidien : les femmes s’enduisent les cheveux d’huile pour les coiffer et les faire briller (oui, les Indiennes ont les cheveux gras et c’est magnifique) ; les familles mangent à même le sol (comme au Japon, comme en Afrique ; il n’y a guère que les Européens pour manger à table parce que ce sont des porcs qui ont honte de ce dans quoi ils ont marché) ; on mange avec les doigts et la main droite ; on se rince avec un gobelet métallique toujours à portée ; faire manger son gamin, couper les légumes et les fruits, cacher sa monnaie dans un nœud qu’on fait avec son sari, se laver les dents avec des cendres…
Arrive le jour où on accuse Durga d’avoir volé les perles de la petite voisine. Durga affirme que ce n’est pas elle. Elle ment bien sûr. On le sait, et on comprend que c’est là que commence pour la famille, et pas que pour elle, une descente aux enfers.

Le père espère gagner de l’argent en rejoignant la ville, mais il ne donne aucune nouvelle et la famille n’a rien à manger. Il faut attendre que Durga attrape la mort sous la pluie pour que les voisins leur viennent en aide. En Inde, le système de castes est strict, et on ne change pas de caste en cours de route (l’ascenseur social existe encore pour ceux qui se rendent à l’étage “misère”). Aussi, quand on est un lettré, on doit gagner sa vie en restant un lettré ; et, quand on est mendiant, on gagne sa croûte en faisant le tour des maisons des castes supérieures ; si l’un d’entre eux vient à vous et vous demande du riz ou autre chose, on ne peut pas lui refuser, même si on n’en a pas assez pour soi-même. Un comble, quand on meurt de faim.
La maison tombe un peu plus en ruine avec l’arrivée de la mousson. Et quand revient cet incapable de mari, tout guilleret, sa fille est morte (tout comme sa vieille tante, bien avant, mais elle était déjà toute en ruine elle aussi, et tellement chiante). Voilà qui décide la famille à quitter enfin la maison familiale.
La suite, dans le second épisode.

Le film est surtout centré sur le personnage de Durga, la grande sœur d’Apu qui la regarde comme une reine (et c’en est une). Entendre ce prénom plusieurs fois dans le film par la mère, pour la rappeler à l’ordre, savoir où elle se cache, c’est un bonheur*… C’est aussi dissonant, aussi grinçant, aussi singulier, et pourtant si beau, que le cri d’un manchot sur la banquise en quête de son petit.
*Si on s’inquiétait pour moi, il semblerait que j’aie retrouvé mon françois.
À signaler la superbe musique de Ravi Shankar (papa Norah Jones) et notamment ce passage où son sitar pleure au moment où le père rentrant depuis plusieurs mois d’absence, offre à sa femme, un sari à donner à sa fille. La mère de Durga, qui ne lui avait rien dit jusque-là, ne peut s’empêcher de « crier »… et c’est le sitar qui pleure. Pas très réaliste mais magnifique. Quand le récit a été bien sage en restant distant et naturaliste, on peut se permettre d’aller jouer dehors et de faire péter la corde sensible. Émœuvant (comme dirait Johnny Sitar) au point de ne plus dire « lyrique » mais « sitarique ». Dissonant, grinçant, et pourtant sitarique. Shankar est ravi.

C’est toujours mignon de voir des gosses au cinéma, il y a toujours une sympathie facile à gagner. Mais là en plus, c’est une beauté à laquelle on n’est pas habitués. Le sourire édenté de la vieille tante, le regard plaintif et résigné de la mère ; mais surtout, ces deux gosses, un frère et une sœur, qui sont les meilleurs amis du monde (si ça, ce n’est pas de la fiction). La beauté de leur peau noire et rayonnante (contrairement à la peau mate des Africains), leur nez long et percé, ces yeux ronds dont le blanc explose à la lumière… Et cette langue… aux sonorités parfois inattendues, gutturales, mais aussi souvent familière. Des rythmes communs, et des intonations identiques. La voix de la mère appelant ses petits.
« DURGA ! DURGA ?!… DURGAHAAAAAAARRRRRRRR !!! »
Révision 2016 :
Le travail du son dans de nombreuses séquences est tout bonnement prodigieux. On attendrait de tels effets dans un film noir, pourtant Ray les adapte dans un film dramatique, usant du suspense et des éléments extérieurs (vent, pluie, poteaux électriques, ou locomotives en approche) comme un écho envahissant s’imposant comme un trouble induit dans l’intériorité des personnages. La musique va également dans ce sens, pas une simple musique d’accompagnement, mais une vibration répondant ou provoquant les tourments, ou le destin en train de se faire, des personnages.

Autre remarque, l’usage à la fois des ellipses pour raconter une histoire en procédant par petites touches, un peu comme dans une chronique, mais où on y sent au contraire une continuité bien plus ténue et évidente. Ainsi, d’une séquence à une autre, le début ne répond pas à la fin de la précédente, mais au contraire, on raconte une nouvelle situation, et c’est seulement pendant qu’on comprend un lien ou que les mêmes thèmes finissent par réapparaître (les vols, la faim, la tante ou le mari, l’envie d’aller voir la voie ferrée). On retrouve la même idée de concentration des sujets au sein même d’une séquence, permettant de proposer un montage alterné autour d’une même unité temporelle mais avec des personnages souvent éloignés de quelques mètres ; ce ne sont alors pas de simples plans de réactions, ou de coupe, mais l’alternance de descriptions de petites actions menées par chacun des personnages (chacun vaquant à leurs occupations, même si dirigées vers l’autre, cet autre qui a lui-même ses propres occupations — ce n’est pas un cinéma de dialogues mais de situations). Un montage alterné qui finit comme toujours par ne plus proposer qu’une seule trame, la plus dramatique, la plus en rapport avec les thèmes globaux de notre histoire. Une maîtrise sans failles.






















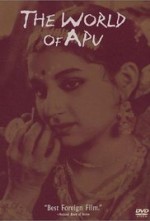

















 L’École du crime 1938, Lewis Seiler | Warner Bros
L’École du crime 1938, Lewis Seiler | Warner Bros