Broligarchie

Les Femmes de Stepford
Titre original : The Stepford Wives
Année : 1975
Réalisation : Bryan Forbes
Avec : Katharine Ross, Paula Prentiss, Peter Masterson, Nanette Newman
Prendriez-vous un peu de science-fiction militante sans le moindre artifice en dehors d’une paire de techno-boobs fugitifs et de lentilles noirâtres pour les yeux ? Pas convaincu ? Laissez-moi vous dire que notre produit repose sur une occurrence d’un de vos thèmes favoris, j’en suis sûr, à mi-chemin entre l’horreur et la SF du « grand remplacement »… Non, non, je vous vois froncer des sourcils : point ici de grand remplacement (fantasmé) impliquant des migrants, mais d’un simple groupe de personnes, souvent à l’échelle d’une ville entière, parasité par un agent étranger, extra-terrestre ou robotique.
Cela ne vous dit rien ? Mais si, voyons. Nous sommes entre Le Village des damnés, L’Invasion des profanateurs, Les Tommyknockers, Westworld, Desperate Housewifes et Alien. Sachez-le, notre produit est garanti sans extra-terrestres. No extra. Notre agent de… remplacement ? Un robot. Mais pas d’artifices, promis. Nous vous assurons du Mary sans Shelley et du Frank sans Enstein. Qui fomente cette invasion ? Un Club de masculinistes, ou de techbros, dirait-on aujourd’hui, qui complote contre les femmes un peu trop libres à leur goût et qui rêve d’un compagnon docile, si possible livré avec une paire de gros seins. Ah, des techbros, cela commence à vous parler !
— Papa, j’ai vu un homme porter une femme toute nue !
— C’est pour ça que nous quittons New York.
Premier degré. Cet échange introduit le film et annonce parfaitement la suite.
Bref, la culture populaire s’est tellement emparée du sujet qu’il relève, dans la réalité, d’un trouble psychiatrique appelé syndrome de Capgras. Dans ce délire, le patient est persuadé que ses proches ont été remplacés par des sosies. Ou autre chose. Le personnage qu’interprète Katharine Ross va justement voir une psychiatre après que son amie a fini par adopter le même comportement d’esclave domestique et sexuel qu’elles dénonçaient toutes deux. Étonnamment, la psy entre dans son jeu sans déceler le moindre problème de névrose. « Docteur, je vois mon entourage se transformer en robot. — Comment ? Filez immédiatement ! » (C’est une psychanalyse, ceci expliquant sans doute cela).
J’aime bien creuser et forcer les comparaisons (c’est pour ça que mon ex est partie). D’une certaine manière, Horatio, l’histoire des Femmes de Stepford se présente sous la forme d’un film d’éliminations déguisé. Être ou ne pas être comparé à Alien, reste la question à laquelle je finis par tendre dans chacun de mes commentaires dédiés à la science-fiction. Dans le film de Ridley Scott, les victimes servent d’hôtes, pendant ce temps, leur comportement change… avant de disparaître une fois le monstre arrivé à maturité. Un à un. Jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Une femme. Dans un film d’horreur, cette dernière victime aura tendance à survivre (c’est discutable, dans Black Christmas, sorti quelques mois plus tôt, l’usage n’est pas encore formellement établi). C’est là que Les Femmes de Stepford retrouve sa radicalité de film d’anticipation : la radicalité d’une satire tech-no-bro ou d’un prospectiviste désillusionné. Pour aller au bout de l’idée, la menace technosolutionniste doit rester implacable. Les hommes fragilisés par l’émancipation des femmes pourraient s’interroger sur les limites morales d’une société réduisant les femmes à un rang inférieur ? Surtout pas, Horatio ! Regarde ce crâne de Ripley : fait-elle désormais la maligne ? Montre-t-elle les muscles face à la fatalité de son sort ? Bien sûr que non. Elle aurait dû se ranger dès le début du côté des hommes. Si les femmes restaient dévouées et obéissantes, les techbros n’auraient pas eu à se démener pour créer des robots pour les remplacer !

En 1974, la révolution culturelle est sur la bonne voie…, mais de manière assez évidente, cette histoire met en quelque sorte en garde contre le retour de bâton qui se profile. Chaque révolution appelle sa contre-révolution et ses propres mouvements réactionnaires (voir mon commentaire sur La Fille sur la balançoire). Le mouvement d’émancipation des femmes se cantonne aux grandes villes. Se retrouvent ici clairement opposés le mode de vie libéral des centres urbains et celui des banlieues conservatrices, vanté par la publicité et les films hollywoodiens des années 50. Si j’étais taquin, je me hasarderais même à voir le film comme une forme d’allégorie de la résistance du cinéma de papa face au Nouvel Hollywood (tragiquement, ce sera le « cinéma d’adolescent » qui mettra un terme à la vague contestataire). Comme un symbole, un cinéaste britannique est aux manettes (Bryan Forbes vient de réaliser l’excellent Une lueur d’espoir dans lequel Nanette Newman, ici présente, tenait le premier rôle avec Malcom MacDowel). Et l’on se rappelle qu’une partie de la révolution à Hollywood a pu se faire grâce à une forte influence britannique : de nombreux réalisateurs américains y étaient venus tourner pour échapper au carcan des studios (Lumet avec La Colline des hommes perdus, Otto Preminger avec Bunny Lake a disparu, William Wyler avec L’Obsédé, etc.) et des réalisateurs britanniques avaient fait le chemin inverse (Peter Yates avec Bullitt, Jack Clayton, avec Gatsby le magnifique, John Schlesinger, etc.). Si le cadre n’est pas tout à fait celui de l’image d’Épinal des banlieues chics de Californie qui servira plus tard de décor à Desperate Housewifes, cette banlieue new-yorkaise n’en est pas trop éloignée. On apprend même dans le film que Stepford passait pour être assez libérale avant que pour une raison inconnue ses habitantes finissent par coller aux stéréotypes conservateurs de la femme au foyer. « La contre-contre-culture, elle ne passera pas par là : ici, c’est New York ! ». La peur d’un grand remplacement flotte déjà dans l’air, mais ironiquement, la menace est celle d’une invasion conservatrice. Cette menace se révélera réelle, car même si New York et sa région font encore figure aujourd’hui de têtes de pont de la gauche américaine, un demi-siècle plus tard, les réactionnaires ont fini par envahir toute l’Amérique. Le film sonnerait presque comme une mise en garde ou une tragique prophétie.
Le film décrit une sorte de Silicon Valley avant l’heure. Et cette prophétie sera complète une fois que toutes les entreprises californiennes de la tech achèveront leur mue réactionnaire en s’établissant au Texas… Longtemps vectrices de valeurs de la gauche, ces entreprises semblent avoir pris un tournant plus assumé vers ce que l’on devine dans le film : des machines à aliéner les consciences (et à supprimer les femmes) au profit d’un petit cercle d’hommes blancs et privilégiés. La broligarchie. Alien et Terminator avaient annoncé, en montrant une image glaciale de l’entreprise, que c’était vers quoi le monde s’enfoncerait.
Montage alterné : j’en reviens à ma comparaison précédente. Quand dans l’une des dernières séquences du film le personnage de Katharine Ross se retrouve nez à nez avec le grand chef responsable des « transformations » des femmes de Stepford, Dale « Diz » Coba, il semble déjà lui-même correspondre à une sorte d’hybride de la créature d’Alien et d’un androïde quelconque de la Weyland-Yutani Corp chargé de préserver les intérêts de l’entreprise. Walt Disney en somme. Je conclus donc à mon tour : oui, Les Femmes de Stepford ferait presque figure de précurseur à Alien.
Pour ce qui est de la forme, en dehors de quelques longueurs inexplicables dans les toutes premières séquences du film (la difficulté de matérialiser l’ennui à l’écran), Forbes assure honnêtement le travail : esthétique champêtre des blés héritée d’Elvira Madigan et quelques ambiances dans le genre thriller domestique annonçant un peu cette fois Les Dents de la mer. Interprétation assez inégale : Paula Prentiss apporte un dynamisme absolument nécessaire au film (actrice au tempérament formidable) ; l’acteur interprétant Dale Coba est lui aussi parfait (mais son rôle de méchant reste très secondaire). Le reste de la distribution baisse en qualité. C’est de la SF sobre, on grimpe d’un échelon par rapport à un Corman ou à des daubes racoleuses, aucune raison de se plaindre. Les films de genre achèveront leur mue (après 2001, Bonnie and Clyde, French connexion, L’Exorciste, Black Christmas ou Le Parrain, par exemple) en passant de séries B aux séries A avec Les Dents de la mer et Star Wars. La première vague réactionnaire apparaîtra sous Reagan, tandis que le cinéma américain confortera son renouveau : le Nouvel Hollywood avait condamné les drames à la confidentialité ou à la course aux Oscars, l’époque des sujets sérieux et politiques semble révolue, et la tendance vers des films de genre visant désormais les adolescents dans les salles se confirmera la décennie suivante. Il ne sera alors plus question de SF politique sans high-tech. Même les techno-boobs fugitifs disparaîtront de l’écran.
Les Femmes de Stepford, Bryan Forbes 1975 The Stepford Wives | Palomar Pictures
Sur La Saveur des goûts amers :
Listes sur IMDb :
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant
Ou saisissez un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel


















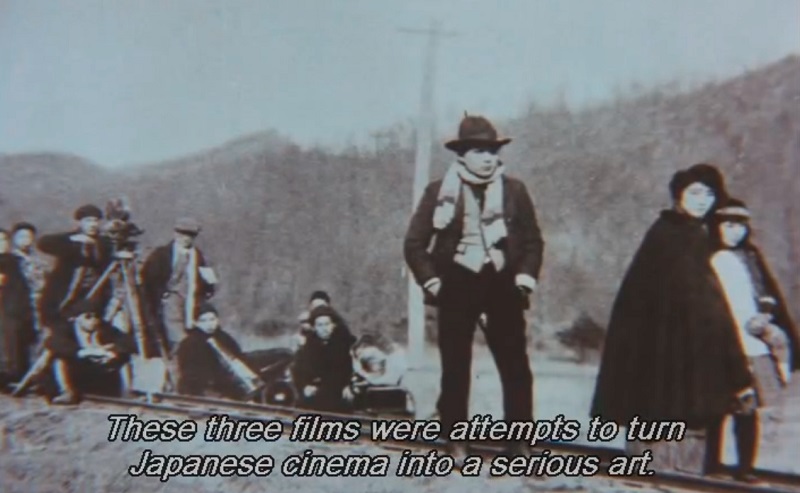




 Année : 1975
Année : 1975































