La chasse aux certitudes

La Parole
Titre original : Ordet
Année : 1955
Réalisation : Carl Theodor Dreyer
Avec : Henrik Malberg, Emil Hass Christensen, Preben Lerdorff Rye, Birgitte Federspiel
— TOP FILMS —
J’ai vu Ordet en 1997, au tout début de ma passion pour le cinéma. Et pour avoir négligé d’en écrire à ce moment quelques mots (je commentais pourtant à cette époque d’autres films…), quand je repensais depuis à ce film de Dreyer, je peinais toujours un peu à me rappeler ce qu’il m’y avait tant plu.
En fait, dans mon souvenir, le film est resté longtemps pour moi une référence en matière de rythme et de mise en scène. C’est à cette époque que je m’amusais à séparer les types de films en fonction de leur rythme. Ainsi j’y voyais grossièrement (et quand c’était réussi) trois catégories : les films rapides (les +1, allant parfois à définir certains films en +2), les films 0 (sans rythme ou presque, avec une volonté de captation, ou de retranscription, du rythme « naturel » des relations, et un montage, un enchaînement des situations, calqué sur un rythme cardiaque apaisé), et les films lents (les -1, voire les -2).
Pour le reste, lié au sujet du film, mes craintes, ou mes interrogations quant à ma fascination pour le film après tant d’années sans m’en souvenir précisément du contenu, se basaient sur la seule idée, ou préjugé, que le film ne pouvait être qu’un film mystique. Or je suis un indécrottable athée. Je ne l’étais peut-être pas autant qu’aujourd’hui, et j’avais donc un peu peur d’y avoir été fasciné par une forme de spiritualité qui serait incapable de me séduire à la revoyure. Deux préjugés ici. Celui lié à l’image qu’on se fait du film de Dreyer quand on ne le connaît pas (ou quand on ne le comprend pas tel que je l’ai « compris », c’est-à-dire traduit, en le revoyant) ; et celui lié à l’image que je pouvais porter sur le cinéphile (ou l’homme) que j’étais il y a de ça maintenant vingt ans.
À la revoyure, je suis rassuré. En plus des qualités de mise en scène du cinéaste (je ne parle pas des mouvements de caméra ; on fait un peu trop passer à mon sens de simples mouvements d’ajustement pour du génie), qui là encore n’ont pas changé ma perception après révision du film, je ne pourrais affirmer avec certitude que c’était déjà ce qui m’avait séduit alors, mais en tout cas tel que le film s’est à nouveau présenté à moi, je n’y ai vu aucune trace de mysticisme.
Non, non.
Je rappelle souvent être fasciné par la manière dont chaque spectateur peut percevoir un film, par notre capacité à ne jamais voir le même, et par cette idée fabuleuse qui, par elle seule, fait tout le charme de l’expérience, qu’elle soit cinématographique ou plus généralement artistique : que tout dans l’art, dans la perception de ses productions, n’est que malentendu. Il est difficile d’expliquer une œuvre, parce que l’art (celui de la représentation en tout cas) est très fortement lié à la notion de perception personnelle, d’expérience, de subjectivité, de goûts. Pourtant, pour exprimer notre amour d’une œuvre, on en vient un peu trop souvent à prétendre y trouver des indices indéniables, objectifs, de ses qualités ; par conséquent, ceux qui viendraient contredire cela seraient forcément de mauvaise foi, des idiots ou des insensibles. Parmi les outils cherchant à mettre en scène une forme d’objectivité hypocrite, ou malvenue, il y a l’utilisation en commentaires de film (et plus encore en « critique ») de la troisième personne du singulier. Y préférer le « je » dénoterait bien trop ostensiblement la marque, indéniable, là, d’une subjectivité, qui, parce qu’elle ne vaut, par définition, que pour celui qui l’exprime, serait moins légitime que d’autres qui s’efforceraient de passer pour autre chose. (Au troisième visionnage, il me sera impossible de comprendre cette dernière phrase…)
J’utilise parcimonieusement le « je » dans les commentaires, mais c’est sans doute plus par pudeur parce que ce n’est pas toujours chose facile d’évoquer ce qu’on aime à travers le prisme forcément intime de la première personne. Mais je ne me l’interdis pas, car j’ai l’avantage d’écrire mes commentaires d’abord pour moi, justement, beaucoup, parce que j’ai souvent laissé passer l’occasion d’exprimer (de m’exprimer à moi-même) en quoi une œuvre pouvait me toucher. La mémoire me fait souvent défaut, et il y a une forme de nostalgie mêlée de regrets à savoir qu’une œuvre nous a touchés sans nous rappeler précisément pourquoi. Je n’écris pas de critiques, j’en serais incapable, je ne sais même pas ce qu’est une « critique », mes commentaires sont des notes de visionnage. Là encore, tout n’est que malentendu ; ce serait une escroquerie de prétendre le contraire. Et il n’y a jamais eu pour moi, je l’espère, une quelconque volonté de faire passer mes notes pour autre chose.
Tout ça pour dire que ma perception du film de Dreyer est très personnelle, et qu’il serait idiot de me passer ici du « je ». J’ai conscience que mon interprétation du film est sans doute très éloignée de ce qu’en font d’autres cinéphiles, peut-être même de celle que Dreyer aurait voulu suggérer dans son film (et elle-même peut-être encore bien éloignée de la vision initiale de Kaj Munk). Mais c’est tant mieux. Parce que c’est ça le cinéma. Des malentendus, parfois forcés, qu’il faut assumer, parce qu’on ne justifie pas d’avoir trouvé dans une œuvre des éléments qui nous touchent, peut-être même, en contradiction avec la logique propre du film (que personne ne saura d’ailleurs établir).
Un film donne-t-il à voir une morale ? Une intention ? Je me répète, mais Douglas Sirk explique admirablement sa vision du cinéma : ici. On ne force pas la main du spectateur, on ne lui apprend rien. Le film (ou l’auteur à travers lui) ne peut que suggérer des idées, des conclusions, aux spectateurs, car ils ne se laisseront jamais convaincre par un film, même si les thèses qui y sont exposées sont celles qu’ils partagent. C’est une affaire de suggestion, d’humilité, de bonne distance et de confiance en la seule imagination et intelligence du spectateur.
En dramaturgie, on parle souvent de « fable » pour définir une « histoire », suggérant par là que toute histoire possède intrinsèquement une « morale ». C’est un peu vrai, il me semble, mais au contraire de la fable (dans laquelle, on pourra d’ailleurs toujours interpréter la morale en question), dans un film, cette morale n’est pas forcément exprimée ou perçue comme telle. Une fable au cinéma se contente de présenter un montage de séquences où des personnages se font face, et la moindre phrase, la moindre situation, peut alors être interprétée à un moment ou à un autre (plus souvent à la toute fin bien sûr) comme une « morale », une conclusion significative. Et s’il y a du mysticisme chez Ordet, il y en a dans tout l’art. Et si l’on y traite de la foi, ce n’est rien d’autre comme dans tout l’art qu’une volonté de croire en sa capacité, réelle, d’émerveillement et d’éducation, quand la vie même trop souvent s’en rend incapable. Ainsi, ceux qui voudraient voir dans le monde des coïncidences significatives feraient bien mieux de fermer leurs livres de prières et de se rattacher à la beauté de l’art où seules ces coïncidences peuvent « exister ». Elles existent justement parce que l’art force, et permet, ces interprétations, jusqu’aux moins improbables, que c’en est le seul mystère, et que la réalité n’y est qu’un mirage. Ah, si nous pouvions autant douter dans le monde réel que nous le faisons au cinéma !…
À chacun le soin, avec Ordet (comme avec la plupart des chefs-d’œuvre possédant cette capacité de lecture multiple), de proposer et d’y voir la conclusion qu’il souhaite, voit et comprend. C’est le petit privilège du spectateur. En termes de bonne ou de mauvaise foi, le spectateur a toujours « raison ». Il défend sa perception d’un film qui, s’il est bon, ne « dit rien », ou « ne nous apprend rien » par lui seul, comme dirait Sirk. Ce qui serait malhonnête en revanche, serait de chercher à tordre la perception des autres, affirmant que sa lecture, sa compréhension, est meilleure ou plus légitime qu’une autre. Je le répète, un film n’a pas à être « expliqué » : une interprétation, aussi singulière soit-elle, n’a pas à être justifiée quand elle s’oppose aux autres. Ceux qui pensent tomber d’accord, sur la perception d’une œuvre comme sur la liturgie qu’ils ont le plus souvent en héritage, devraient y regarder de plus près, car ils se rendraient compte aussi qu’en détail, leur interprétation est sujette aux mêmes malentendus. C’est cette particularité de lectures qui fait la force de l’art. Or, trop souvent, on oublie à quel point il est vain de chercher à se heurter à la perception de cet étranger qui voit pourtant le même film, qui le perçoit d’une manière qui ne sera jamais la même que celle d’un autre, sinon pour en mesurer seulement la différence, afin que son « étrangeté » devienne moins un motif de peur ou de mépris.
Vois-je en Ordet autre chose qu’un film sur la foi (religieuse), un film mystique ? Oui. Et pour cause : la foi, je m’en moque. Je suis athée, et ce film n’aura jamais remis en question en moi cette « foi ». Chacun sa capacité, en tant que spectateur, à tordre ce qu’il voit à sa convenance. Je profite de ce privilège, et je tords sciemment ce que je vois. Ce que je me refuse à faire dans la vie, je le fais en tant que spectateur. Je force les interprétations, et je m’aide à croire en ce que je veux voir. Ce n’est peut-être pas si éloigné que ça de l’esprit du film.
Comme dans les meilleures fables, la clé de voûte qui rend toute la logique cohérente de cette histoire se trouve à la fin. Ordet fait la même chose, et c’est bien, à mon sens (en interprétant l’intention de « l’auteur »), pour prendre à contre-pied une dernière fois les attentes du spectateur. Si la fin est dominée par le retour de Johannes à l’enterrement de sa belle-sœur, et si toute la question alors est de comprendre pourquoi cette dernière ressuscite, on a vite fait, effectivement, de poser la question de la foi, et de se rallier en somme à la croyance populaire qui dit que si le Christ revenait sur terre, il serait pris pour un fou… Avant, peut-être, de se lancer dans le marché des miracles. Dans cette logique, d’accord, le sujet du film, c’est la foi, et tout est bien « logique ».
Or, il y a un autre personnage essentiel dans cette fable, ou ce conte philosophique, c’est le médecin. Voilà une autre clé du film, située plus tôt, et qui peut-être permet à toute la structure de tenir debout dans mon esprit : la science, à travers la médecine, échoue, car elle pose un mauvais pronostic et ne voit pas venir le pire. Est-ce qu’après avoir moqué les différentes églises, le film (ou Dreyer) se mettrait à moquer les principes de la science… au profit d’une foi, ou d’une croyance, encore différente ? C’est une possibilité, mais je l’ai surtout vu comme une attaque plus générale contre les certitudes. Ainsi, si l’on replace cet épisode dans le contexte qui précède, à savoir une critique des différentes religions censées parler d’un même Dieu, mais incapables de faire la paix, tout s’éclaire. Car si l’on oublie la religion, seules restent les certitudes qu’elle produit sur les uns et les autres. Mystique ou non, la cohérence propre du film, en tout cas pour moi à cet instant (vers le milieu du film), c’est une critique des dogmes, ainsi que des hommes si prompts à adhérer à des principes ou des croyances pourris de l’intérieur (à l’image de Hamlet disant que tout est pourri au Danemark, Johannes parle vers la fin de pourriture du monde en s’adressant au cadavre d’Inger et lui demande presque de pourrir à son tour ; ce qu’elle fait, puisqu’elle revient à la vie…). L’homme suit son berger comme un mouton, et c’est bien là le problème. En réalité, j’aurais été encore plus comblé si à travers le film, ce n’était pas seulement les certitudes religieuses et scientifiques qui y étaient pointées du doigt, mais également les certitudes politiques, philosophiques, morales, idéologiques ou esthétiques. Deux suffiront à mon bonheur et pour me convaincre (deux coïncidences, au cinéma, c’est déjà assez pour les rendre significatives). Chacun ses certitudes. Je ne fais encore que jouir de mon pouvoir tout puissant de spectateur, libre, seul, d’interpréter ce qu’il voit.
Là où ça devient amusant, c’est qu’on peut également retraduire le film, en particulier son dernier acte « pascal », en fonction de cette idée : si la morale du film, c’est qu’il ne peut y avoir de certitudes et qu’il faut se « consacrer » à des choses simples, comme vivre (dernier mot du film), alors pourquoi devrait-on se mettre alors à « croire » à cette seule idée ? C’est un pied de nez plutôt nihiliste qui revient à dire, au début du film : « La fin du film vous dira la bonne parole, la vraie », et arrivant à la dernière phrase attendue du film, on dirait alors : « Il ne faut pas croire toutes les affirmations gratuites », en particulier celles illustrées dans le film, et peut-être plus encore la première qui y est exposée… Un paradoxe qui a lui seul pousse à un certain relativisme, au doute, et qui rend impossible toute adhésion réconfortante à une idéologie ou une croyance.
Voilà mon Ordet. La seule logique du film, c’est qu’il n’y en a aucune. Et ça vaut autant pour les religions, la médecine et la cohérence même dramatique, logique, du film. Transposée à la foi, cela revient à dire qu’il n’y a de foi que si l’on veut y croire. Fin de l’histoire, merci : vivre, c’est être leurré, apprendre à tâtonner dans le brouillard, et la seule foi, véritable, palpable, elle, est dans les efforts que l’on fait à survivre et à chercher à croire. La réalité ne peut être que dans la quête, car chaque fois que l’on pensera avoir trouvé, on pourrait être certain que l’on ne fait rien d’autre que nous tromper. Ceux qui savent sont des imposteurs ; la seule foi honnête, c’est le doute, peut-être même le paradoxe, comme celui de ce « mystère » final, car il questionne en interdisant toute interprétation unique, donc toute certitude.
Ainsi, cette pirouette finale jugée souvent comme une « adhésion » à une certaine forme de mysticisme, je la vois surtout comme une volonté de dire « même à propos de ce film, n’adhérez pas en sa logique propre, ne vous laissez pas prendre par sa cohérence, parce qu’elle ne saurait être qu’une arnaque, comme pour le reste ». Et de se dire, au fond, que le seul miracle, c’est bien celui de la fin, mais non pas du réveil de la morte, mais celui qu’elle évoque elle-même pour en finir : vivre. Ou, dit autrement : le miracle de la vie. A-t-on besoin d’être convaincu d’autre chose ? Après tout, c’est une morte, elle doit en savoir long sur les réalités du monde… La bonne parole sort de la bouche des ressuscités.
Ce qui est étonnant encore, c’est la manière dont Dreyer semble nous (moi) évoquer cette logique de l’incohérence et du doute, à travers une satire douce et presque bienveillante, des hommes de foi. Cela peut paraître improbable, mais le film est aussi immensément drôle. La scène des deux vieux qui se toisent comme des vieux coqs fatigués en se jetant à la figure leurs vérités sur leur foi respective est hilarante. La chute de la séquence est admirable, digne des meilleures screwballs : le fils revient leur demander s’ils se sont mis d’accord sur son mariage… et l’on sent dans le regard des deux vieux, comme un petit quelque chose de : « Peut-il nous ennuyer, celui-là, avec ses questions triviales, alors que l’on parle de la seule chose qui compte : Dieu ! » C’est à la fois absurde et plein de tendresse pour ces personnages tout aussi à l’ouest que Johannes. L’humanité de Dreyer. Le regard qu’il porte sur ses personnages est toujours tendre. Ordet est un de ces films rares où il faut chercher longtemps, malgré ses quelques notes satiriques, des personnages antipathiques. (La séquence des deux amoureux réunis autour d’une table et chaperonnés dans la joie est toute aussi hilarante.)
Il est fascinant qu’un film puisse offrir une telle diversité d’interprétations. Aucune n’est meilleure qu’une autre. Elles enrichissent le film à leur tour. Le tout est… d’adhérer le plus honnêtement possible à ce que l’on pense jaillir du film, même si ce n’en est pas que du bien. En revanche, sur la question de la certitude, c’est déjà un travail plus difficile à opérer pour un spectateur honnête… Commencer à douter, ou être conscient que cette adhésion ne regarde que nous-mêmes et que s’il y a échanges entre cinéphiles, l’idée de composer un consensus et de s’entendre sur des qualités objectives d’un film est parfaitement vaine. C’est un peu ça aussi la morale qu’on pourrait tirer du film : vivre, accepter de vivre, c’est comprendre qu’il n’y aura jamais personne capable d’adhérer pleinement à ce que l’on pense. La communion n’est jamais qu’un mirage. Un homme, comme un cinéphile, comme un croyant, n’est jamais qu’un animal solitaire. On rêve d’échapper à notre solitude, à travers la communication, la communion, l’adhésion, et en fait non, on doit se résoudre à n’être toujours que seuls face à nous-mêmes, étrangers aux autres. Vivre, oui, parmi les mensonges, les trahisons, les faux-semblants, parce qu’il n’y a rien d’autre. La vérité est bien ailleurs, un horizon inatteignable. Autant s’y résoudre.


Un mot sur le contexte puis sur la mise en scène. La pièce a une première fois été adaptée du vivant de son auteur (Kaj Munk) par la Svensk Filmindustri en 1943 alors que le studio pouvait probablement jouir du statut de neutralité de la Suède pendant la guerre quand le Danemark était lui occupé par les nazis (Munk sera assassiné avant la fin de la guerre à cause de ses prises de position — il était pasteur — contre l’occupation allemande). Difficile de comprendre comment et pourquoi la SF s’est emparée à cette époque du projet mettant en vedette Victor Sjöström, quoi qu’il en soit, c’est bien un peu plus de dix ans plus tard que Dreyer reprend la pièce. Reste à connaître les différences de traitement des différentes versions, car si le spectateur a tous les droits dans son interprétation d’un film, une mise en scène, voire une adaptation, constitue déjà à elle seule une première interprétation… Cette version de Gustav Molender est une curiosité à ajouter sur les tablettes donc (à mettre d’ailleurs plus au crédit, peut-être, de Rune Lindström qui en avait assuré l’adaptation en suédois et qui y jouait le rôle… de Johannes — étrange mise en abîme, ma parole !…).
Quelles que soient les interprétations ou modifications apportées par Dreyer dans sa version, il en garde l’esprit théâtral. Ce genre d’exercices peut parfois se révéler délicat, mais le maître danois dirige ses acteurs à la perfection et imprègne son film d’un rythme (-2, donc) fascinant. Le piège est souvent de tomber dans le bavardage, dans les excès de jeu. Pourtant, Dreyer résiste à tous ces écueils, c’en est bluffant. Le travail sur le son par exemple dénote une volonté de casser subtilement avec les contraintes de l’enfermement théâtral. Au lieu de proposer des plans à l’extérieur des habitations où se tiennent les différentes scènes (et en dehors de l’intro dunesque, certes), Dreyer se contente de suggérer un hors-champ par quelques éléments sonores : le bruit du vent, celui d’un moteur de voiture… Autant de procédés déjà utilisés au théâtre et qu’il fallait oser employer dans un film alors qu’on dispose bien sûr des outils propres au cinéma… Dreyer respecte ainsi de la meilleure manière l’origine théâtrale de son film, et sans chercher à la renier, en fait même une force…
J’évoque brièvement plus haut comment Dreyer arrive à rendre sympathiques des personnages crédules ou fous. On dit souvent qu’un acteur (et a fortiori un metteur en scène) doit défendre son personnage. On est tout à fait dans cette logique. La tentation parfois pour un acteur est de jouer la caricature, le premier degré, et en oublie toute idée de mesure, qui seule peut arriver à offrir au spectateur une interprétation du personnage non biaisée. Ce que dit Sirk concerne tout autant le metteur en scène que l’acteur : un acteur ne doit pas porter de jugement sur son personnage (autrement que pour le défendre, puisqu’évidemment, la mauvaise foi du personnage, ses crédulités, ses petites folies, l’acteur doit s’en faire l’avocat) et laisser l’interprétation se faire à travers la compréhension, l’intelligence et l’imagination du spectateur.
On pourra trouver de la théâtralité dans cette manière de jouer, mais je n’y verrai toujours qu’une qualité, parce que dans cette façon dont Dreyer et l’ensemble de sa distribution maîtrisent leur art, et pour connaître un peu des difficultés de ce travail, je n’y vois que du génie. C’est l’exercice le plus compliqué à rendre au cinéma, c’est même plutôt rare au théâtre, et pourtant tout est parfait. La question de la théâtralité au cinéma ne renvoie jamais à l’idée de trop ou de pas assez*, mais toujours à la « justesse » de jeu. Pour l’interprétation d’un fou par exemple, rien de plus compliqué pour un acteur d’arriver à trouver la justesse ; on tombera vite dans le grotesque et l’excès. Et c’est d’autant plus difficile à retranscrire que dans la dernière scène, quand Johannes réapparaît, il semble tout d’abord avoir recouvré ses esprits. Voilà une nouvelle subtilité, un nouveau pied de nez…, car il n’est pas revenu à la raison, ou peut-être que si… Mystère.
* À noter toutefois que selon une source invérifiable Dreyer aurait coupé une grosse partie des dialogues de la pièce (le film aurait sans doute alors duré six heures).
Il faut voir aussi comment Dreyer dirige ce même acteur accompagné d’une fillette qui, pas plus que les autres acteurs, montrera des failles dans son interprétation. La même aisance, la même justesse, la même sensibilité tout en retenue, la même humilité… Quand tous les acteurs arrivent ainsi à se mouler dans la même logique de jeu, c’en est presque jouissif. Sans compter l’habilité de Dreyer à ralentir le rythme sans que ça paraisse trop artificiel. On accepte le principe, on peut même parfois en rire dans les situations clairement ironiques du film qui prêtent plutôt à la brutalité, aux envolées, aux excès. Avant même qu’on se moque des films, et du rythme, des films de Bergman (à voir l’excellent De Düva* où les acteurs anglo-saxons imitent, déjà en 1968, les films du cinéaste suédois en parlant en yaourt), Dreyer semble déjà lui-même ralentir un peu plus le rythme, accentuer la pesanteur, pour se moquer de l’austérité des bigots. On ne retrouve pas forcément cet humour d’ailleurs chez Bergman, sa lenteur supposée me semblant toujours être légitimée par une situation ; alors que Dreyer joue la carte avec subtilité de la théâtralité, donc de l’artificialité, capable d’offrir un regard tronqué d’une situation… Et qu’est-ce qu’un regard volontairement tronqué sinon de l’humour ?
* À voir sur youtube








La Parole, Ordet, Carl Theodor Dreyer 1955 | Palladium Film
Vu le : 31 mars 1997
Revu le : 12 octobre 2016
Listes sur IMDb :
✓
✓
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel




















 Année : 1955
Année : 1955








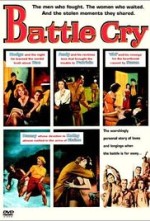


 Année : 1955
Année : 1955

























