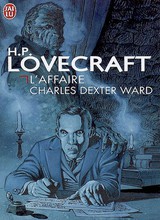Fabulation en guise de commentaire détourné
(Harry Cohn était le directeur historique de la Columbia, distributeur de Nightfall. À la même époque, Dennis Hopper peinait à trouver du travail en tant qu’acteur. Le second essaie de faire comprendre au premier que le cinéma est à un tournant et qu’on en sent les prémices dans ce film. Dix ans plus tard, c’est la Columbia qui distribuera Easy Rider, l’un des films phares du Nouvel Hollywood.)
— Allô ? Dennis ? Harry Cohn à l’appareil…
— Salut, chef !
— M’emmerde pas ! C’est quoi cette note de service que je viens de recevoir ? Je t’ai demandé d’espionner sur les plateaux et tu me ponds… des commentaires sur le film avec quelques… conseils ? Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, gamin ? Qu’est-ce que tu as fait pendant tout ce temps ?
— J’étais avec Elvis comme vous me l’aviez demandé, chef. Je n’ai pas pu aller sur le film de Tourneur parce qu’il y avait trop d’extérieurs…
— Comment ça le film de Tourneur ? C’est Tyron Power qui me l’a proposé…
— C’est Jacques Tourneur qui le réalise, chef, c’est son film. Tyron Power a créé la Copa dans cette optique, pour donner plus de libertés aux…
— Ah oui ! C’est ce que tu dis dans ton machin : la politique des auteurs, c’est quoi ces conneries ?
— C’est français, chef !
— Si c’est français, c’est des conneries ! Bref, qu’est-ce que je lis là : « Ne vous êtes-vous jamais mis à regarder les couples dans le métro en essayant de deviner d’après la manière dont ils parlaient depuis combien de temps ils étaient ensemble ? » Mais bordel, Dennis, c’est quoi cette merde ? Tu crois que je prends le métro ? Tu te crois à New York ? Et puis, tu te prends pour un écrivain, c’est quoi cet immonde détour pour introduire une note de service ! Une putain de note de service où je te demande qui fait quoi sur un plateau !… Écoute-moi bien Dennis, je suis le dernier à t’offrir du travail, t’es sur la liste noire. En plus d’être un crétin de rouge à ce qu’on dit, il a fallu que tu ailles chercher des poux à Hathaway. T’es un malade, Dennis ! Donc si tu veux rester en Californie et éviter de retrouver dans ton putain de métro new-yorkais, tu fais ce que je te demande !
— Vous étiez bien pourtant heureux d’avoir reçu ma note de service sur la musique diégétique, chef !
— Si tu crois que j’y ai compris quelque chose à ta fichue note !… Mais je te reconnais au moins ça oui, Dennis. La musique pour Le Pont de la rivière Kwaï, ça marche du tonnerre. En plus du film, on vend à tour de bras cette musique qui ne nous a pas coûté un kopeck… Et c’est bien parce que t’avais l’oreille musicale que je t’ai fourgué avec Elvis, qu’est-ce que tu crois !
— Mais Harry, il m’emmerde ce type. Je peux pas prétendre éternellement être son pote…
— T’étais bien pote avec ce pédé de James Dean, je pensais au moins te faire plaisir ! Et m’appelle pas Harry, connard !
— Très bien, connard…
— Ni Harry, ni chef, ni connard, espèce de trouduc !!!…
— Très bien…

Nightfall, Jacques Tourneur 1957 | Copa Productions
— Je reviens à tes commentaires : tu m’expliques les figures de style en moins ?
— Voyez-vous, il s’est comme passé un truc sur ce film. Je suppose que vous l’avez vu comme moi, lors de la première rencontre entre Anne Bancroft et Aldo Ray dans le bar…
— J’espère que tu plaisantes, elle n’en finit pas cette scène ! J’ai cru mourir !
— Elle est nécessaire pour exposer les personnages, développer leur psychologie…
— Attends, Dennis, j’ai raté un wagon : t’es acteur, pas scénariste, ça aussi c’est une idée de ta… politique des auteurs ? Tu veux te convertir, tu veux être le nouveau Dalton Trumbo ?
— Mais écoute, la psychologie, c’est très important, c’est l’avenir du cinéma. Laisser plus de champ aux acteurs, créer des personnages plus complexes, s’attarder sur les détails de la vie, les incertitudes…
— C’est ce que je dis : tu te fous de ma gueule ! Le cinéma, c’est l’action. L’action, c’est tout ce dont le public demande. Et ce que le public demande, c’est à nous de lui donner. L’offre. Et la demande.
— Mais Harry, si tu lui offres toujours ce qu’il attend, ton public va se lasser… Et puis merde, c’est de l’art aussi…
— J’ai rien entendu. Bon, explique-moi ce truc avec Aldo…
— En fait, je crois que ça tient plus d’Anne Bancroft. Aldo est très bon, mais il est encore meilleur dans cette scène parce qu’elle l’élève à un niveau que peu d’acteurs peuvent atteindre. Jimmy m’en parlait déjà, ce sont les nouvelles techniques de jeu à New York…
— Je ne compte pas importer dans mon studio ce jeu chiant à mourir où les acteurs se grattent les fesses en regardant les étoiles ! Ici, c’est Hollywood, c’est l’action qui détermine le rythme. À l’écran, dès que tu baisses le rythme, le spectateur s’endort et la prochaine fois, il ira voir ailleurs. J’ai vu ça pour Sur les quais : c’est bon pour décrocher des Oscars, mais je n’ai pas aimé le travail qu’a fait ce Français avec un accent bolchevik sur le film de Kazan. Ces scènes en extérieurs sont mal éclairées, ça fait vrai, mais est-ce que le public demande que ça fasse vrai ? Non. On vend du rêve. Pas cette lèpre néoréaliste…
— Et pourtant, je sens un truc, j’ai vu ça en rêve, Harry ! Je suis sûr qu’on va y venir.
— Mes couilles ! L’écran large, Technicolor, musique et action ! Le Pont de la rivière Kwaï ! Bon sang, Dennis, même quand tu as raison, t’es incapable de t’en rendre compte. Et tu veux devenir scénariste, ou critique, ou je ne sais quoi…
—… Réalisateur ! Un jour, je serai un putain de réalisateur ! Je serai aussi scénariste et je jouerai aussi dans mon putain de film, Harry ! et tu sais quoi, Harry ? c’est toi qui le distribueras ! Je ferai tout pour t’emmerder, mais tu finiras par le distribuer mon putain de film !!!
— Plutôt crever !
— Tu ne comprends pas, Harry ! T’es un dinosaure, le vieux Hollywood va s’effondrer et tu vas t’effondrer avec ! Tu vas crever espèce de fossile fasciste !!!
— Bon sang, mais c’est vrai ce que disait Hathaway ! t’es un véritable emmerdeur ! Et moi qui te file un job !… Qu’est-ce que tu en sais qu’on va crever ?! Que ton tour viendra ?! T’es rien ! tu ponds des notes de service, tu t’encanailles avec des têtes d’affiche, mais toi t’es rien ! t’es qu’un emmerdeur !
— J’ai raison, Harry ! et tu verras ! Tu verras que tous les acteurs passés par New York s’imposeront à Hollywood, et si Hollywood ne leur laisse pas les clés, il n’y aura plus rien ici ! Ce sera la Floride, il n’y aura plus que des vieux à siroter leur martini dans un transat !
— Eh bien parlons-en de ces acteurs de la « méthode »… Qu’est-ce que tu lui trouves à cette Anne Bancroft ?! Elle est censée être une actrice caméléon, comme ils le prétendent tous, et elle est pas fichue d’être crédible en mannequin ! Tu l’as pas vu marcher ?! ils ne vous apprennent pas ça les Français ?! On dirait une gourde qui avance !… Ils me font rire ces acteurs de Lee Strasberg… J’ai vu ce Paul Newman dans Marqué par la haine : si c’est ça l’Actor studio, donner un rôle d’Italien à un Irlandais, ça va vite capoter cette histoire ! D’ailleurs, ça l’est déjà… on dit qu’il tourne un western avec un type venu de la télévision. C’est déjà fini pour lui. Et tiens, ton Anne Bancroft, je la renvois illico à la télévision, elle aussi : ma « méthode » ! Et dans dix ans, je la sors du placard, et j’en fais une mère juive !
— Elle est Italienne.
— C’est donc qu’elle est déjà ringarde ! Les Italiens, c’est fini pour eux à Hollywood. Capra, Minnelli, Sinatra. On a eu note dose. Le temps est à l’Amérique profonde. Regarde Elvis, c’est lui l’avenir du cinéma. Il me faut des types comme Elvis !
— Je te le promets… Tu la reverras. Parce que les choses vont changer. Quand je suis défoncé, je vois le monde tel qu’il sera dans quelques années. Et je la vois, Harry. Je la vois, Paul Newman, et ce réalisateur…
— Arthur Penn… la télévision… quel cauchemar… Je veux Elvis ! Je veux du rêve sinon on va tous crever à cause de cette salope de télévision !
— Voilà ! tu comprends rien Harry. Tous, nous allons prendre le pouvoir ! et plus jamais rien ne sera comme avant ! Tu verras comment les acteurs qui sont capables d’improviser vont imposer une nouvelle manière de jouer. Le rythme sera ralenti, moins systématique, et ce sera la psychologie contrariée des personnages qui fera avancer ta putain d’action ! Pas ton putain d’Elvis ! Tu verras que c’en sera fini des tunnels de dialogues bien écrits ponctués par une musique de fanfare. La musique sera présente, oui, mais pour illustrer les états d’âme des personnages. Ou elle sera diégétique…
— Comme dans Le Pont de la rivière Kwaï…
— Parfaitement !
— Et comme Elvis, bonté divine !!!
— Non, ce sera le temps du rock’n’roll non pas parce que vous voudrez mettre aux goûts du jour vos musicals, mais parce que le rock, c’est la vie, c’est la rue, et parce que c’est la vie, c’est naturel de l’entendre à travers la vision des personnages. Les vieux genres hollywoodiens, que sont les musicals, les westerns et les films noirs vont disparaître et réapparaître sous de nouvelles formes, que nous, déciderons de remettre au goût du jour… Comme dans L’Équipée sauvage… L’avenir est au western mécanique, aux musiques électriques, et aux paradis artificiels…
— Mais putain, Dennis, tu dis n’importe quoi ! Je comprends plus rien : c’est quoi… les films noirs !
— Tes putains de « crime films », Harry ! Ce sont les Français qui les appellent comme ça !
— Tu m’emmerdes avec tes Français ! Qu’ils s’y mettent à faire des films ces losers ! Ceux qui sont encore capables de faire quelque chose, ils sont ici, à Hollywood ! Tourneur, c’est bien lui qui a dirigé ta Bancroft !
— On ne dirige pas Anne Bancroft, Harry ! Tu n’as pas bien vu le film ! Je te le redis : pense à mes couples dans le métro…
— Très bien, monsieur je-vois-l’avenir, explique-moi ça deux secondes !
—… c’est pourtant simple. Elle parle dans cette scène comme si elle connaissait Aldo Ray depuis une éternité…
— Ah, voilà ! elle est là ta crédibilité ! ton génie !… C’est leur première rencontre ! ça tient pas la route !
— Elle est là la nuance, Harry. Et c’est ça que toi et tes congénères de l’ancien monde ne pourront jamais comprendre. C’est parfaitement délibéré de sa part : c’est une approche psychologique. On s’adresse ainsi aux gens quand on a déjà plus rien à attendre d’eux, quand on a des certitudes et la première d’entre elles : qu’on est déjà un loser…
— Je comprends mieux maintenant pourquoi elle porte un prénom français…
— As-tu remarqué comment elle parlait ? Il n’y a pas cinquante pancartes lumineuses qui s’éclairent quand elle s’apprête à parler. Ça coule tout seul. Les acteurs de demain seront capables d’improviser, mais ils seront aussi capables de jouer avec simplicité le texte imposé : le corps disposera de sa vie propre, et les mots ne seront l’expression que d’une puissance intérieure, l’une et l’autre s’opposant aussi naturellement que je m’oppose à toi.
— Cette saloperie qui te fait parler a donc un nom ?! c’est un putain de « naturalisme » ?!
— C’est une nouvelle ère qui s’ouvre. Et ton Aldo fait pareil. C’est un acteur correct, mais il ne sera jamais aussi bon que dans cette scène… Parce qu’il a en face de lui une actrice qui lui facilite le travail.
— Dennis ?!
— Harry ?
— Je veux plus te voir. T’es viré. Ne compte plus travailler à Hollywood, ne pense même plus foutre les pieds en Californie. Henry avait raison. Tu es fou à lier. Je peux faire une dernière chose pour toi : je te paie ton voyage pour New York. Je suis sûr qu’on apprend beaucoup de choses sur la psychologie du personnage dans une rame de métro. J’ai eu ma dose.
— C’est la chose la plus sensée que tu aies jamais dite à mon attention, Harry. J’irai à New York, et je suivrai les mêmes cours qu’Anne Bancroft. Et que Jimmy…
— Jimmy est mort Dennis, fais-toi une raison et reviens à la réalité…
— Jimmy avait raison et vous avez tort ! L’avenir est aux auteurs, aux réalisateurs, aux acteurs, à la liberté et à la vie. La révolution viendra d’Europe, et Hollywood sera obligé de suivre en nous laissant les clés. Hollywood, Harry. Pas toi, parce que tu ne seras plus là malheureusement à l’heure de notre sacre pour venir nous embrasser le cul. Tu seras le premier à laisser ta place, mais tous les autres suivront. Un nouvel Hollywood est en marche : Anne Bancroft et Arthur Penn travailleront ensemble. Anne Bancroft, toujours, en ton honneur, baisera un jeune juif avant de le voir s’échapper avec sa fille : tout le monde baise tout le monde. Pas de bons, pas de méchants, ce sera ça le nouvel Hollywood. Parce que c’est ainsi qu’est la vie. J’ai eu une vision durant Nightfall. Tu vois, ces bus à la fin du film ? Ne trouves-tu pas choquant de faire ça en studio ?

— Ça coûtait moins cher ! Il y avait déjà trop d’extérieurs !
— Bientôt, on hésitera plus à prendre la route et aller là où est la vie. On partira aussi pour être libérés de votre bêtise : laisser une équipe partir en extérieurs quelques semaines et imposer que les scènes du bus soient tournées en studio pour avoir plus de contrôle sur le tournage ?… Eh bien, j’ai eu cette vision, Harry, et un nouvel âge commencera, là, à l’instant où deux mômes irresponsables prendront la route à bord d’un bus vers une destination inconnue. Celle qui restera derrière et qui leur aura en même temps montré la voie, représentant le vieil Hollywood, ce sera elle, Anne Bancroft. Et ils partiront, loin de tout ça et d’eux-mêmes. Lonesome Cowboy, Harry. Easy Riders. Nos racines sont là : sur la route. Et nous allons y retourner pour de bon. Accompagnés, mais seuls, perdus. En recherche de quelque chose qui ne vient pas. Parce que c’est ça la vie. Et parce que bientôt, la vie qui s’imposera au cinéma sera celle des enfants de la guerre. Cette glorieuse génération de baby-boomers qui demandera sa place dans le monde et qui refusera de faire la guerre. Ils s’opposeront à leurs parents en faisant le choix de l’éternelle jeunesse, c’est-à-dire de l’irresponsabilité. Fini les happy ends où chaque chose doit revenir à sa place. Au contraire, tout devra remuer, et c’est cette agitation, cette incertitude, qu’on se doit de montrer au cinéma et qui ne se fait pas encore. Une errance. Une quête. Un abandon à soi-même et une attirance fatale vers le vide. On vous attirera ainsi vers le fond quand vous serez tout fatigués et nous seuls remonterons pour être les nouveaux géants. De nouveaux tyrans animés par leur seule irresponsabilité. Et quand les chefs de studios recevront des notes de service de la part des auteurs, ce ne sera que pour répondre « OK ».
— Je sais tout ça, Dennis. Et tu sais pourquoi ?
— Non.
— Parce que je fais aussi partie de ton rêve. Je suis déjà mort. Tu ne m’as jamais envoyé de note de service parce que tu es incapable d’écrire quoi que ce soit, Dennis. Ta vision du futur est exacte, mais elle reste incomplète. Tu feras Easy Rider, oui, et nous le distribuerons. Et ce sera un succès. Et puis, tu continueras à être ce que Dennis Hopper a toujours été. Un fou et un emmerdeur. Certains d’entre vous prendront le pouvoir. Anne Bancroft connaîtra le succès tel que tu en as eu la vision… Mais ceux qui prendront notre place la prendront et la garderont en appliquant nos méthodes. Et ceux qui comme toi refuseront de les appliquer en prétendant faire un cinéma de la méthode resteront en marge. Comme toutes les révolutions, Dennis : ton nouvel Hollywood ne durera qu’un temps. Le… néoclassicisme arrivera pour s’imposer dans la longueur sans même que vous vous en aperceviez. Il y a des opportunistes qui prendront la main quand nous partirons, et il y a les losers. Tu es un loser, Dennis. Et c’est ce que tu as toujours voulu être.
— FUCK YOU, Harry ! fumier !
— Easy, easy, Dennis. Je ne suis que le rêve d’un fou. Alors réveille-toi. Et que tombe la nuit.