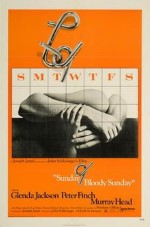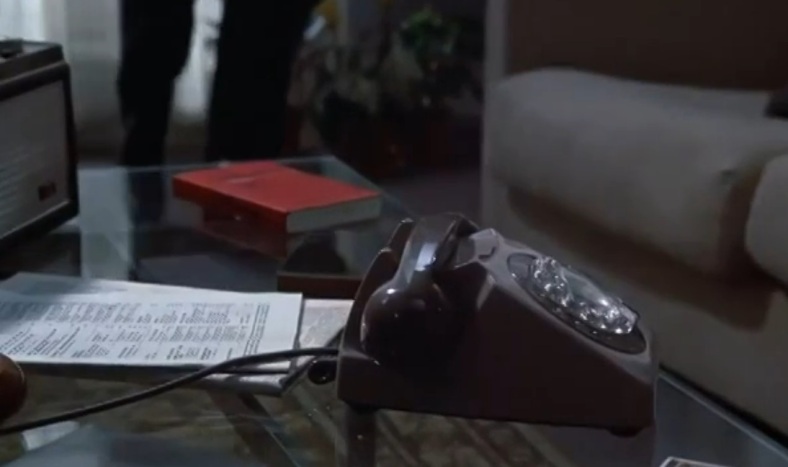Le viol de Martin Sheen par Hal 9000 finissant par accoucher d’une souris neurasthénique.
Il faut être maso déjà pour se coltiner la référence 2001, mais rajouter celle d’Apocalypse Now, ça ne passe plus du tout. Si Gray voulait échapper à la critique habituelle du film de SF qu’on compare immanquablement au film de Kubrick / C. Clarke en noyant le sien sous une seconde référence, c’est raté. Parce que pour le coup, cette seconde référence saute encore plus aux yeux. Avoir la prétention de dépasser 2001 quand on fait un space opera, ma foi, cela a du sens, mais coller autant à deux films, en en empruntant autant d’éléments, avec comme prétexte apparent d’y adjoindre un thème cher à son auteur, celui des difficiles relations père/fils, ça me paraît être une entreprise bien plus hasardeuse si on ne prend pas suffisamment de recul avec les chefs-d’œuvre dont on emprunte les arguments respectifs ; surtout si on colle autant à leur trame, et qu’on se révèle incapable de les concurrencer au niveau de la mise en scène.
Sur le papier, pourtant, oui, il y a une proximité dramatique entre le film de Kubrick et celui de Coppola qui pourrait justifier une tentative de rapprochement : les deux adoptent probablement à leur manière la plus belle (et la plus efficace) histoire du monde, celle de L’Odyssée. On pourrait donc imaginer un jour un mix autrement plus convaincant entre ces deux chefs-d’œuvre, si toutefois on arrivait à s’affranchir de leur emprise. Si Ad Astra est un exercice raté de composition, il démontre à nouveau une chose : que la réussite d’un film dépend moins de son argument que d’infinis détails de mise en scène servant à l’illustrer. Et de la mise en scène, James Gray ne semble pas s’en préoccuper beaucoup. Par exemple, l’obstination à ne laisser aucun détail au hasard, que ce soit chez Kubrick ou chez Coppola, passe par l’adoption de la meilleure musique possible. C’est le cas de beaucoup de chefs-d’œuvre. Que seraient ces films sans leur partition ? Est-ce qu’on imagine 2001 avec une musique de Eric Serra ou Apocalypse Now avec une musique de Philip Glass ou de Hans Zimmer ? Gray n’a peut-être pas l’ambition de proposer un grand film, c’est possible. Auquel cas il n’aurait pas choisi cette navrante musique d’ascenseur spatial. Peut-être a-t-il opéré un tournant depuis The Lost City of Z (voire depuis le pathétique The Immigrant), et tente-t-il alors de se situer au carrefour du film à grand spectacle et du film d’auteur… Au risque de perdre certains de ses admirateurs, dont je fais partie, en route. Soyons honnêtes, ce luxe, peu de cinéastes a pu en bénéficier. Le seul fait qu’il puisse (avec l’aide des financements de Brad Pitt, il faut le croire — il avait déjà produit The Lost City of Z) tenter sa chance une seconde fois est un luxe supplémentaire. Rappelons tout de même que Z n’est pas une franche réussite : si chacun pouvait avoir son mot à dire sur la qualité du film (signalons toutefois que le film n’a reçu aucune nomination dans des festivals ou prix prestigieux), personne ne pourra contester les chiffres du film qui selon IMDb aurait perdu 10 millions de dollars. Tout cela est le signe peut-être qu’il n’y a guère que par chez nous (en Europe) qu’il est vu et considéré comme un auteur. À y regarder de plus près : Little Odessa semble avoir été repéré par le festival de Venise ; c’est ensuite Cannes qui le porte aux nues pour ce qui compte peut-être pour ses meilleurs films : The Yards, La nuit nous appartient et Two Lovers. Il n’est plus rappelé à Cannes depuis The Immigrant, signe, là encore, du tournant pris par le réalisateur.
Tout ça pour dire que oui, Gray a du talent, mais qu’il se fourvoie peut-être depuis trois films à faire ce dont il ne me paraît pas le mieux armé. Ce que j’appréciais de mon côté dans ses premiers opus, c’était la profusion de personnages, les conflits et l’ambiance feutrée qui ne me paraissaient alors pas découler d’un processus de mise en scène, mais plus d’une tension relative aux seules situations. Ce dernier point est important pour moi parce qu’en cherchant à se lancer dans des films plus commerciaux, Gray se serait en quelque sorte retrouvé dans l’obligation d’user d’éléments de la mise en scène qu’il ne maîtrisait alors pas vraiment. Il ne faudrait pas confondre Gray et Scorsese par exemple : la force de ses premiers films tient beaucoup plus dans sa capacité à créer des situations tendues que dans celle de les tendre… par le biais d’une mise en scène savante pleine d’artifices. Il y avait jusque-là (avant The Immigrant) peu d’artifices dans ses films, et j’aurais volontiers pu, de mon côté, parler de lui comme d’un cinéaste avant tout bon scénariste ; et plutôt un scénariste lorgnant vers David Mamet, voire Woody Allen (cette manière de décrire un milieu, une ville, New York) plutôt que Tarantino (les deux sont apparus la même année). Je ne vois aucune raison pour laquelle James Gray se serait tout d’un coup transformé en maître de la forme. Les mouvements de caméra, les angles recherchés, les jolis décors, le jeu avec le hors-champ, la composition sonore, la musique, le montage, tout cela, ça n’avait jamais compté parmi ses préoccupations. Son truc, c’était l’écriture, le milieu dépeint, les conflits (souvent intérieurs déjà). On peut certes proposer alors un cinéma… d’exploration spatiale en se focalisant sur la seule matière scénaristique, ou sur les personnages, un space opera intérieur, mais c’était un peu comme si en voulant se rapprocher d’un style plus commercial, aux portées plus ambitieuses, il s’était écarté de ce qui faisait alors la force de son cinéma. Apocalypse Now, c’est aussi la version de Coppola d’Au cœur des ténèbres adapté dans la jungle de la guerre du Vietnam : tout autant que le voyage, les doutes du personnage principal, c’est tout le milieu militaire déjanté qu’il décrit qui intrigue. Une plongée dans un milieu déterminé, voilà qui aurait pu plaire à James Gray. Pourtant, il ne s’empare pas de cette possibilité, choisit l’épure en concentrant la totalité de son récit autour du personnage interprété par Brad Pitt. L’introspection tient peut-être encore de la marque « Gray », mais tout ce qui navigue autour de lui paraît inexistant et ne pas intéresser le cinéaste. Ce qui ne poserait aucun problème si cela ne soulevait un nombre monstre d’incohérences : quand le hors-champ est laissé volontairement de côté, il peut rester flou mais paraître plausible, réel, légitime ; ici, au contraire, dès qu’un élément apparaît, il semble ne pas avoir d’existence propre en dehors de l’utilité dramatique pour laquelle il a été conçu. Certes, c’est un peu le principe du voyage, on rencontre des personnages, des situations, des îlots qu’on sera amenés à retrouver nulle part ailleurs, seulement chez Homère par exemple, ces rencontres sont menées à leur terme et constituent des épisodes à part entière dans la vie d’Ulysse. Ces épisodes peuvent durer des années quand ceux que traverse Roy McBride peuvent ne durer que quelques secondes. Vous parlez d’une expérience de vie… Plutôt express comme rencontres. Surtout que l’astronaute n’en tire pas véritablement de leçon ; au mieux, ces épisodes lui permettront d’appui, de prétexte, à relancer son soliloque sur sa relation au père, jamais à enrichir le personnage. Le voyage intérieur que semble proposer James Gray me paraît, à tous les niveaux, statique, redondant, et donc raté.
Tous les épisodes relatés lors de ce voyage (« à la recherche de papa ») semblent ainsi être constitués d’éléments étrangers les uns des autres, avec des passages obligés qui peinent à trouver un autre sens que celui, platement géographique souvent, de devoir traverser une frontière ou un obstacle. Qu’est-ce qui oblige McBride à devoir passer incognito par la Lune, puis de prendre un buggy en surface, puis par Mars, etc., si ce n’est pour essayer de coller peu ou prou aux types d’aventures rencontrées dans le film de Kubrick et plus certainement encore dans celui de Coppola ? Des pirates sur la Lune, sérieusement ? Vietnamiens alors. Et surtout, pourquoi tous ces chichis pour se rendre dans la région de Neptune quand il pourra toujours retourner vers la Terre en mode express à la fin du film ? Aucune explication. Des passages obligés, des scènes imposées, à faire, non pas par la logique, mais pour suivre le cheminement de la trame d’un film préexistant. La référence est pesante. Le modèle évident.

La Valkyrie sur la Lune
Mais tout cela procède de la structure dramatique. James Gray aurait ainsi collé à ses aînés en proposant un « corps de texte » plus consistant, et ce n’était plus un problème. Pourtant, c’est bien sur ce qui est censé être son point fort, que Gray peine à donner de la consistance à son film. Ainsi libéré de la pesanteur d’un milieu social, du noyau familial, d’un dilemme, de la gravité d’une situation, ne semble rester du James Gray des premiers films que la tonalité dépressive, introspective, et la répétition d’une même rengaine qu’il pense peut-être pouvoir reproduire sans fin parce qu’elle désigne l’objectif de la mission de son personnage principal : trouver le père. Une fois qu’on a dit ça, aucune des réflexions de Roy McBride n’arrive à élever le niveau. Si le film que James Gray voulait est là, je ne demande pas du Hamlet, mais une écriture, du sens, des mots. Pas du blabla de monsieur tout le monde.
L’idée d’un monologue comme on peut en voir dans Apocalypse Now avait pourtant tout pour me séduire. Je ne suis pas sûr qu’on y trouve non plus dans le film de Coppola de grandes envolées lyriques ou profondes comme on en trouve chez Conrad. Et c’est bien là qu’il faut revenir au génie purement formel d’un Coppola : ce monologue, il arrive à le rendre envoûtant grâce aux nombreux artifices de sa mise en scène. La musique des Doors, les angles de caméra, les fondus, les surimpressions, les ellipses, le montage sonore (d’une richesse inouïe et n’illustrant pas bêtement ce qu’on voit à l’écran), la variété des décors, des situations, des temporalités diverses, et surtout un sens du rythme et du récit hors du commun. Autant d’éléments que Gray n’a jamais véritablement mis en avant dans ses films, mais qui manquent quand il faut illustrer une quête, un voyage, où les séquences explosives succèdent aux autres servant de respiration.
Pas de rythme, pas d’intensité, sans respiration, sans variation. C’est un autre des paris risqués de James Gray, et un autre pari perdu : faire de son personnage une sorte de Droopy que rien n’atteint émotionnellement. Son rythme cardiaque ne dépasse jamais les 80 pulsations par minute (proposition à la véracité scientifique douteuse, équivalent du « Je n’utilise que 80 % de mon cerveau quand je réalise des films » cher à Luc Besson). Donc littéralement, volontairement, Gray décide d’anéantir toute idée de rythme et de tension dans son film. Une proposition qu’on pourrait trouver géniale dans un contexte de distanciation, on parlerait alors d’incommunicabilité (vu que c’est précisément ce dont il s’agit, tant avec son père qu’avec les extraterrestres), sauf que là encore, Gray ne s’empare pas de cette possibilité, et avance, inerte, porté par une logique narrative rythmée par les seuls seuils géographiques rencontrés par son personnage principal (et quand les personnages secondaires tentent de s’opposer à son voyage, la solution est vite trouvée, aucun conflit, aucun dilemme, aucune recherche de dialogue, de consensus, d’échange pour commencer… une histoire). Ici, on peut imaginer que Gray se soit laissé prendre par la volonté de croire que cet aspect pouvait coller, faire référence, à 2001. Si c’est ça, je ne serais pas d’accord : 2001 est lent, mais son rythme est imparable. Quand Kubrick ralentit le rythme, c’est pour porter l’attention du spectateur sur les éléments du décor, sur une situation qui s’éternise, sur l’attente d’un événement craint ou simplement sur la beauté d’une image (une beauté souvent basée sur un conflit, un dialogue, à l’intérieur même de ce qui la compose, que ce soit des éléments de l’image qui s’opposent, le hors-champ, l’incongruité d’un son ou d’une musique, etc.). Il y a donc tout sauf du vide dans le film de Kubrick. De la même manière, les rares dialogues de son film, loin de chercher à jouer à un concours de truismes sur les relations entre les êtres, mettent en situation des personnages qui sont censés ensuite prendre une connotation plus symbolique (le jeu d’échecs comme annonciateur d’une menace à venir, les hallucinations de Hal en train de rendre l’âme, etc.). En bon réaliste qu’il est, Gray présente son sujet de manière frontale, plus prosaïque. Ce qui marche parfaitement dans une situation avec divers personnages parce qu’on peut jouer sur les choses qu’on cache, qu’on se dit et qu’on ne comprend pas, qu’on voudrait entendre, qu’on dit à une personne quand on devrait les dire à une autre… Mais quand on est dans une situation qui n’en est pas une, à savoir un type posé dans un coin qui balance au spectateur ses pensées intimes, ça ne marche plus. D’ailleurs, on voit les difficultés rencontrées par James Gray pour mettre en scène, en situation, ces temps de pause et de monologue : il trouve comme astuce le passage obligé de l’évaluation psychologique, mais il y a recours bien trop souvent (c’est aussi une situation statique qui n’offre pas beaucoup d’opportunités visuelles et matérielles : Brad Pitt fout un capteur sur sa carotide, gros plan, blabla, et rien d’autre).

Un des rares jolis plans du film
L’occasion pour moi d’évoquer brièvement la réalisation de James Gray. Même si on sent le cinéaste assez peu concerné par les scènes d’action, c’est encore ce qui est le plus réussi dans son film. La première séquence sur le chantier de l’ascenseur spatial trouve son intérêt par sa seule valeur illustrative : celle de montrer à quoi pourrait ressembler une telle superstructure actuellement théorique. Et par la force des choses, les scènes d’action chahutant souvent une situation à une autre, d’un décor à un autre, d’une action à une autre, Gray se trouve comme obligé pour le coup de suivre la logique de son récit et d’adopter une mise en scène, toujours sobre, réussie, même si c’est évidemment effectué sans génie. Dès que la situation n’impose plus de mouvement, tout devient alors statique et aucune astuce convaincante ne permet d’échapper, parfois même avec un seul personnage présent, aux ronflants champs-contrechamps (bien que seul, le personnage solitaire peut interagir avec des écrans — pas franchement ce qu’il y a de plus « cinégénique »). Aux scènes d’action se succèdent donc les autres d’introspection (de rares dialogues), et le film s’appesantit sans que Gray n’arrive jamais à y insuffler le moindre rythme ou intensité. Ce qui ne serait pas un problème si Gray arrivait à y instiller de la profondeur, que ce soit à travers les mots de son personnage ou par le biais d’une quelconque illustration capable de nous plonger dans son environnement immédiat ou psychologique (ce qu’il fait rarement — et mal — en s’aidant des possibilités offertes par le montage, les sons, la musique ou divers éléments de décor).
Qu’est-ce qui fait d’ailleurs qu’on se sente peu concernés par cette introspection ? On entre en empathie au cinéma ou ailleurs quand on prend le temps au moins d’une présentation : on place le personnage dans une situation, un conflit introductif, et la manière de s’en sortir doit, d’ores et déjà, nous montrer les qualités à venir du personnage et les potentielles failles qui le freineront dans son futur parcours. Autant de clés pour la suite du récit. C’est sans doute ce qu’a essayé de faire Gray à travers cette séquence d’ascenseur spatial. Seulement, bien que catastrophique, cette séquence n’aide pas à en apprendre beaucoup plus sur le personnage qu’elle est censée introduire : Roy McBride se laisse littéralement tomber et ne peut guère y changer grand-chose. En plus, il vit seul cet épisode (qu’on pourrait espérer) traumatisant, et n’a donc pas à composer avec d’autres personnages susceptibles de l’aider, le conforter dans ses choix ou au contraire s’opposer à lui (un avant-goût certes de ce qui suivra, mais justement, ça n’aide pas). Il s’en tire comme par miracle (ça deviendra une habitude) — une chance à peine croyable qui aurait plutôt tendance à attirer l’antipathie du spectateur, et surtout qui ne sert pas réellement de tremplin ou de pas de tir pour initier la trajectoire à venir du personnage : les conséquences logiques et psychologiques de cet événement sont vite balayées quand il est reçu par on ne sait quels responsables qui prennent prétexte d’un briefing post-traumatique pour lui proposer une mission secrète… (exemple parfait de deux « séquences à faire » composées grossièrement avec un rapport de cause à effet douteux). Autre problème, si on commence en mode introspection, cela signifie qu’on traînera du début à la fin cette même humeur impassible. Difficile de s’identifier à un personnage qui n’évolue pas, est confronté à assez peu de personnages extérieurs (et quand c’est le cas, se contente de hocher la tête et de faire ce qu’on lui propose de faire ; non pas qu’il soit docile, mais que chacune de ces obligations ou suggestions arrivent à chaque fois à propos : « je peux aller aux cabinets ? Ça tombe bien je n’avais pas fait depuis trois jours, mais comme je suis impassible, je me retiens sans serrer les dents depuis tout ce temps. Journal intime : j’ai enfin fait caca, je ne disais rien, je suis un héros. ») Gray pourrait toujours dire, et il aurait raison, que dans 2001, les personnages sont assez inconsistants à ce niveau. Mais Gray n’est pas Kubrick. (« Maintenant que j’ai fait caca, je vais pouvoir vous parler de mon papa. »)
Et pourquoi Gray n’est pas Kubrick ? Eh bien, en dehors des nombreuses raisons évoquées ici (dont la principale, que Gray avancerait certainement pour sa défense : il ne cherche pas à l’être), il y en a encore une qui m’a chiffonné tout le film. J’ai déjà dit que Gray avait un sens assez limité (un intérêt même) des artifices techniques, visuels, esthétiques… Pour de la science-fiction, Gray situerait volontiers, je suppose, son style dans le réalisme. Son film ne me semble pas être pour autant de la hard SF, de nombreux épisodes étant particulièrement improbables (celui où son personnage joue les surfeurs d’argent au milieu des anneaux de Neptune afin de retrouver son vaisseau laissé à des milliers de kilomètres de là est peut-être celui qui m’a laissé le plus perplexe), pourtant il semblerait que, même situé dans un avenir dont il est dit qu’il n’est pas si lointain (mais dont on sait qu’il y a déjà une génération née sur Mars…), il ait voulu éviter les décors au design trop travaillé, favorisant ainsi les décors fonctionnels supposément plus réalistes. Un choix intéressant, même considérant le fait qu’on se trouve probablement ici aux alentours du prochain siècle, on peut en effet parier que le matériel employé sera assez peu différent et toujours aussi fonctionnel. Pour résumer mon impression : c’est foutrement laid. Il n’y a pas un habitacle de vaisseau qui diffère d’un autre : tous les modules sont interchangeables, les cloisons identiques, les portes et sas sans fantaisie aucune… Bref, c’est loin d’être un plaisir pour les yeux (et on est à des années-lumière de Kubrick — je voudrais l’écrire en tout petit). La dernière chose encore qui puisse fasciner, et émouvoir par sa beauté, est encore ce qu’il y a de plus banal dans le monde : une vue en hauteur de notre magnifique planète. Une consolation rare dans une constellation de tiroirs en plastique et d’armatures en acier. Oui, l’aspect esthétique dans un tel film, ça joue.

Ad Astra, James Gray (2019) | New Regency Productions, Bona Film Group, CAA Media Finance
Pour reprendre ce que dit Edgar Morin du film (oui, le grand cinéphile), c’est vrai qu’il faut reconnaître que là où beaucoup de space operas vont taper à la porte de nos amis imaginaires en suggérant (ou espérant) que des ET puissent y répondre, Ad Astra propose au contraire de souligner le fait qu’on a beau taper à la porte, envoyer des signaux, chercher, espérer, on n’y voit et n’y entend goutte : le vide spatial ne nous renvoie inlassablement que le signe de notre solitude. Magnifique idée, c’est vrai, conforme au réalisme du Gray, soucieux peut-être de rester les pieds sur terre et fidèle à ce que dit la science aujourd’hui sur les possibilités d’une rencontre de ce type. Toutefois, les bonnes idées ne font pas les bons films. Ses références de départ, aussi, n’étaient peut-être pas les bonnes : 2001 et Apocalypse Now sont peut-être réalistes dans la reproduction des mondes qu’ils décrivent, ils portent en eux des aspirations fascinantes qui les amènent bien au-delà de simples faits ou constats retranscrits froidement. L’erreur a peut-être été de mêler là encore deux choses qui ne s’y prêtaient pas pour James Gray : le constat de l’absence d’altérité à l’intelligence humaine dans le cosmos, s’il peut en effet être déprimant, n’a surtout en fait pas beaucoup de liens avec le sujet récurrent et moteur du film, la recherche du père (c’est même le contraire : le père pour un fils, c’est le premier « autre » qu’il apprend à connaître).
Au chapitre des incohérences, je me dois de soulever quelques interrogations (auxquelles je n’ai pas forcément de réponses) qui y sont aussi pour quelque chose dans la pénibilité ressentie tout au long du film. Est-il crédible que depuis une génération, Mars soit colonisée, mais que dès qu’on dépasse la ceinture d’astéroïde, le Système solaire externe avec ses géantes gazeuses semble pratiquement être abandonné des colons ? (Ça donnerait presque l’impression que le système jovien et le système neptunien sont des mondes vides et inintéressants, voire inaccessibles — ce n’est ni le cas aujourd’hui, même si bien plus difficile que pour les objets du Système solaire interne, ni dans le film puisqu’il suffit de quelques jours pour faire le chemin inverse vers la Terre.) Est-il crédible de sortir de sa trajectoire comme ils le font avant d’arriver sur Mars pour aider un vaisseau en détresse ? (Un vaisseau spatial, ce n’est pas une barque qu’on peut dévier à loisir ou une voiture à laquelle on peut faire un créneau ou arrêter à un stop.) Des rayons cosmiques sur Terre émanant d’explosions d’antimatière issues elles-mêmes de bombes nucléaires présentes sur un vaisseau d’exploration à la dérive dans la région de Neptune et dont l’explosion complète permettra de rejoindre la Terre ?! Heu, rien capté. Sur Mars, quel est donc ce canal souterrain qui permet à Roy McBride de se faufiler jusqu’au lanceur sur son pas de tir ? (Un peu facile, non ? Besoin d’un passage souterrain pour réunir dramatiquement un point a à un point b : j’en fous un sans avoir à expliquer son utilité diégétique.) Voilà pour les quelques interrogations scientifiques. Pour les autres incohérences dramatiques, ce serait trop fastidieux de les énumérer et de les retrouver dans ma mémoire défaillante sans avoir fait caca…
Le rythme cardiaque de mon cher Jimmy peut redescendre : le tableau n’est pas si noir. Dans l’obscurité des salles de cinéma…, tous les navets sont gris. (Rires complices de singes de laboratoire.) J’entrevois une bonne nouvelle avec Ad Astra : la possibilité pour des cinéastes sans grands moyens de s’emparer du genre SF sans avoir à passer par des effets spéciaux ridicules. Ad Astra en somme pourrait être l’avènement de la science-fiction, ou plus précisément du space opera, low-tech. Pendant longtemps, alors que pour adapter un roman noir il suffisait d’un chapeau, d’un pardessus et d’un peu de pluie, les mêmes artifices pour adapter Arthur C. Clarke ou Frank Herbert coûtaient un bras : le vide sidéral n’est pas à la portée de toutes les bourses. Eh bien, maintenant, à une époque où parallèlement le secteur du spatial voit arriver chaque jour de nouveaux acteurs issus du privé et où, par conséquent, l’accès à l’espace se démocratise, on peut pareillement être crédible au cinéma quand on a peu de moyens et qu’on souhaite mettre en images une épopée spatiale. Tout le monde peut s’emparer de cette nouvelle possibilité : la télévision l’avait fait depuis longtemps en renvoyant au garage Cosmos 1999 ou Star Trek, c’est peut-être au tour maintenant des cinéastes dits indépendants. Pas de mouvements de vaisseaux spatiaux compliqués à faire numériquement, des décors de modules spatiaux répliqués sur les catalogues Ikea du secteur du spatial, un fond vert racheté à un youtubeur, et le tour est joué. Manque plus qu’à trouver des sujets, à adapter toute une littérature hard SF/space opera, déjà existante. Et peut-être verrons-nous alors bientôt des films comme Moon (voire Seul sur Mars en moins dispendieux et en plus space opera) mis en orbite chaque mois. Si Ad Astra ouvre la voie, même avec une constellation de demi-réussite, c’est la SF entière qui y gagnerait. Assurément alors, d’autres grands films verront le jour, et de plus en plus de cinéastes souhaitant se frotter au space opera parviendront à s’affranchir de l’attraction kubrickienne et de son 2001 : L’Odyssée de l’espace.