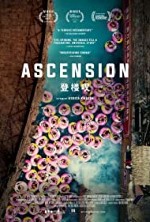Premiers films
Le Jour où le cochon est tombé dans le puits

Année : 1996
Le Pouvoir de la province de Kangwon

Année : 1998
La Vierge mise à nu par ses prétendants

Année : 2000
Premières impressions après avoir vu les six premiers films du cinéaste. Un certain attrait pour la structure narrative, les leitmotivs, les histoires croisées amoureuses, les destins capricieux, etc. Tout cela ne serait pas sans trop me déplaire si le fond n’était pas si souvent délaissé au profit de la forme et de ces astuces, habitudes ou obstinations formelles. Le fond, c’est toujours dans un film la qualité de l’histoire proposée. J’admire la forme quand elle se met au service du fond… Et que cela paraisse étrange ou non, bien qu’ayant vu ces six premiers films dans un ordre aléatoire, mes notes ne cessent de descendre.
Ainsi, dans son meilleur film vu jusqu’à présent (et son premier), Le Jour où le cochon est tombé dans le puits, j’ai trouvé le jeu à quatre et en parallèle parfaitement exécuté. Le récit en forme de jeu de l’oie ou de jeu des sept erreurs permet des retours en arrière ou des perspectives différentes adoptées à partir d’un même événement, cela crée une certaine tension jusqu’à l’accomplissement final et relance en permanence la curiosité, ce qui au bout du compte sert au mieux l’histoire.
Le Pouvoir de la province de Kangwon joue sur les mêmes ressorts formels, mais la nature des fils narratifs révélés petit à petit, leur nombre, et surtout leur intérêt général, tout ça perd un peu par rapport au précédent film : les astuces formelles sont toujours là, mais le type de relations proposées et la facilité narrative de départ qui fait croiser deux personnes qui se connaissent dans un même lieu sans se voir (ou quelque chose comme ça) n’aident pas à voir clair dans le récit. Avec ce type de structures, on peut accepter une fois qu’on a compris, une certaine suspension de jugement parce qu’on sait que des éléments seront compris ou évoqués ailleurs, mais il ne faut pas en abuser, et parfois, pour diverses raisons, l’élastique cède, on refuse alors de suspendre son jugement et on demande à sortir de la salle.
La Vierge mise à nu par ses prétendants est peut-être encore plus un jeu de sept erreurs parce que les propositions temporelles revisitées dans le récit font clairement état de différences qui mettent à l’épreuve la cohérence dramatique d’ensemble. Excellente idée de départ, sauf que là encore, si la forme séduit, le sujet qu’elle doit mettre en lumière me paraît, au mieux, un peu trop anodin, au pire, incomplet. On peut bien sûr garder des zones d’ombre dans un film qui joue essentiellement sur des bribes d’événements, mais quand une part de ces séquences ont individuellement peu d’intérêt, on se dit que c’est un peu du temps perdu (le film est long, pourtant il ne laisse pas l’impression que chacune de ces séquences était indispensable — les limites peut-être d’un récit où chaque séquence peut contredire la cohérence dramatique de ce qui précède).

Le Jour où le cochon est tombé dans le puits, Hong Sang-soo 1996 Daijiga umule pajinnal | Dong-a Exports Co. Ltd.
Dernier point qui me semble affecter la qualité de ce que le spectateur perçoit, c’est l’interprétation et le choix des acteurs (sinon parfois, le choix même du cinéaste à choisir telle ou telle activité pour un personnage : dans ce registre, on aurait presque l’impression que le cinéaste revendique son minimalisme et la répétition des types de lieux ou activités proposés). Hong Sang-soo fait dans l’incommunicabilité, là encore, cela a de quoi me séduire… et de quoi me lasser quand c’est mal fait. Certains acteurs ne sont pas à l’aise avec cette forme d’interprétation : ils manquent de spontanéité, de créativité (pierre angulaire de l’improvisation) et se perdent parfois dans des silences qui au lieu d’être dans le rythme général de l’incommunicabilité (ou de la pesanteur, de la contemplation, peu importe comment on interprète ça) laisseraient plutôt penser qu’on a affaire à des prises ratées. On retrouve l’œil vide des acteurs perdus qui imposent des silences prolongés et qui témoignent plus d’un flottement chez l’acteur que chez le personnage. Dans les films suivants, toutefois, le cinéaste corrige le tir : preuve d’abord que ce rythme trouvé dans ses premiers films n’était pas le fait du hasard (c’est un rythme tellement compliqué à obtenir des acteurs que c’est rarement un hasard), mais signe aussi soit que le choix des acteurs n’était pas le bon, soit qu’Hong Sang-hoo n’obtenait pas d’eux ce qu’il cherchait (ce qui n’est pas loin d’être strictement la même chose, mais je vous laisse avec mes propres jeux des sept erreurs).
Je vais continuer sur ma lancée, mais s’il persiste à raconter des histoires avec des gens du cinéma ou s’il se répète comme c’est déjà pas mal le cas, je vais vite me lasser. Mais il faut parfois insister quand on est spectateur avec les cinéastes qui reproduisent sans cesse le même film parce qu’il arrive que parmi leurs cinquante films (ou essais), par hasard ou non, se cache une perle. Pour Hong Sang-soo, le défi, ce sera donc de voir s’il est parvenu dans la suite de sa filmographie à retrouver la qualité de son premier film, voire à le surpasser… Des cinéastes ayant produit un grand film à leurs débuts qui ne retrouveront jamais la même efficacité, ou la même fraîcheur, ce ne serait pas un cas isolé. Soyons optimistes (mais prudents).
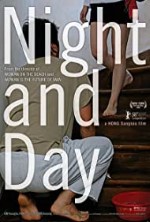
Jamais trois sans quatre.
J’avais des raisons d’être méfiant. Night and Day (2008)
Tout ce qui chez le réalisateur m’indiffère (et manifestement des points sur lesquels il insistera de plus en plus après ses premiers films) : des histoires de cul chez des artistes. Tellement français. Le film a en plus le mauvais goût ici de mettre un seul homme au milieu de plusieurs femmes. Le côté plus choral et la parité des rôles de ses précédents films lui réussissaient mieux à mon sens. Surtout que les femmes qui tournent autour du personnage principal sont assez médiocres (à l’exception, peut-être, de l’élève des Beaux-Arts qu’il retrouve dans son rêve). La performance des actrices n’aide pas beaucoup. L’acteur qui joue le peintre, lui, s’en sort plutôt bien, parce que sans lui, il faut bien reconnaître que le film aurait totalement manqué du seul charme qu’on peut lui reconnaître : l’humour. Ça donne un côté Bruno Dumont appréciable au style habituel d’Hong Sang-soo. Pour le reste, on oublie les structures alambiquées, les leitmotivs, les plantings. Deux ou trois choses pour révéler une ou deux informations, mais ça ne va pas plus loin. Ça me manquerait presque…
(J’avais vu trois des autres films des années 2000 bien avant, c’est pourquoi je suis directement passé à Night and Day.)
La suite aux prochains numéros.
Concernant Le Jour où le cochon est tombé dans le puits :
Listes sur IMDb :
Liens externes :