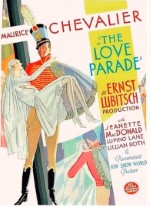Nous et nos montagnes
Titre original : Մենք ենք, մեր սարերը / Menq enq mer sarery
Année : 1969
Réalisation : Henrik Malyan
Avec : Sos Sargsyan, Frunzik Mkrtchyan, Khoren Abrahamyan, Armen Ayvazyan, Artavazd Peleshian, Azat Sherents
Henrik Malyan met de côté les formes expérimentales et esthétiques de ses collègues du Caucase pour adapter ce qui semble être un chef-d’œuvre de la littérature contemporaine arménienne. L’auteur, Hrant Matevossian, s’est chargé lui-même de l’adaptation de la nouvelle qui semble l’avoir fait connaître, publiée en 1962 selon la page française de Wikipédia — 1967, pour le recueil de nouvelles selon la page anglaise de l’encyclopédie en ligne. Malyan est passé par une école de théâtre et de cinéma à Moscou avant, semble-t-il (toujours selon ma source du pauvre), de prendre la direction de divers théâtres en Arménie.
La Russie a inventé le jeu moderne, et ses acteurs ont tout au long du vingtième siècle suivi les principes du jeu intériorisé et psychologique qui s’exportera jusqu’à New York avec l’Actors Studio. C’est précisément le type de jeu que l’on voit ici. En plus d’être la meilleure méthode pour mettre en évidence une histoire, elle a surtout l’avantage de paraître naturelle et de proposer deux niveaux d’interprétations simultanées. Elle distingue la part dramatique de la fable suivant le fil des événements (souvent rapportée à travers les dialogues), de la part illustrative, qui consiste à mettre en scène les personnages dans des activités annexes. Ces deux niveaux se manifestent généralement dans notre activité du quotidien : nous sommes capables de parler d’un sujet sans rapport avec ce que nous faisons, et quand l’on s’arrête (temporairement ou non), cela souligne le fait que la situation a gagné en gravité. Une fois mise au service d’un récit, ce principe a la vertu de pouvoir jouer en permanence sur les deux tableaux et de porter à la connaissance du spectateur un contexte naturaliste et sociologique d’envergure (même si Marlon Brando en conclura qu’un acteur doit se gratter les fesses pour paraître « naturel »).
Voilà pour la forme d’apparence classique. Sa mécanique repose d’ailleurs sur une sophistication bien plus élaborée qu’elle en a l’air. Si les audaces et les étrangetés « brechtiennes » d’approches plus visibles et plus distanciées à la Sergueï Paradjanov ou à la Tenguiz Abouladze sont plus adaptées aux histoires traditionnelles et folkloriques (voire baroques), pour servir une fable moderne et absurde, la forme classique et naturaliste paraît plus appropriée.
Sur le fond, l’histoire de Hrant Matevossian rencontre énormément de similitudes avec les récits postérieurs de ses voisins iraniens. Pour éviter la censure et le risque de se voir suspectés d’offrir au spectateur une critique de la société dans laquelle ils vivent, les réalisateurs iraniens passeront volontiers par la fable (mettant en scène bien souvent des enfants). Dans ces films produits sous dictature, les auteurs arrivent toujours à faire preuve d’une puissante subtilité allégorique ou thématique qui mènera forcément à l’universalisme, car les exemples trop spécifiques pourraient heurter le pouvoir en évoquant des contextes domestiques. Et cela, en se pliant aux exigences d’une représentation policée de l’autorité : un gendarme se doit d’être un modèle de droiture, de fermeté, mais aussi d’humanité… La fable tire vers l’universel, ce qui lui permet d’échapper aux contextes sociaux ou politiques. Au contraire du théâtre italien, par exemple, dans lequel les archétypes sociaux dominent, dans la fable, les personnages ont une fonction qui les extrait de leur particularisme comme dans la mythologie ou les légendes. Peu importe que les bergers soient ici cultivés, cela reste un détail, et un détail d’ailleurs assez en phase avec un idéal soviétique d’éducation pour tous (ou de labeur pour tous) : il convient en revanche que les héros appartiennent à un type de personnages universels. Et quoi de plus universel que des bergers ?

Ensuite, comme dans n’importe quel mythe, chacun des bergers représente une manière distincte d’appréhender les choses. La fable offre toujours au lecteur un sens moral aux événements : les caractères et les réactions différentes des bergers face au gendarme qui les interroge sont censés viser une forme d’exhaustivité. Les personnages adoptent chacun une stratégie opposée et complémentaire. La fable use alors de la répétition pour les interrogatoires comme dans Les Trois Petits Cochons ou dans Le Petit Chaperon rouge. Dans une sorte de Kafka rural, le style tire vers l’absurde, mais la structure du récit s’appuie sur une mécanique mythologique et morale. L’absurdité naît des pinaillages et des réticences de chacun à vouloir élucider ou masquer les détails d’un événement dont la logique traditionnelle s’oppose à la rationalité et à la temporalité du droit au sein d’une société dans laquelle tout acte, tout accord, toute vente est transposé à l’écrit avant de pouvoir être consulté et vérifié : vous payez, vous vendez, les registres sont comptables de la moindre de vos transactions passées. Comment une société rurale étrangère à ces usages donnera-t-elle la preuve d’un accord tacite ? La réponse sera d’autant plus incertaine que l’on n’est pas sûrs qu’un tel accord existe. Le berger lésé, lui, reste vague sur ses allégations, et les accusés peuvent se jouer d’un gendarme quelque peu pointilleux sur les principes du droit en interprétant à son intention une sorte de remake parodique de Rashômon. Qui vole un mouton finit petit-bourgeois et digne du goulag… Ou pas, si tu tournes bien la chose…
Comme dans toutes ces fables qui opposent la ruralité à la modernité (dont les caractéristiques sont partagées avec certains westerns et donc avec certains films iraniens), l’espace reflète cette opposition. L’environnement commun est celui de la nature domestiquée par l’homme, mais sur laquelle la civilisation n’a pas encore tout à fait la main. Si le gendarme peut interroger les suspects à son poste de police, il paraît bien seul pour mener son enquête, et il apparaît surtout comme l’unique représentant non seulement de la loi, mais de l’« empire » comme son usage intempestif du russe pour marquer son autorité le rappelle. Et alors, une fois l’enquête terminée, que fera-t-il ? Il « transhumera » avec les accusés et le plaignant vers la ville et son tribunal. On retourne presque au temps des mythes grecs quand les héros « transhumaient » d’une cité à l’autre. Ces « odyssées » (souvent pédestres) occasionnaient des rencontres néfastes prévues par les oracles, des expériences initiatiques ou révélatrices. Œdipe tuera son père sur un tel chemin alors qu’il croyait précisément l’épargner en s’éloignant de lui. Ici, en guise de Sphinx et de conclusion au film, cette joyeuse troupe de personnages ralliant la ville croisera d’autres bergers à qui ils « révéleront » à voix haute et de façon répétée leur méfait (comme un plaider-coupable adressé au seul tribunal auquel ils se soumettent : les collines de leur pays). (Preuve du caractère universel du genre, ce recours aux « mythes des itinérances » se retrouve tout aussi bien dans les récits traditionnels japonais — les jidaigekis de Kenji Misumi par exemple — que dans les road movies du Nouvel Hollywood.)
Avant ce geste tout à la fois loufoque et symbolique, le film contient toutes sortes de détails amusants et tout aussi parlants. Le gendarme, d’ordinaire si soucieux de rendre le droit dans une campagne qui semble s’affranchir de toutes contrariétés légales, traverse un verger en chapardant un fruit sur son arbre. Son entrain à finir ses bouchées marque bien l’idée qu’il a conscience d’agir en contradiction avec ses principes : « qui vole une pomme, vole un mouton, qui vole un mouton, vole un œuf (non, ce n’est pas ça) ». Volontaire ou non, le vol prend un caractère autrement plus symbolique, de nombreux fruits étant originaires du Caucase (sorte de trésor national). Mais le gendarme échappera aux pépins, lui.
Enfin, lors d’un simulacre de tribunal que les bergers et le gendarme organisent le temps d’une halte dans les collines rocailleuses pendant leur voyage vers la ville, chacun se prête au jeu et intervertit les rôles sans amoindrir ses responsabilités. Jusque-là, Hrant Matevossian s’était contenté de citer Shakespeare. Avec ces inversions des rôles, ces travestissements censés dévoiler la véritable nature des personnages, on est en plein dedans. L’absurdité et la critique du droit rejoignent celle par exemple du Marchand de Venise (l’excès des conditions posées par Shylock, le travestissement à des fins révélatoires et la parodie de procès). Rarement le cinéma aura aussi bien illustré l’idée d’intelligence empathique : la capacité à se mettre à la place de l’autre.
Quelques notes de musique au début rappellent Nino Rota. Et à travers ses alpages pleins de rocailles, d’herbes et de ruisseaux, le style du film évoque parfois le cinéma italien. Pâques sanglantes, par exemple. Le monde caucasien n’a pas l’air si différent du monde méditerranéen. L’air commun des latitudes, peut-être, des mythes partagés depuis des millénaires aussi…
Nous et nos montagnes, Henrik Malyan (1969) Մենք ենք, մեր սարերը We and Our Mountains | Armenfilm
Sur La Saveur des goûts amers :
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant
Ou saisissez un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel