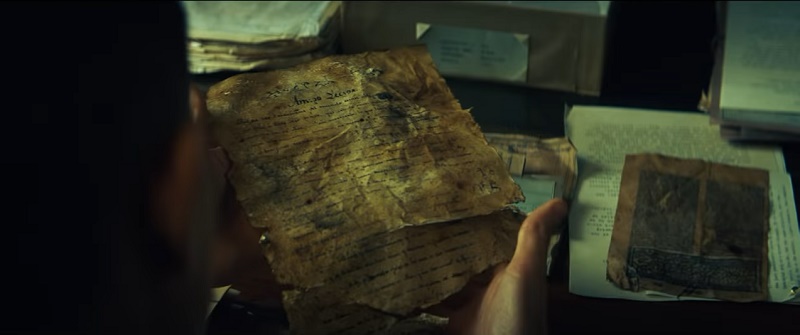Code Haynes: Therese and The Carolarchate

Carol
Année : 2015
Réalisation : Todd Haynes
Avec : Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson, Kyle Chandler
Ce qu’il y a de pénible parfois avec certains films hollywoodiens, c’est leur manière bien convenue de suivre les évolutions de la société toujours avec un temps de retard ; ou pire, en essayant de se conformer le plus possible aux codes politiquement corrects du moment, c’est cette manie d’épouser en retour un certain nombre de stéréotypes et de préjugés. Au lieu d’être un cinéma de la subversion, comme ses auteurs voudraient probablement le laisser penser, ce cinéma-là devient en fait le porte-étendard du conservatisme et de la bonne conscience d’une certaine élite. Les libéraux (de gauche) aussi ont leur petit conservatisme à Hollywood. La gauche caviar, on dirait en France.
Quand ce n’est pas sur le racisme que Hollywood se vautre magistralement, c’est sur l’homosexualité. Rien de mieux pour traiter ces sujets autrefois délicats et pourtant encore d’actualité qu’une bonne histoire de jadis. Vous allez voir combien on est subversifs en évoquant des mœurs d’une autre époque en soignant décors et costumes !
Et le résultat est souvent le même. En cherchant à normaliser ce qui fâche (plus grand monde en dehors des habituels réactionnaires), on oublie la nuance (ce qui est pourtant la base de toute représentation juste du monde), et l’on multiplie les clichés en ne manquant pas d’enfoncer en beauté les portes ouvertes.
Aucune idée de ce qu’avait pu en faire Patricia Highsmith dans son histoire originale (qui n’a rien d’un polar), mais en lisant le résumé, une maladresse amusante saute aux yeux. Nous sommes donc au début des années 50, Thérèse travaille dans un grand magasin au rayon jouets à l’approche de Noël. C’est là qu’elle rencontre Carol, une cliente fortunée qui cherche un cadeau pour sa fille. Pour Patricia Highsmith, Carol repart avec une poupée du magasin. Ça ne devait pas être jugé assez gay friendly pour Todd Haynes et son adaptatrice, alors pour se conformer à l’air du temps, ils changent (maladroitement, parce que ce troc n’a aucun intérêt dramatique) la poupée pour un train électrique. Là, il y a quelque chose qui m’échappe : si l’on adapte un roman, on en respecte au moins l’esprit, surtout si l’on estime que c’est précisément cet esprit, subversif pour l’époque, qui doit être rendu à notre époque. Pourquoi s’évertuer à adapter ce détail ? Autant écrire un scénario original…
Bref, le problème est ailleurs. Todd Haynes troque la relation hétérosexuelle d’un drame romantique classique pour une autre homosexuelle, mais ce faisant, conserve dans son schéma narratif de romance classique toute une flopée de stéréotypes de couple qui n’aide en rien à concevoir la relation exposée comme saine. Parce que c’est bien joli de chercher à illustrer la normalité d’un couple homosexuel, si c’est au contraire pour exposer ce qu’on peut trouver de malsain dans certains rapports amoureux hétérosexuels, ce n’est pas vraiment donner une bonne image de l’homosexualité féminine. Le sujet serait précisément le caractère malsain de cette relation, pourquoi pas : les homosexuels ont tout autant « droit » d’avoir des relations malsaines que les hétérosexuels. Sauf que ce n’est pas du tout le sujet du film, et que, précisément, ce malaise ne semble pas imputable à l’œuvre originale (du moins, de ce qu’on peut en comprendre à travers les seuls événements), mais bien à la manière de présenter les choses, les rapports amoureux, homosexuels donc, entre ces deux femmes.
On croirait presque voir un conservateur approuver du bout des lèvres le mariage gay… Ce n’est pas tout de le dire, derrière la posture, encore faut-il être sincère et convaincu par ce qu’on finit par admettre. Et j’ai du mal à penser que Haynes et ses actrices, en allant ainsi vers des caricatures (non plus en rapport au genre, mais au statut social), œuvrent sincèrement pour ce qu’ils prétendent faire. L’opposition entre les deux femmes est bien trop caricaturale pour être honnête et perçue comme saine et naturelle. Procès d’intention peut-être de ma part, mais je ne peux concevoir que tant de clichés puissent servir et illustrer la normalisation de mœurs autrefois rejetées. À qui s’adresse le film ? Non pas à des conservateurs qui seraient, encore à notre époque, outragés par des amours homosexuelles, mais à un petit cercle d’intellectuels du cinéma qu’on brosse dans le sens du poil. Encore une fois, pourquoi doit-on toujours passer dans ce genre d’histoires par une forme puissamment néoclassique entourant le film de tant d’artifice qu’il empêche son sujet de respirer et de dire quelque chose de notre époque ? Pourquoi les histoires d’« homos » et de « Noirs » devraient-elles toujours être celles de nos grands-pères ou de nos arrière-grands-pères ? Le racisme a-t-il disparu, l’homophobie n’est-il plus d’actualité ?
Ce qui me choque le plus dans le film, c’est donc la nature de la relation entre les deux femmes. Telle que présentée par Todd Haynes et ses interprètes, cette relation n’a rien de sain. Non pas parce qu’elle concerne deux femmes, mais parce qu’elle implique un rapport de domination fortement déséquilibré. Et puisque ce déséquilibre tend plus à s’accentuer qu’à se réduire au fil du récit, j’en viens personnellement, et logiquement, à penser qu’il ne pose aucun problème à Haynes. D’un autre côté, on louera le film pour ses efforts à mettre en scène les amours interdites entre deux femmes. Mais hé oh, non ! Qu’importe qu’on ait affaire à des hétérosexuels ou à des homosexuels : une relation prétendument amoureuse basée sur un rapport de domination ne peut être que malsaine. On peut s’évertuer à pointer du doigt les privilèges dont profitent les hommes dans leur relation avec les femmes, si l’on trouve parfaitement normal de trouver exactement le même type de relations malsaines basées sur la domination de l’un sur l’autre dans un couple homosexuel, c’est bien qu’on n’a rien compris au problème des inégalités tant au niveau des privilèges dont jouissent les hommes sur les femmes dans notre société qu’au niveau du regard porté sur les couples du même sexe. Une relation à l’autre, a fortiori dans une relation amoureuse, le principe, c’est l’harmonie, le respect mutuel, l’assistance, la compréhension et l’écoute de l’autre, l’égalité… Une femme qui en domine une autre, socialement, psychologiquement, et qui fait passer ses intérêts, ses désirs, avant ceux de son amoureuse, moi ça me choque. Pourquoi ? Parce qu’un individu qui fait jouer sa supériorité sur un autre, qui conditionne l’existence de l’autre à ses seuls valeurs et désirs, que ces individus soient des hommes ou des femmes ne change rien au fait que c’est bien le principe, et non le sexe, qui rend ce rapport de domination difficile à supporter.
De quelle domination parle-t-on dans Carol ? D’abord, une domination liée à l’âge qui conditionne, semble-t-il, beaucoup le jeu des actrices (on peut avoir un grand écart d’âge entre deux personnages, rien n’indique que cela soit la cause d’une domination du plus âgé sur son cadet). Todd Haynes insiste même sur ce point. Le cliché du personnage mûr influençant un autre plus candide qui trouvera forcément un intérêt à suivre les conseils avisés de son aîné… Cela pourrait participer à illustrer un amour naissant sauf que ce rapport, presque de nature initiatique, ne débouche que sur des caprices du plus âgé. Il joue ainsi de sa domination/supériorité sur l’autre, ne cherche pas du tout un partage réel des idées, une remise en question de la tutelle exercée ou une sensualité dans laquelle ce rapport de domination s’effacerait peu à peu naturellement.

Pour croire en une telle idylle (ou y adhérer), il aurait fallu lisser un peu ce rapport de domination dans lequel un des deux personnages semble jouer en permanence de cette supériorité d’âge sur l’autre. Or, jamais on ne sort du cliché : jamais la cadette n’aura de conseils ou de remarques à adresser à son amoureuse ni même contestera sa prétendue maturité, bref sa « supériorité ». Sans que cela pose problème, le fait que le personnage plus âgé domine l’autre est donc présenté comme un rapport tout ce qu’il y a de plus normal. L’un domine, l’autre subit.
Le plus problématique est ailleurs. Le rapport qui conditionne toute la relation entre Carol et Thérèse, c’est un rapport de classe sociale. Là encore, rien ne présuppose que deux personnages avec une telle différence de milieu ne puissent développer des rapports sains et égaux. Ce serait même intéressant à mettre en scène : lutter contre un autre préjugé, celui de croire que rares seraient ceux qui arrivent à s’émanciper de leur milieu pour construire une relation parfaitement égalitaire. Sauf que les actrices et Haynes insistent sur cette différence en permanence. Tout y ramène, et un tel déséquilibre met mal à l’aise.
En fait, pour se rendre compte du piège des stéréotypes dans lequel Haynes et ses interprètes semblent être tombés, il faudrait extrapoler un peu et changer le rôle de Carol pour un autre masculin. On verrait alors à quel point ces déséquilibres et ces rapports de force, au sein de ce qu’on nous présente comme un couple « comme les autres », posent problème. Quand un tel rapport de domination s’installe au sein d’un couple, c’est peut-être perçu par certains comme de l’amour, mais ce n’est en tout cas pas un amour sain. Si ça ne l’est pas quand c’est un homme qui joue de sa domination sur une femme, ça ne l’est pas plus quand c’est une femme qui joue de sa domination sur une autre femme.
L’impression laissée au final par cette tendance à exposer un personnage privilégié exerçant sa domination sur un autre censé être dominé sans même que l’idée chez cet autre fasse en lui jaillir une saine envie de révolte, c’était grosso modo la même que j’avais éprouvée avec A Single Man. On jouait beaucoup moins sur cette domination sociale et d’âge, mais c’était tout de même présent, et cela nous était présenté comme normal, voire distingué. Or, j’ai du mal à concevoir comme « normale » une relation amoureuse si elle repose sur un rapport de domination dont jouent tout aussi bien l’un et l’autre (le personnage dominé, dans ce cas, s’il accepte toujours bien volontiers sa soumission, tient plus du vulgaire fantasme pour celui qui l’imagine — je ne peux pas imaginer que cela produise autre chose que des troubles et des névroses chez l’individu ainsi soumis, et les nier, c’est se représenter des personnages tels qu’on voudrait qu’il soit, autrement dit des objets soumis à nos désirs, non des personnages avec une psychologie propre).

Si le but du film était d’illustrer ce qu’est un amour homosexuel, Haynes semble tout à coup oublier ce qu’est l’amour. Se mettre au niveau de l’autre, se détourner de son milieu social, de son âge, de sa culture, et se retrouver dans les yeux de l’autre, au-delà des apparences et des stéréotypes. Des regards furtifs puis appuyés (il n’y en aura qu’un, lors du plan final, que la musique omniprésente rendra inoffensif), de la timidité partagée parce que l’autre nous impressionne et nous attire, une connivence au-delà des mots, des convenances, des sourires partagés, et surtout de la sensualité, la recherche très vite du corps de l’autre…
Tout ça n’est pas le propre de l’hétérosexualité. Or, il semblerait que l’homosexualité qu’on nous présente ici soit dépourvue de toutes ces choses évidentes qui définissent l’amour, l’attirance sentimentale et sexuelle. Un regard libidineux d’une femme envers une autre qu’elle convoite parce que susceptible de se laisser dominer par elle n’est pas plus moralement convenable parce qu’elle est une femme et parce qu’il faudrait accepter toutes les formes d’amours entre personnes du même sexe : ça reste l’approche d’un dominant sur un autre qu’il considère comme un être inférieur, et dès lors, une proie, un serviteur, un objet. Pas de l’amour.
Et si le sujet n’est pas l’amour, mais la domination d’une femme sur une autre (pourquoi cette relation, présentée dans les faits comme sincères, porterait-elle tant préjudice à Carol pour la garde de sa fille si c’était le cas ?), comment expliquer qu’il y ait si peu de confrontations et de désaccords entre les deux femmes ? Non, la domination n’est pas le sujet du film, ce n’est qu’une caractéristique de la relation entre les deux femmes, et si elle n’évolue pas et n’est pas sujette à controverse entre les deux femmes, c’est que le sujet est ailleurs (les conséquences de cette relation sur le parcours des deux femmes).
Comment ce rapport de domination permanent, assumé et stéréotypé prend-il forme ? Carol prend l’initiative d’une rencontre, offre des cadeaux à Thérèse, se montre capricieuse, prodigue des conseils à sa cadette, est toujours pleine de certitude, et quand elles commencent à avoir un peu d’intimité, c’est toujours elle qui domine (physiquement et psychologiquement) et qui prend l’initiative. De son côté, Thérèse est une petite nature docile, peu confiante dans la vie, soumise, voire aliénée, que ce soit dans son travail ou dans son rapport aux autres (en particulier avec l’homme qui la convoite et à qui elle a du mal à dire clairement non), et rêve de photographie, mais n’ose pas se lancer, etc. Autant d’éléments susceptibles d’opposer l’une et l’autre dans un seul registre : celui de la domination de l’une sur l’autre.
Et la faute à Todd Haynes. Parce qu’en réalité, je suis persuadé qu’en lissant les stéréotypes de classe et d’âge, en évitant de faire jouer aux actrices le premier degré, bref en y mettant un peu de nuances, on aurait pu croire et adhérer à une telle relation amoureuse et se concentrer sur le réel sujet du film (les conséquences de leur relation). Choisir Cate Blanchett pour le personnage de Carol était, de loin, la plus mauvaise idée possible à mon avis. Parce que si on la voit souvent jouer ce genre de personnages, ses manières m’ont toujours semblé trop grossières pour pouvoir être crédibles en femme du monde. Les personnes de classes élevées jouent sur la délicatesse retenue, elles exposent rarement leurs émotions, sont très précautionneuses, voire souvent introverties ou suspicieuses ; et quand elles exploitent des personnes de classes inférieures, elles s’efforceront de laisser apparaître tout le contraire (noblesse oblige, leur supériorité ne peut évidemment pas provenir de l’exploitation des autres). Or Blanchett cabotine comme une fille de nouveaux riches avec leur arrogance bien à elles, pleine de pédanterie, qui n’a qu’un but manifeste : vous faire sentir inférieur à elles. Même principe en choisissant Rooney Mara et en l’empêchant de jouer sur certaines nuances : insister sur la fragilité de Thérèse ne fait qu’aller dans le sens de sa domination. Il aurait été bien plus intéressant de proposer une Carol plus fragile, avec plus d’incertitude, d’hésitation, pour compenser la domination sociale qu’elle exerce déjà naturellement sur Thérèse.
Tout cela pèse lourd quand le récit prend une tournure dramatique et que cette relation antisociale interfère dans la vie du personnage dont le film tire son titre (même là, Carol domine). Un divorce se profile et cette relation compromet les chances de Carol d’obtenir la garde de sa fille. Les stéréotypes se multiplient des deux côtés : les difficultés se profilent pour celle qui a le plus à perdre (celle qui avait déjà tout, une famille, une place dans la société), alors que l’avenir de la dominée semble tirer bénéfice, au moins symboliquement, d’une relation avec sa maîtresse, accréditant par là l’idée (préconçue) qu’un dominé a toujours intérêt à entretenir une relation (malsaine et déséquilibrée) avec un dominant… Pour son propre bien.