Gentille petite chronique qui vaut surtout pour sa peinture nuancée de personnages essentiellement féminins.
Tout repose en fait sur le scénario, c’est d’ailleurs foutrement bavard malgré la lenteur et les… longueurs (d’un film de plus de cinq heures). Son auteur doit apprécier ce qui en a été fait de la part de ses promoteurs français qui, certes peuvent avoir le mérite de programmer (à l’aveugle…, apprend-on) une œuvre sans grande originalité ni réel génie, mais qui s’autorisent surtout son massacre en en faisant une publicité ridicule en rien conforme au film. Quoi qu’il en soit, nouvelle preuve que le cinéma japonais n’a pas grand-chose à proposer depuis des années. C’est en effet très télévisuel (les cinq heures en question sont proposées sous forme d’épisodes), et ç’aurait mérité de ne pas de sortir de ce cadre. Il n’y a rien de particulièrement cinématographique là-dedans.
Le pire des massacres du film étant ce découpage idiot et artificiel qui ne le sert absolument pas. En plus de sortir un slogan débile pour promouvoir le film d’étrange manière (quelque chose comme « le premier serial au cinéma »), les producteurs/distributeurs se permettent de scinder le film en morceaux en leur attribuant des titres gadgets qui n’ont rien à voir avec le sujet et dont on cherche le lien pendant des heures durant (à tort donc). Un poison, on appelle ça. Distillé au choix, soit par des incompétents, soit par des gens malhonnêtes (les mêmes qui en début de programmation nous susurrent à l’oreille que le film est très émouvant et a même fait pleurer le public de divers festivals… ah).
Le jeu est robotique et lourd. Ce n’est pas forcément, et toujours, négatif, en tout cas pour tous les acteurs et toutes les situations. Et ça n’a rien à voir avec la “justesse” des acteurs. Celui qui a le jeu le plus robotique, c’est sans doute celui également qui est le plus juste, le mari biologiste. Malheureusement, son interprétation, et/ou consignes du directeur, vient assez peu nuancer l’écriture du personnage lui-même assez rigide, or la nuance dans l’écriture des personnages c’est ce que j’ai trouvé particulièrement bien réussi dans le film (il y a tout un jeu pour apporter des contradictions entre la manière dont les personnages se définissent eux-mêmes, comment ils sont perçus par les autres, et celle dont ils vont agir ; ça c’est fascinant et bien écrit, apportant donc du relief aux personnages mais aussi en permanence une forme de suspense et d’incertitude quant aux agissements de ces mêmes personnages). Il y a des cinéastes qui réclament à leurs acteurs de jouer de manière robotique, dans le sens inexpressif, parfois pour le meilleur : Antonioni, Bresson, Ozu, parfois Kubrick, ou pour le pire comme chez Rohmer (chez qui on confond incompétence et absence de direction d’acteurs). Ce qui pose surtout problème dans cette gestion des acteurs, c’est le manque d’homogénéité. Quand on a un texte et des personnages aussi bien nuancés, le plus dur c’est de proposer, un style homogène, un même tempo, une même logique, au lieu de donner l’impression de jouer à la lettre tels qu’ils sont définis par l’auteur. Il y a une trop grande différence entre les coups de mou dans l’interprétation (difficile d’être juste avec autant de situations et probablement peu de prises et de possibilités de recommencer) et les réels moments où dans la simplicité les acteurs sont impeccables. (Impression pas mal laissée aussi par les nombreuses séquences dialoguées et mises en scène dans des “cafés” qui font parfois plus penser à des réfectoires d’hôpital. On peut avoir les meilleurs acteurs au monde, si on les met autour d’une table et qu’ils ont tous un maintien de petite fille sage, ça paraîtra toujours froid et sans vie. Peut-être une volonté maladroite du cinéaste à chercher, comme son contemporain Koreeda — sauf quand il dirigeait des mômes —, à faire comme Ozu…) Mais à la différence du jeu chez Ozu, là ça fait ton sur ton : les personnages froids tendent à être interprétés pour souligner cette distance et cette rigidité, tandis que l’infirmière par exemple est sur une tout autre tonalité (par exemple le biologiste, dans les séquences de café, ça ne marche pas parce que ça fait trop : situation statique pour personnage froid et interprétation qui en rajoute… alors que quand il vient dans l’appartement de sa femme et qu’elle lui renverse du thé sur la tête, là, c’est réussi parce qu’il est à contre-jour, assis sur le rebord de la fenêtre dans une position de vulnérabilité ; sa femme elle aussi est à ce moment tout en nuances : toujours aussi aimable, avec ce sourire permanent et doux, mais menteuse).
Dans une chronique, c’est mal foutu d’avoir affaire à tant de situations et de personnages secondaires abandonnés en route (et pas que secondaires, le devenir de l’amie disparue et dont on ne sait rien, laissant ainsi une fin plus qu’ouverte, ça déconcerte un peu trop). Il y aurait eu matière à un bien meilleur film avec un montage plus resserré sur les personnages principaux et une meilleure exécution, ne serait-ce seulement que dans la direction d’acteurs.




 Mon épouse et la voisine (1931)
Mon épouse et la voisine (1931)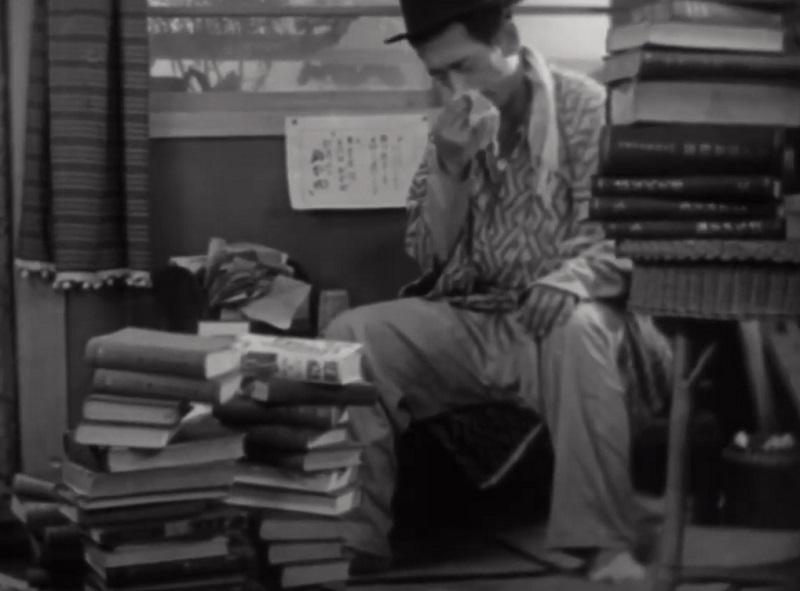


















 Année : 1952
Année : 1952










