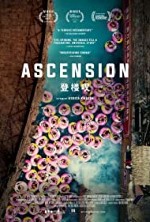C’est un peu désolant de voir que certains films pré-code mettant les femmes à l’honneur ne soient pas aussi prisés aujourd’hui pour le rôle essentiel qu’ils ont eu dans la construction des rapports homme/femme au vingtième siècle. J’en ai souvent parlé ici, et voilà un nouvel exemple fabuleux de rapports d’égal à égal entre un homme et une femme comme il a pu en exister dans le cinéma muet jusqu’à l’application stricte du code Hays autour de 1935. Le code n’a pas seulement imposé plus de moralité au niveau de la représentation de la sexualité ou des crimes à l’écran, elle a surtout porté un frein à un type de relations qui se généralisait à Hollywood après la guerre. Tout d’un coup, les femmes pouvaient prendre les commandes ou être les égales des hommes. Avec le code Hays, elles redeviendront leur faire-valoir, leur compagne ou leurs amantes. Ce stéréotype de rapport que l’on identifie en général à la révolution sexuelle des années 70 et à l’émancipation des femmes, parfaitement illustré au cinéma par exemple par la relation princesse Leïa/Han Solo, il est né entre 1920 et 1935 essentiellement à Hollywood. Et la courte période pré-code, parce qu’elle mettait en scène des personnages qui gagnaient en réalisme, a peut-être encore plus montré la voie et fait la preuve que ce type de relations mixtes était non seulement possible, mais que ça ne nuisait pas nécessairement à la séduction comme on peut le voir au début du film.
Il faut voir les dix premières minutes de Blonde Crazy pour se convaincre que tout en jouant un jeu de séduction classique, la personnalité et l’équilibre des rapports de force dans les situations présentées gagnent en densité et en véracité grâce au parlant. L’insolence de James Cagney, son génie à exprimer une certaine fantaisie, son audace bouffonne pleine d’autodérision qui est la preuve qu’il ne ferait au fond de mal à personne (et nous pousse à l’aimer, à s’identifier à lui, à lui ressembler), tout cela ne serait pas possible sans le son, sans les dialogues, sans la repartie. Surtout, la même chose serait impossible à imaginer pour une femme… si on n’était pas en 1931.
On comprend mieux la nécessité pour les conservateurs voyant arriver le cinéma parlant de chercher à imposer un code de bonne conduite aux studios : le parlant avait bien redistribué les cartes et devenait une incroyable machine de guerre pour imposer des idées nouvelles, libérales, à un public sidéré par cette nouvelle révolution du cinéma.
Encore aujourd’hui, on voit rarement une femme à l’écran tenir ainsi tête à un homme pour le moins insistant. Ce n’est pas seulement le talent des auteurs capables d’écrire les répliques qu’il faut pour répondre au pot de colle qu’est James Cagney, il faut aussi et surtout le caractère qui va avec afin de rester crédible : je ne suis pas sûr que les petites Françaises, en voyant revenir leurs hommes cabossés de la Première Guerre mondiale, montraient autant d’autorité et d’indépendance que certaines des actrices qu’on a vu fleurir à la même époque jusqu’aux premières heures du parlant à Hollywood. Je passe la période du muet que j’évoque dans It Girl, mais en 1931, au tout début de cette nouvelle révolution de la représentation des relations à l’écran, et donc de l’imaginaire social auquel tout le monde sera alors censé se référer par la suite, le public, et probablement encore plus le public féminin, peut s’identifier à de forts caractères féminins, des actrices, tenir la dragée haute à des partenaires masculins. Mae West, Barbara Stanwyck (dont j’évoque aussi l’importance dans Stella Dallas et dans L’Ange blanc), Jean Harlow, et donc ici Joan Blondell, et quelques autres ont montré la voie à toutes les autres. Ici, c’est bien l’intelligence de l’actrice qui lui permet de se mettre au niveau (très haut en matière d’autorité, de charisme et d’intelligence) de James Cagney.


Elle a tout : la même insolence, la lucidité (fini les grandes naïves), la désinvolture, le détachement ou l’assurance qu’elle saura toujours faire face (c’est aussi ce qui donne cette impression d’autorité naturelle, car la personne, qu’elle soit un homme ou une femme, n’a jamais besoin de passer par l’agressivité ou de hausser le ton pour se défendre — sauf avec des baffes), et une certaine forme de bienveillance cachée derrière une froideur feinte. Sur ce dernier trait de caractère, c’est le même tempérament qui fait qu’on apprécie James Cagney malgré ses penchants agressifs, ses sautes d’humeur fréquentes, et ici, son goût pour la filouterie : ils n’auraient pas tous deux des jeux de regards ou des sourires servant de contrepoint et de sous-texte, jamais on ne pourrait autant les aimer. C’est bien leur imprévisibilité, leurs retournements (il arrive au personnage de Cagney de reconnaître qu’il est allé trop loin) et leur capacité à produire des sous-entendus qui forcent le respect du spectateur. Personne n’a envie de s’identifier à des personnalités fades et toujours prévisibles dans leur constance molle.
Au-delà de ces traits de caractère qui prouvent une personnalité déjà bien affirmée, elle a aussi du répondant. Que ce soit au niveau du verbe parce qu’elle a autant de repartie que son acolyte masculin sinon plus, mais aussi au niveau physique : c’est peut-être un tour peu réaliste, voire carrément burlesque (et en l’occurrence, c’est un running gag assez efficace au début du film), mais je ne peux m’empêcher de penser que son audace physique, celle qui lui permet de filer des gifles à celui qui lui court après, a pu donner des idées aux femmes qui voyaient le film au début des années 30. Oui, on pouvait gifler un homme, non pas parce qu’on serait outré de ses agissements, non pas parce qu’on serait une garce, non pas parce que l’on chercherait à commencer une bagarre perdue d’avance, mais parce qu’on estime être son égal. Il y a dans ces gifles quelque chose qui ressemble bien plus à des claques que Titi pourrait filer à Gros Minet, d’une grande sœur à un petit frère turbulent : la violence n’en est pas une (elle ne l’est jamais dans le slapstick), c’est une tape sur les fesses de bébé, c’est une tape au cul qui va dire « t’es bien gentil, mon garçon, mais tu m’importunes : je te gifle et on est quitte, ça te fera fermer ton caquet ». Et on tourne les talons sans air hautain, sans agressivité, sûre de son fait et de son droit, et peut-être un peu aussi avec un œil en coin (amusée ou non) pour voir la réaction du Gros Minet (ceci, seulement ici parce que l’on comprend que la Joan Blondell en question pourrait tout autant être intéressée par le bonhomme s’il se comportait plus en gentleman). On peut adhérer à cette forme d’égalité parce que si le personnage de Cagney est un peu lourd, il ne tombe jamais dans ce qu’on appellerait aujourd’hui du harcèlement. Au contraire de quoi, la réaction de Joan Blondell aurait toute légitimité à ne plus se contenter de petite claque amicale. Et quand on est un public masculin, on se dit qu’on se laisserait bien faire la leçon par pareille femme : tout compte fait, si c’est pour nous apporter un « partenaire », plus qu’une docile concubine ou une esclave sexuelle, pourquoi s’en plaindre ? On le voit d’ailleurs par la suite : sans sa blonde crazy, le filou ne se sent pas d’arnaquer son monde (ce que paradoxalement elle avait toujours espéré trouver en lui).
C’est un paradoxe très « pré-code » : le personnage de James Cagney est un effroyable filou, ne cherche surtout pas à être autre chose, mais on sent derrière cette carapace de « gros dur », une sensibilité et un sens des limites… avec les femmes, en tout cas avec celle qui l’intéresse. Le danger de ces films, peut-être parfaitement identifiés par les conservateurs de l’époque ayant poussé à suivre un code de bonne conduite, c’était probablement moins la question de la représentation (positive) faite des criminels (il y a tout un abécédaire de l’escroquerie dans le film qui aurait pu faire naître bien des vocations) ou de la représentation de la sexualité à l’écran que celle de la place de la femme, émancipée, dans la société américaine d’alors. Par la suite, on aura bien des paires homme/femme qui apparaîtront ensemble à l’écran toujours complices, mais que ce soit dans la série des Thin Man par exemple ou dans les screwball comedies (et en premier lieu, les comédies de remariage, si typiques de cette ère du code Hays), il s’agira presque toujours de couples mariés ou appelés à l’être (en tout cas, rarement des criminels).
Quand on sortira du cadre du mariage (si relation d’égalité il y a), elle sera toujours relative, et presque toujours avec des filles de mauvaise vie. La femme fatale n’est pas une égale, c’est une paria, une femme qui justement doit payer le prix de son émancipation, le prix d’avoir cherché à se faire l’égale des hommes.


Voilà pourquoi ces films pré-code sont si importants dans ce qui est devenu une norme dans les relations en Occident. Toute notre manière de nous comporter en société est née de cette représentation de la relation homme/femme à l’écran après la Première Guerre mondiale, essentiellement à Hollywood, mais destinée à un public de masse mondialisé. Le cinéma muet n’était pas seulement muet, il était encore à la limite de ce qu’il était possible de faire en matière de représentation et de réalisme à l’écran. Avec le parlant, on voyait sous nos yeux une manière d’être, de se comporter, de parler qui était devenue presque naturelle, en tout cas suffisamment vraisemblable pour qu’on puisse chercher à en imiter les codes, à en explorer les limites et les possibilités dans la vie réelle. Parfois, peut-être pour le pire (si on cherche à reproduire les savantes escroqueries du personnage de James Cagney), mais surtout pour le meilleur : la possibilité pour le public féminin de se représenter la possibilité d’un monde où les femmes tiendraient tête aux hommes sans crainte d’en subir les conséquences (puisque je l’ai encore en mémoire, Bette Davis se fait défigurer pour son audace dans Femmes marquées, on est en 1937 : fini l’égalité ; on châtie plus tard ses agresseurs, mais on suggère un peu aussi qu’elle l’aurait un peu cherché en exerçant un tel métier) et d’affirmer ainsi un statut, égal à celui des hommes, prétendre aux mêmes audaces, qualités ou excès, etc.
Le film devient plus conventionnel par la suite. Le personnage de Joan Blondell s’adoucit, rentre dans le rang, mais ces premières minutes du film illustrent peut-être à elles seules ce qu’est l’époque du pré-code. Une époque de possibilités, d’ouverture, d’égalités acquises ou à prendre, et qui annoncera les luttes menées par les femmes des années 60 et 70.
J’insiste beaucoup sur ce sujet, et peut-être que je ne connais pas autant la période que je voudrais le croire, peut-être que mes connaissances en sociologie ou en ethnologie sont est inexistantes, et peut-être qu’on ne voit les choses qu’à travers ce que l’on connaît, mais j’attends toujours de trouver des arguments venant me convaincre que cette période n’aurait pas eu l’importance dans notre société comme je le prétends et ne serait qu’un épiphénomène auquel je porterais depuis des années trop d’importance historique.
En attendant, je me permets de dire, presque un siècle plus tard, à cette petite blonde potelée que je l’adore. Pas seulement pour sa beauté, sa douceur, toute féminine…, mais pour son intelligence, sa dureté aussi, sa constance, et pour l’assurance et l’audace dont fait preuve son personnage dans ce film (et qu’elle a parfaitement su transmettre au spectateur). Dommage que les films dans lesquels elle apparaîtra par la suite (même en vedette) ne soient pas restés autant dans l’histoire que ses films pré-code.
Des actrices mentionnées plus haut, seule Barbara Stanwyck restera au plus haut à l’ère du « code », et dans un style plus policé que dans les films où elle apparaissait à la même époque. Toutes deux se sont croisées d’ailleurs sur L’Ange blanc. James Cagney, lui, se fait remarquer la même année avec Jean Harlow dans L’Ennemi public, et à nouveau avec Joan Blondell, deux ans plus tard, dans le formidable Footlight Parade. Lui aussi restera un acteur de premier plan après 1935. Mais comme il y a eu un plafond de verre pour les acteurs du muet à l’arrivée du parlant, il y a eu plafond de verre pour les actrices attachées à des personnages émancipés au moment de l’application du code. Les hommes n’ont pas eu à souffrir du même problème, semble-t-il. Après avoir montré la voie pendant vingt ans, Hollywood devenait presque une arme de soft power au profit des conservateurs, alors même que c’était désormais les démocrates avec Roosevelt qui dirigeaient le pays…