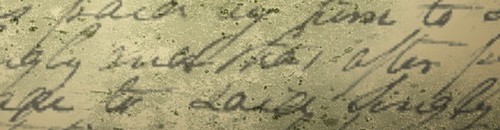Janvier – Juin 2024
juin 2024
L’Enfant de l’hiver, Olivier Assayas (1989)
commentaire :
Une vierge sur canapé, Richard Quine (1964)
La censure, après vingt ans, commence sérieusement à produire des films qui tournent en rond et qui sont incapables de saisir l’air du temps de l’époque qui n’est plus aux comédies renfermées traitant de la classe supérieure. Le film aurait été drôle vingt ans plus tôt. Tout est bien construit, c’est charmant et bourgeois comme une comédie de boulevard reposant sur l’un des éléments les plus anciens du théâtre : le quiproquo. On flirte avec le burlesque, surtout à la fin à l’ère de Jerry Lewis et de Blake Edwards, mais dieu qu’on voudrait voir autre chose à l’écran. Répéter l’humour de la même manière qu’on le faisait vingt ans plus tôt sans y implanter la moindre innovation, ça sonne comme ces imbéciles qui rebondissent sur une blague avec une autre soit en la répétant soit en l’imitant comme un écho embarrassant qui n’a plus rien de spontané. Car oui, l’une des vertus première de la comédie, c’est la fraîcheur et la spontanéité. Quand vous reproduisez le même type d’humour depuis des décennies, ce n’est plus de la comédie, c’est une industrie du rire. Le monde change partout ailleurs, on invente de nouvelles manières de faire du cinéma, mais enfermé dans sa jolie boule à neige, Hollywood continue d’enfiler les fantaisies sans aucun rapport avec le monde qui l’entoure. Quine semble être un excellent directeurs d’acteurs, il est plein d’idées de mise en scène bien trouvée (mise en scène, au sens de tout ce qui se passe devant la caméra, pas « avec la caméra »), mais on étouffe. J’ai toujours regardé les vieux films essentiellement pour voir ce qu’ils en montraient de leur époque à l’écran. Si on ne voit rien ou si d’autres films dévoilent bien mieux cette réalité, c’est eux qu’il faut regarder. Qu’est-ce que le film dit du public à qui on proposait ce genre de films à défaut d’y voir la vie réelle ? Que là encore, ceux qui regardent ces films étaient en bout de course : la génération des boomers va bientôt sortir de l’adolescence, et on leur propose les films que leurs parents allaient voir pour Noël au cinéma. Le seul bref moment avec le monde extérieur que l’on croise dans le film, c’est quand on y voit un clochard. Le traitement est le même que ce qu’en faisait Preston Sturges dans Les Voyages de Sullivan : beaucoup de mépris, une caricature. Le flic et le chauffeur de taxi à la fin seront montrés avec le même regard censé nous amuser. C’était déjà limite dans les années 30 et 40, en 1964, ça ne peut plus passer.
Ce plaisir qu’on dit charnel, Mike Nichols (1971)
commentaire :
Des filles pour l’armée, Valerio Zurlini (1965)
commentaire :
Le Désert des Tartares, Valerio Zurlini (1976)
commentaire :
Les Jeunes Filles de San Frediano, Valerio Zurlini (1954)
Je crois avoir rarement éprouvé autant d’antipathie pour autant de personnages dans un même film. Le bellâtre pour être un escroc à la gueule d’ange à qui on pardonne tout. Et ses victimes, toujours assez sottes pour se ruer la tête la première dans la gueule de l’ange… On est certes dans la satire, mais séduire autant de femmes en même temps, soi-disant, par inadvertance, on a peine à y croire.
Le casting est bien joli (on s’en doute) et Zurlini fait le taff à tous les niveaux. On remarque déjà son talent à jouer avec les regards, autant pour les rendre expressifs que pour leur faire dire à partir de montage ce qu’aucun dialogue ne dira jamais.
mai 2024
Le Mystère Silkwood Mike Nichols (1983)
Début poussif qui flirte avec la satire quand les acteurs sont en roue libre avec les règles de sécurité dans une chaîne de manipulation du plutonium destiné à des centrales nucléaires. Les acteurs sont formidables, mais voir toute cette bande destinée à devenir des stars (ou qui le sont déjà) jouer les culs terreux, ça n’a rien de réjouissant. J’ai eu peur de voir Michael Jackson débarquer un moment en bleu de travail en criant « It’s dangerous ! Who’s there ? »… On est même peut-être à un tournant du cinéma hollywoodien alors que Redford n’a probablement pas encore lancé son festival à Sundance. Le nouvel Hollywood s’est fait manger par le cinéma d’adulescents de Spielberg et de Lucas, Nichols a été un des premiers à lancer l’affaire il y a de ça maintenant quinze ans, mais on note tout de même ici un certain maniérisme et une tendance du cinéma intello à regarder les gens du peuple de haut. À forcer le trait. Une marque qui sera bientôt celle des films estampillés Sundance.
Et puis tout à coup, en même temps que son personnage trouve sur le tard une vocation syndicale inattendue, le film trouve l’angle qui lui échappait jusque-là. Silkwood n’a pas grand-chose a priori du personnage qui se met en lutte, et c’est pourtant ce qui arrive. Erin Brockovich avant l’heure. Rythmé par les diverses alertes à la contamination, le film prend ainsi presque les atours d’un thriller. Cela reste encore très hybride et j’aurais toujours mille réserves pour le talent trop évident de Meryl Streep qui a tendance à vampiriser un film au point de ne rien voir autre chose qu’elle, mais joli relance alors que je m’attendais à souffrir le martyr.
Une ville natale, Yoon Yong-Kyu (1949)
Jolie simplicité. C’est à la fois adorable, cruel et déchirant. Un petit bonhomme abandonné dans un temple rêve de voir sa mère. On lui raconte qu’elle est belle et qu’elle viendra un jour le chercher. Puis, le petit bonhomme fait la connaissance d’une femme en pèlerinage venant de Séoul. Les deux s’entendent si bien qu’elle voudrait l’adapter et demande au moine de le laisser partir avec elle. Le moine refuse, mais avant que la femme puisse partir, il voit la véritable mère du petit bonhomme réapparaître discrètement. Ne voulant la laisser à sa mère, il accepte la demande de l’autre femme… Maîtrise parfaite du découpage et de la direction d’acteurs, en particulier du jeune garçon. Rien qui dépasse. La propreté et la simplicité des grands films. (Le film vient d’être partagé en haute définition par les Archives coréennes du film sur leur chaîne YouTube. Il fait partie également de la liste des Indispensables de 1949.)
La Lignée d’une femme, Kenji Misumi (1962)
commentaire :
Rétro Misumi :
Une page (folle) se tourne à la Cinémathèque avec la fin de la rétrospective très « auteuriste » Kenji Misumi. Une quantité faramineuse de films indisponibles projetés (souvent des drames en costumes pour jeunes filles en pleur ou des aventures vagabondes entre Kyoto et Edo), parmi lesquels une poignée de chefs-d’œuvre faisant la preuve de la supériorité de la Daiei (peut-être le premier studio à avoir fait connaître ses films à l’extérieur du Japon dans des festivals) avant de s’écrouler dans les années 70.
Globalement une réussite. Assez peu de problèmes de sous-titres (quand on compare à ce qu’a connu la tek pour le passé) et des copies magnifiques. Le hic, avec le cinéma japonais, c’est que l’institution persiste à foutre ça dans la petite salle quand en face c’est du… Duras. Ils le savent, Paris est plein d’amateurs de cinéma japonais (voire de Japonais cinéphiles), et la Franju était souvent pleine des minutes avant le début de la projection. Alors, certes, le public est composé toujours des mêmes personnes (peu de ces jeunes que la tek chercherait à faire venir et qui filaient de toute façon à l’expo Cameron), mais autant je suis triste de la fin de cette rétro, autant c’était usant de voir toujours les mêmes têtes au point d’avoir parfois l’impression d’avoir rencard chaque soir avec la moitié de la région. Il faut voir les queues qu’il y avait une heure à l’avance… Foutez ça dans la grande salle la prochaine fois, pitié.
Et tentez peut-être un cycle « mélodrames de la Daiei ». On évitera l’angle de la politique des auteurs, et on y découvrira encore sans doute des chefs-d’œuvre injustement oubliés.
Maintenant, il faut aussi taper sur les doigts des institutions ou ayant-droits nippons. Les mecs, vous êtes en train de vous faire dépasser par la culture coréenne (on motive comme on peu). Vous avez des trésors dans vos cartons, au lieu d’attendre qu’on vienne vous faire les poches et qu’on associe plus la culture japonaise qu’à Miyazaki et à rien d’autre, prenez exemple sur les archives coréennes et faites la promotion gratuitement de vos trésors sur YouTube. Visibilité = buzz ; buzz = consommateur de supports physiques ; buzz = plus de diversité dans la grande salle de la Cinémathèque pour sa rétro trimestrielle du cinéma japonais.
Mon top des films découverts à l’occasion de cette rétro. Les 9 et les 8 :
J’ai regroupé grossièrement les genres (à retrouver sur ma page Misumi).
Les drames amoureux :
- Brassard noir dans la neige (1967) 9/10
- Komako, fille unique de la maison Shiroko (1960) 9/10
- Le Palais de la princesse Sen (1960) 9/10
- Le Temple du démon (1969) 9/10
- La Lignée d’une femme (1962) 9/10
- Le Fantôme de Yotsuya (1959) 8/10
- La Famille matrilinéaire (1963) (une satire surtout) 8/10
- L’Homme au pousse-pousse (1965) 8/10
- Deux Sœurs mélancoliques à Kyoto (1967) 8/10
- Gompachi au chapeau (1956) 8/10 (commentaire à venir)
Les aventures vagabondes, contes populaires et comédies en costumes :
- Les Carnets de route de Mito Kômon (1958) 8/10
- Les Deux Gardes du corps (1968) 8/10
- Le Passage du Grand Bouddha I (1960) 8/10
Mention spéciale également à ces trois contes populaires pour leur duo improbable et magnifique :
- La Courtisane et l’Assassin (1963) (Roméo et Juliette) 7/10
- L’Enfant renard (1971) (amour filial) 7/10
- La Princesse aveugle (1959) (amour qui défie les rapports de classe) 7/10
Dans ces films, il n’y a peut-être que Le Temple du démon qui soit disponible. On parle ici que de Misumi, mais imaginez la quantité de films de haute qualité gardés dans les cartons… C’est criminel.
Encore !
The Woman Gambler 17 , Kenji Misumi (1971)
Vu par curiosité. N’ayant vu aucun des… 16 premiers épisodes, il fallait s’attendre à pas y comprendre grand-chose. Amateur des opusculaires de La Pivoine rouge (Lady Yakuza) dont cette joueuse semble être une sorte de sœur cadette, je me suis laissé tenté. Un des derniers films produits par la Daiei. La pauvre, elle produit des séries depuis des années, mais elle fera faillite avant de pouvoir participer à la vague d’exploitation des années 70. Quitte à faire des films avec trois bouts de ficelles, il aurait été peut-être plus judicieux de miser sur l’expérimental. Parce que le film reste encore très académique, on ne tombe jamais dans les excès de violence qui n’ont jamais caractérisés la mise en scène de Misumi, mais c’est sacrément fauché. Les salles de jeu, c’est pratique, on a jamais à montrer l’extérieur… Des extérieurs, il y en a quelques-uns, des terrains vagues (on y voit une jolie scène « d’amour » d’ailleurs). Et le finale se déroule dans une très jolie maison traditionnel, mais on n’est plus à l’époque où on peut découper les shojis en origami lors des grandes bastons : on se bat, oui, mais on met plus l’accent sur la chorégraphie que sur la destruction du décor (le propriétaire ne serait pas content). Le récit est bien construit, mais sans capacité à proposer une histoire qui sorte de l’ordinaire, l’équipe est condamnée à jouer sur des sujets vus cent fois (le tricheur repenti qui finit par être trompé, puis assassiné, la joueuse qui s’exile quelque temps pour se faire oublier, le jeu qui s’invite malgré elle, la rencontre heureuse avec l’alter ego qu’on aime avant même de savoir qu’il existe, les guerres de clans, les parties à quitte ou double, l’honneur perdu du clan, le revirement inattendu et la révélation d’identité). Je suis venu, j’ai vu, j’ai perdu. C’est triste de voir le cinéma japonais agoniser sur la pellicule.
Ōkuma Shigenobu le grand , Kenji Misumi (1963)
Après la vie de Bouddha, c’est donc celle d’un illustre politicien japonais, Shigenobu Ôkuma, une des figures du développement académique et industriel du pays à l’ère Meiji tout de suite après son ouverture, qui est confié à Misumi… Au-delà de l’aspect historique (période très rarement montrée au cinéma sinon sous l’angle des films de yakuzas, et par conséquent, plutôt inconnue pour moi), pas grand-chose à signaler sinon une profusion de moyens déployés pour cette hagiographie et un acteur principal loin d’être convaincant. Informatif, rien de plus. Et un peu barbant (comme tous les biopic).
La Princesse aveugle, Kenji Misumi (1959)
commentaire :
Une aussi longue absence, Henri Colpi (1961)
commentaire :
Deux Sœurs mélancoliques à Kyoto, Kenji Misumi (1967)
commentaire :
L’Inspecteur du Shogun & L’Enfant renard, Kenji Misumi (1959-1971)
commentaire :
La Courtisane et l’Assassin, Kenji Misumi (1963)
commentaire :
La Famille matrilinéaire, Kenji Misumi (1963)
commentaire :
Le Temple du démon, Kenji Misumi (1969)
commentaire :
Le Combat de Kyôshirô Nemuri (Nemuri Kyoshiro 2: Shôbu), Kenji Misumi (1964)
J’ai dû revoir des images du premier volet pour me remémorer le contexte de la saga, mais cela ne semblait pas si nécessaire en fait. C’est vrai que dans ce genre de film, le principe est presque celui des séries TV où à chaque épisode, on repart presque avec une nouvelle histoire : on garde le héros principal, de nouveaux personnages apparaissent et par conséquent une nouvelle mission. C’est joliment fait. Du récit populaire (genre sur lequel le cinéma français aurait dû capitaliser en multipliant les films de cape et d’épée, mais le public a vite été subjugué par les récits populaires venus d’ailleurs) qui tient surtout pour la botte secrète que les opposants au héros semblent tous pouvoir déjouer. La suite au programme, mais ça me paraît déjà un peu en deçà du précédent.
La Saga de Magoichi, Kenji Misumi (1969)
Kinnosuke Nakamura qui avait été autrefois peut-être le Miyamoto Musashi le plus convaincant sous les ordres d’Uchida est loin de son meilleur. On y retrouve également le jeune premier d’autrefois, boule à zéro, Kôjirô Hongô, qui était formidable dans Les Deux Gardes du corps par exemple. Shintarô Katsu joue le méchant dans l’histoire. Vulgaire western qui ravira les amateurs de films de guerre en costume. Le seul intérêt du film tient de l’obstination fétichiste que porte le héros pour un grand amour dont il n’a vu que les pieds. C’est cocasse, mais aussi totalement hors du ton général du film (même si toute la troupe de Musimi essaie de faire passer ça pour une comédie). On approche la fin des heures de gloires du cinéma nippon, et à l’image du cinéma italien à la même période, cela se fait d’abord par un vieillissement remarquable de sa distribution. C’est assez pathétique ici : tous les héros vaillants du début de la décennie sont réunis et semblent avoir passé leur soirée à boire de l’alcool (ils ont tous la gueule bouffie et le geste lourd des gros buveurs). La gueule de bois commence pour le cinéma japonais. Même l’image commence à s’enlaidir.
Les Combinards des pompes funèbres, Kenji Misumi (1968)
Farce contemporaine et satire capitaliste bien construite et bien interprétée, mais cela a méchamment vieilli, et l’humour noir sur une heure et demie de film, ça use. Shintarô Katsu est toujours parfait en crétin naïf et volontaire. Le film vaut peut-être juste le coup d’œil pour la performance du Michel Simon nippon, Yûnosuke Itô, en chirurgien plastique désabusé, tripoteur de fesses et bilingue.
Les Carnets secrets de Senbazuru, Kenji Misumi (1959)
commentaire :
Komako, fille unique de la maison Shiroko & Le Palais de la princesse Sen, Kenji Misumi (1960)
commentaire :
Le Démon du château de Sendai , Kenji Misumi (1962)
— Bonjour Monsieur Kubrick. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi avoir réalisé La Grand Sommeil ?
— J’ai toujours apprécié le travail de William Faulkner.
— Avez-vous conscience que le public sera un peu perdu ?
— Vous l’étiez ?
— Honnêtement, oui.
— Vous n’avez rien compris ?
— Honnêtement ? Rien.
— Intéressant. Qu’avez-vous retenu d’autre ?
— Vous êtes le plus grand réalisateur sur terre.
— Je le savais déjà. Mais il y en a un autre.
— Ah oui ?
— Devinez.
— Howard Hawks ?
— Qu’est-ce que vous racontez ? Je vous ai demandé de deviner, pas de raconter n’importe quoi.
— Pardon, c’est que je suis encore troublé par votre film.
— Un homme a réalisé un film tout à fait fascinant, le public occidental se plaignait n’y avoir rien compris, mais tout le monde était unanime pour dire que le travail de la production, des décors, la photographie, jusqu’aux acteur, et bien sûr ce qui nous intéresse ici, la réalisation, pour dire donc que ce travail était admirable. Du jamais vu. D’ailleurs, en réalité, dans le monde réel, personne ici ne l’a vu. Vous ne voyez toujours pas de qui je veux parler ?
— J’avoue que…
— Kenji Misumi.
— Ah.
— Vous ne voyez pas qui c’est ?
— J’avoue que…
— Zatoïchi.
— Ah. Oui. Bien sûr.
— Vous ne voyez pas. En quelle année somme nous ?
— 2024.
— Tout s’explique.
— Si vous le dites. Moi, je suis perdu.
— Je reviens de la Cinémathèque française… Vous connaissez la Cinémathèque française ?…
— Pas personnellement.
— Peu importe. Je reviens donc de la Cinémathèque française où j’ai vu un film intitulé Le Démon du château de Sendai.
— Un film d’horreur.
— Pas du tout.
— Evidemment.
— Enfin, peut-être pas. Je n’y ai rien entendu.
— Vous, Monsieur Kubrick, vous n’avez rien compris ?
— J’ai réalisé 2001 : Odyssée de l’espace, je vous rappelle…
— Bien sûr. Non, en fait, je n’en savais rien. Zatoïchi, c’est qui déjà ?
— En 2024, personne ne se rappelle de mon 2001 ?
— Plaît-il ?
— Bref, j’en reviens à mon film.
— 2001 ?
— Le Démon du château de Sendai.
— Bien sûr…
— Eh bien, il a été réalisé par Kenji Misumi.
— Je ne l’aurais jamais cru.
— Et le film est très bon. Vous devriez le voir.
— Avec plaisir, ça parle de quoi ?
— Je n’en ai absolument aucune idée !
— Tout un programme. Monsieur… quel est votre nom déjà ?
— Kubrick.
— Voilà. Eh bien, je crois que je vais aller me reposer. Un grand sommeil s’impose.
Bref, c’est foutrement joli, mais je n’ai rien compris. Rien. Godzilla aurait très bien pu apparaître dans une scène que je n’y aurais vu que du feu.
Brassard noir dans la neige, Kenji Misumi (1967)
commentaire :
Le Passage du Grand Bouddha, Kenji Misumi 1960
Plus de souvenirs du tout de la version d’Uchida tournée trois ans auparavant (mais bien notée), et pas beaucoup plus de l’unique premier volet préservé d’Inagaki sorti, lui, trente ans avant. Mais j’avais déjà relevé un style de récit éclaté pas forcément à mon goût. J’aime bien les histoires écrites en tableaux, mais essentiellement quand le récit est centré sur un seul personnage et la trajectoire d’un destin unique. Ici, ça part parfois dans des telles ellipses qu’on a du mal à savoir de quoi il en retourne. Faut croire que c’est propre au roman parce qu’on retrouve ce style dans toutes les versions. Là où le film se montre bluffant en revanche, c’est dans la maîtrise formelle de Misumi. Sa composition est somptueuse. Il arrive bien à marier les plans tournés en extérieurs et ceux en studio (même de forêt) et moi qui suis loin d’être fan de Raizô Ichikawa, reconnaissons qu’il offre à son personnage une gravité folle dans les deux premiers épisodes. La Daiei a dû se dire que pour le troisième volet, le public concerné irait de toute façon dans les salles, donc ils étaient en mode balec, et un autre réal friand de mouvements de caméra intempestifs s’est chargé de conclure l’aventure. En dehors d’une jolie séquence finale prise dans un typhon, cette dernière partie peine à retrouver l’élan initié par Misumi.
Les Deux Gardes du corps, Kenji Misumi 1968
commentaire :
She Done Him Wrong/Lady Lou, Mae West (1933)
Toujours le même problème avec Mae West. Derrière les répliques typiques de la repartie de Broadway qui feront le succès des Marx Brothers, de la screwball comedy, et de bien d’autres une fois adoptées par Hollywood, et derrière l’hénaurme caractère de l’actrice et dialoguiste de génie qu’était West, il n’y a pas grand-chose qui tient la route à l’écran. J’ai souvenir que dans les deux ou trois autres films que j’ai vus du phénomène, on dépasse toujours péniblement l’heure de film, ce qui est tout de même le signe d’une dramaturgie plutôt expéditive. Elle arrive d’ailleurs à bien nouer les maigres fils de l’intrigue qu’elle tisse, mais ça ne volera jamais bien haut tant l’actrice traite ses intrigues par-dessus la jambe.
S’il faut reconnaître au phénomène West qu’il a beaucoup fait pour aider à imaginer une inversion des rôles dans la société, on pourra toujours résumer sa carrière à une équation simple : une grande actrice pour de petits films. Dans ses films, Mae West est toujours la femme qui dirige tout, qui a le dernier mot, qui prévoit tout ; c’est la boss et elle veut que ça se sache. Un tournant pour l’image de la femme, certes, moins pour le contenu de ses films.
Content malgré tout de voir une rétrospective dédiée à la Cinémathèque. La grande salle était pleine. S’il y avait une femme de pouvoir à mettre à l’honneur dans le cinéma, c’était bien elle.
Un flic hors-la-loi, Kenji Misumi (1973)
Défilé de plans en téléobjectif avec flous et couleurs crado. Misumi s’amuse, faute de pouvoir filmer autre chose que des décors bien dégueux, mais on est loin de l’énergie d’un Fukasaku (Combat sans code d’honneur, c’est la même année). Et pourtant, c’est peut-être la seule chose à garder. Tout le reste est vilain comme c’est pas permis : pas de rythme, une histoire stupide voire grotesque (le finale est tellement mélodramatique que ça pourrait être du John Woo, par exemple, mais Misumi est clairement dépassé dans ces années 70 fauchées), pas d’action digne de ce nom, pas de tension crédible. Et le pire peut-être de tout : des séquences de torture répétitives sans fin et sans but. Quand Hanzo torture sexuellement ses victimes, on est dans l’outrance absolue, on s’en amuse, et c’est souvent très créatif. Ici, on torture gratuitement ; cela se veut sans doute amusant, mais c’est loin de l’être. Le pire film de Misumi jusque-là. Mais on le pardonne, ils y sont tous passés dans cette décennie d’agonie.
avril 2024
Les Garçons de la bande, William Friedkin (1970)
commentaire :
Les Carnets de route de Mito Kômon, Kenji Misumi (1958)
commentaire :
Momotarō le samouraï, Kenji Misumi (1957)
Réalisation encore plus précoce que Le Fantôme de Yotsuya. Déjà avec Raizō Ichikawa, qui assure ici un double rôle. On est dans le récit bien populaire avec toute une série de stéréotypes du genre : l’arrivée d’un étranger en ville ; la femme secourue ; la rencontre avec le fidèle zozo voleur à ses heures perdues ; celle (plus fortuite) avec la future aimée ; et bien sûr, le tour de force narratif à la limite du mélodrame, la ressemblance remarquable entre l’étranger avec un jeune seigneur devant faire face à un complot. Tout cela est bien opportun, mais on s’amuse comme des fous. Misumi n’en est pas encore à faire joujou avec l’écran large ; les couleurs rappellent celles des Inagaki des années 50 ; mais certaines prouesses techniques sont déjà du Misumi dans le texte : de nombreux travellings latéraux ou dans la profondeur en chœur avec la musique pour relever un effet narratif et une transition, une contre-plongée audacieuse plus que rare à l’époque, des gros plans introductifs contraires à l’habitude classique d’alors, et déjà, dans les batailles, une préférence à tourner l’axe de la caméra sur les bretteurs en plan rapproché, là où d’autres font l’erreur de tourner leur caméra sur la rencontre entre les deux sabres (ce qui n’empêche pas Misumi de tirer admirablement parti du talent de ses deux sabreurs dans un magnifique finale joliment chorégraphié).
Le Fantôme de Yotsuya, Kenji Misumi (1959)
commentaire :
Cruising, William Friedkin (1980)
Friedkin, toujours aussi peu subtil. Si le bonhomme se défend dans le jeu d’ambiances interlopes tendances SM, son thriller est tendu comme un slip kangourou YMCA. Pas beaucoup de tension, une intrigue qui sursaute mécaniquement à chaque nouveau meurtre sans qu’on en montre réellement les conséquences (en mode osef), et un Al Pacino loin de sa meilleure forme. La fin part en sucette : on oublie le meurtrier, et on se concentre sur les tendances à la fois meurtrières et homosexuelles du flic infiltré en faisant un amalgame des plus dégueulasses. Le film aurait été perçu comme un film homophobe. Il y a de quoi. Assimiler ainsi milieux de la nuit, SM et pulsions meurtrières, c’est pour le moins déplacé. On mettra ça sur le compte de l’incompétence ou de la maladresse. Friedkin n’y est pas pour grand-chose, c’est surtout son scénario qui fait n’importe quoi. Le réalisateur de French Connection fait d’ailleurs un assez bon travail. Reste une dernière bévue : mettre une riche, jeune et jolie petite amie dans les pattes d’un flic de la circulation qui a deux fois son âge (le personnage n’a aucune vie propre et ne semble vivre que pour son raté de petit ami). Mention spéciale à l’équipe chargée de dégotter les appartements avec vue sur la ville (Greenwich Village, apparemment). On a définitivement mis au placard les tournages en studio, et ça fait le plus grand bien aux productions hollywoodiennes.
Sur la route à jamais, Kenji Misumi (1964)
Assez mineur. Un scénario basé sur une enquête et une recherche du père qui n’a rien de bien trépidant. On se croirait dans un roman russe à ne jamais savoir qui est qui. Et ça tombe bien parce que, badaboum, il s’avère que la personne recherchée n’est pas celle que l’on croyait… Les acteurs ne semblent pas bien convaincus non plus. Pas plus que Misumi qui se concentre comme il peut avec le joli écran large et la couleur qu’on lui a prêtés pour faire joujou au bord de la mer. Ce dernier aspect n’a d’ailleurs pas grand-chose pour me séduire : comme pour les westerns dans la boue, j’avoue une certaine aversion, presque physique, pour les chambaras balnéaires (Goyokin en tête). On note aussi énormément de connexions, sans doute inexplicables, entre les films d’exploitation (ou ce qu’on n’appelle pas encore ainsi) italiens et japonais. Si certaines influences sont mutuelles et avérées ou avouées, d’autres me paraissent improbables. Ici, par exemple, j’y vois un côté Django avec ce village semblant sortir du néant (aucun voyage possible, aucune nouvelle du dehors, il n’y a jamais que les voyageurs que l’on suit capables de venir chahuter le repos relatif de ce petit monde corrompu vivant en vase clos).
Pour ce qui est de la réalisation donc (puisque Misumi se fout joyeusement de donner des indications à ses acteurs afin qu’ils y comprennent quelque chose ou adoptent une humeur conforme à une ambiance attendue à tel ou tel moment du récit), c’est assez brillant. Misumi (ou son chef opérateur) profite du grand écran pour multiplier les gros plans, et de la couleur, pour exposer les peaux moites et luisantes sous le soleil de plomb. Ce n’était pas le tournage à avoir une poussée d’acné. Comme à son habitude, il joue également énormément sur la profondeur de champ. Composition des plans époustouflante. On devrait appeler cette maîtrise « l’effet Misumi ». En dehors de ça, rien à retenir. Foutez-lui un bon scénario entre les mains à ce garçon.
Les Vaincus, Michelangelo Antonioni (1953)
commentaire (combat de dément) :
La Dame sans camélia, Michelangelo Antonioni (1953)
Difficile de soumettre au public un film dont le sujet devient précisément… le défaut du film. Film sur le cinéma : l’histoire d’une actrice belle à se damner, sans grand talent, qui manque beaucoup de volonté face aux divers hommes forcément goujats et puissants qui lui proposent soit de tourner pour eux, soit de partager leur lit, soit de se marier avec eux. Tout n’est qu’histoire de possession, et malheureusement, l’actrice ne s’en rend compte que trop tard. Quand elle se décide à se faire respecter pour son talent, difficile alors d’être prise au sérieux (joli passage où l’on entend un extrait d’Anna Magnani à Cinecittà, peut-être pour L’amore, de Rossellini, mais pas sûr, le film étant sorti plus tôt). Jusque-là, tout va bien. Le souci, c’est que Lucia Bosè a beau être la plus belle femme du monde, c’est une actrice qui peut tout à fait faire l’affaire dans un rôle d’appoint, mais difficilement assurer le tout premier. Et c’est d’autant moins convaincant que la plupart des hommes qu’elle croise (en dehors de son producteur, avec un acteur qui l’interprète, lui, en revanche, de manière assez convaincante, avec une façon unique de s’exprimer avec les mains) ne valent pas beaucoup mieux. C’est sympathique, mais ça manque un peu de cœur et d’intensité. On verra Lucia Bosè beaucoup plus à son avantage, employée chez Giuseppe de Santis (Pâques sanglantes). Antonioni avait déjà offert un premier rôle à l’actrice dans Chronique d’un amour.
Chung Kuo, Cina, Michelangelo Antonioni (1972)
Jolie occasion de constater l’explosion de la Chine ces cinquante dernières années. Même si l’on devine que Antonioni prend un plaisir assez malsain à placer sa caméra dans des quartiers particulièrement pauvres, et même si l’on peut imaginer que certaines provinces peuvent encore connaître une telle misère, c’est fou de voir que, en à peine un demi-siècle, le pays nous a non seulement rattrapés, mais dépassés, dans de nombreux domaines. Si l’on montrait les rues de Pékin ou de Shanghai aujourd’hui, je doute qu’on y trouve le moindre bâtiment (sauf historique) de cette époque. Beaucoup de visages aperçus dans le film, en grandissant, que sont-ils devenus ? D’une génération à l’autre, on passe de paysans à ultra-riches. En dehors de la Corée du Sud, je crois qu’aucun autre pays n’a connu une telle fulgurance vers la voie de la « prospérité » (ne manque plus que la démocratie). (En revanche, qu’est-ce que ça manque d’arbres ! La terre a l’air d’être d’une pauvreté aussi… Il en est où ce projet de reboisement de la Chine ?…) Bref, beau travail de documentariste (et de montage), avec le bon goût de terminer sur des artistes.
#combat de dément :
réaction à une émission de Blast avec Guillaume Meurice comme invité.
Le Livre noir, Anthony Mann (1949)
Mélange étonnant de noir, de film historique, d’espionnage et, comme toujours à Hollywood, de romance (voire de western, à la fin). L’alliance est assez réussie, et il faut saluer les efforts d’inventivité, mais film noir rime aussi souvent avec série B. C’est pas mal du tout si l’on considère les limites budgétaires du machin, mais ce sont justement aussi ces limites qui empêchent le film de réellement décoller. Quelques audaces de mises en scène (surtout au début), propres aux noirs de Mann, et qu’il cessera d’employer en tombant dans le classicisme des westerns. Richard Basehart en Robespierre, ça vaut aussi le coup d’œil.
Psaume rouge, Miklós Jancsó (1972)
Happening socio-folklorique sans grand intérêt. La lumière d’été fait bien jolie sur pellicule, les filles sont jolies, et nues, la musique détourne du vide de l’histoire. Je pourrais refourguer le commentaire du Sirocco d’hiver en fait, mais l’hiver et le sirocco doivent m’être encore plus insupportables que les libertés sexuelles exposées dans un film socio-hippie avec des tétons et des culs avec la marque du maillot. Un petit côté Mon curé chez les nudistes.
Il marchait la nuit , Anthony Mann (1948)
Pas mal du tout pour un noir sans grandes prétentions sinon à parfaitement servir la soupe à la police. On y retrouve un petit côté Dirty Harry sans (code Hays oblige) l’inspecteur Harry. Les criminels solitaires abondent dans les films noirs, voire les séries B de cette époque, mais ils sont presque toujours dépeints comme des psychopathes ou des personnages antipathiques. Le fait que le film relate (c’est en tout cas ce qu’il prétend) une histoire vraie pousse sans doute les studios à accepter de coller à la réalité (le criminel est présenté sous un jour plus ou moins flatteur : une sorte de génie). La performance de l’excellent Richard Basehart (l’un des frères Karamazov dans l’adaptation de Richard Brooks) va d’ailleurs dans ce sens : l’acteur ne force pas trop le trait (de la caricature maléfique du meurtrier) et en fait un être presque quelconque et charmant (on insiste beaucoup sur ses failles au début du film). Annonce la vague de films sur des criminels solitaires des années 70.
Dune : deuxième partie, Denis Villeneuve (2024)
J’ai tendance à dire que le cinéma, c’est 99% du montage, mais puisque je suis fort en mathématique, j’ajouterais que le bon cinéma, c’est 99% de sous-texte aussi. Tout est au premier degré, il n’y a absolument jamais aucun double sens, le doute n’est jamais permis (alors même que le roman est avant tout un jeu politique). On appelle ça le ton sur ton aussi, ou le maniérisme, le sur-jeu, voire tout simplement l’incompétence. Rien n’a changé chez Villeneuve depuis Next Floor. Un chef maquilleur qui se propose de régurgiter à sa sauce toute la culture SF de ses aînés.
mars 2024
Le Problème à trois corps (2024)
Adaptation du roman chinois du même nom. Les implications philosophiques et les piques misanthropes envers les sociétés (les dictatures surtout) valent sans doute plus que le sujet hard-SF ou les implications technologiques. Les humains mentent, c’est un fait, ils mentent par individualisme et mépris du sens commun, et ça nous mènera à notre perte. Reste à voir si une forme d’altruisme nous sauvera comme elle l’a toujours fait… Hâte de voir la suite.
L’Engrenage fatal, Anthony Mann (1947)
La même année que T-Men, on retrouve le joli minois (sorte de Janet Jackson blonde) de Jane Randolph (images du phénomène dans le commentaire sur T-Men). Elle est malheureusement beaucoup moins crédible en idiote qu’en femme fatale. Pas une question d’emploi, mais bien de talent. Jane n’est pas très douée. Elle l’aurait été, avec un physique pareil, elle serait devenue une star. Les autres acteurs s’en sortent légèrement mieux (sauf le chef mafieux amateur d’Oscar Wilde qui est vraiment pitoyable), pour une série B. Et pour le reste, un noir tout ce qu’il y a d’anodin. Un faux coupable idéal, tellement parfait qu’on préfère l’oublier à toute vitesse derrière les barreaux. Une sœur forcément dévouée au petit chef de famille capable de défier les malfrats et leurs méchantes balles. Et des flics, au début, à côté de leur plaque. On se demande comment un cerveau ayant imaginé un coup aussi bien ficelé arrive à être si peu précautionneux au point d’apparaître très vite comme un coupable de substitution idéal, mais ça, c’est le code Hays, il faut toujours que les criminels soient trahis par leur bêtise, et… soient méchamment exécutés à la fin (la justice, c’est pour les cols blancs ou les innocents, pas les criminels ; eux, la morale exige qu’ils soient malencontreusement assassinés par le gentil flic de l’histoire : refus d’obtempérer, dirait-on de nos jours). Il y a une idylle en plus de l’enquête criminelle, on s’en serait douté. Voilà, rien de fabuleux. On enchaînait les films noirs à l’époque, on « broyait du noir », et celui-ci n’est ni le plus mauvais ni le meilleur du lot. Circulez.
Les Furies , Anthony Mann (1950)
Jolie production comparée à La Porte du diable sorti la même année. J’aurais toujours un petit faible pour les intérieurs composés avec des éléments denses remplissant l’espace. La photo est magnifique quand bien même on aurait pu se passer des nuits américaines. Le casting surtout est au poil : Barbara Stanwyck, Wendell Corey, Walter Huston et Judith Anderson. Wendell Corey, sans doute plus habitué aux personnages dangereux, excelle dans sa partition (pas de cils, yeux clairs, grand front, pas sûr que ça aide à l’écran). Tout pourrait être parfait, sauf que les histoires d’ambition et de lutte de pouvoir familiale, les guerres de territoires, cela ne m’a jamais bien transcendé. Au final, tous les personnages sont antipathiques ; on frôle peut-être la satire, mais j’avoue qu’il manque un petit quelque chose capable de m’enthousiasmer… Au mieux, on peut y voir une critique de la propriété privée (avec un sujet qui court également dans La Porte du diable, voire dans Winchester 73, celui de l’appropriation des terres par des Blancs).
La Porte du diable, Anthony Mann (1950)
Deuxième western pour Tony juste après Winchester 73. Une fois n’est pas coutume : louons le travail du scénariste (Guy Trosper) pour cette histoire pleine d’humanité qui met l’Amérique face à ses démons (le génocide des autochtones amérindiens). Pour le reste, ce n’est guère brillant. Je me rappelle une forme assez classique dans Winchester 73 ; or ici, à mon goût, Mann s’amuse un peu trop avec la profondeur de champ comme il avait pu le faire, de mémoire, dans certaines séquences d’Incident à la frontière. Ce ne serait pas aussi pénible si sa direction d’acteurs était parfaite, mais c’est loin d’être le cas. Robert Taylor (si on accepte d’omettre l’idée qu’il n’a rien d’un Amérindien) est trop vieux pour le rôle. L’acteur a surtout l’air complètement perdu dans certaines séquences, ce qui laisserait penser que Mann ne l’a pas suffisamment dirigé en lui rappelant le sens ou le style qu’il voulait donner à la situation. On le voit ainsi reproduire des attitudes qui ne correspondent parfois pas totalement à la situation, et comme on sent encore qu’il s’agit d’un acteur de la vieille école, on peine à y croire. C’est même peut-être pourquoi je n’ai jamais apprécié les westerns de Mann : bien qu’il s’amuse ici quelques fois trop avec la profondeur de champ, sa mise en place générale d’un classicisme rigide et ennuyeux n’a rien de suffisamment transcendant pour en faire des chefs-d’œuvre. Qu’il fasse des films noirs ou des films de guerre, Mann donnera toujours l’impression d’être perdu dans les années 40.
W.R. : Les mystères de l’organisme, Dusan Makavejev (1971)
Ah, les joies de la révolution sexuelle des années 70 à la sauce yougoslave !… Étrange hagiographie d’un dégénéré de la psychanalyse, que voilà, avec (forcément) une fascination non dissimulée pour la sexualité.
Freud était un escroc ; avec Wilhelm Reich, on atteint des sommets. Vous aimez Lacan ? Vous rêviez d’un mix entre communisme et freudisme ? Vous aimez les viols des psychanalystes ou de n’importe quel autre gourou cherchant à exercer une forme d’autorité sur des victimes pour contenter ses propres pulsions ? Vous aimez Psychomagie de Jodorwsky ? Alors, Reich est fait pour vous, et vous apprécierez cet étron qui illustre bien son époque. Vous apprendrez à enfanter les étoiles grâce à votre semence, et un maître-plasticien avec de gros seins vous stimulera le pénis pour en faire un moule (à usage probablement personnel).
Vive la masturbation (surtout féminine, un ou deux ans avant Gorge profonde, c’est peut-être la seule utilité du film pour ses contemporains), mais laissez Reich à la poubelle (comme toutes les pseudosciences).
« Cancer et fascisme sont intimement liés. » OK, mec.
Enamorada, Emilio Fernandez (1946)
Adaptation de La Mégère apprivoisée la même année que La Perle du même Fernandez.
Mise en scène et production maîtrisées, mais sujet convenu. Le film ralentit sur la fin. Certains numéros d’acteurs sont appréciables, mais si certains interprètes masculins sont parfaits, l’actrice principale en fait un chouia trop (son partenaire est familier des films de Buñuel et de certaines productions américaines). Fernandez peut multiplier les gros plans mettant en avant la beauté de son actrice, on s’en moque un peu.
Ces deux derniers films mexicains (avec Macario) sont des classiques apparaissant dans tous les classements de meilleurs films mexicains. En espérant donc que ça donnera des idées à la Cinémathèque pour mettre mieux en avant cette période mexicaine largement invisibilisée (ce n’est pas gagné, peu de monde en salle).
Macario, Roberto Gavaldón (1960)
L’art finalement assez rare de la fable au cinéma. J’ai un vague souvenir que La Perle allait déjà dans ce sens. Ici, c’est peut-être plus appuyé, avec une dose de comédie, mais ça reste très bien mené du début à la fin. On pourrait le comparer par exemple à la seconde partie de L’amore de Roberto Rossellini par exemple : les mêmes illuminations forestières, mais une dérive vers le mélodrame, à travers le naturalisme, qui se fait bien trop franche et brutale, jusqu’au grotesque. Cela était bien trop appuyé justement parce que Rossellini montrait cette histoire de manière prosaïque et sans grâce. Une fable, par définition, presque toujours, contient un élément fantastique, que ce soit religieux ou non. Il faut alors avoir la foi et croire en ce qu’on montre.
Il y a de la grâce dans Macario. Chez le personnage et dans le film. On ne doute jamais qu’il soit bon, on compatit avec lui et les siens parce qu’il est plus fidèle aux principes de son dieu que ceux qui prétendent en être les ministres (les inquisiteurs). Sa femme croit en lui et ne le laisse jamais tomber. Même les riches ne sont pas les démons que l’on pourrait craindre (on n’est pas en Union soviétique), ce qui laisse le champ libre au récit pour se focaliser sur la fable et les forces du destin.
Aucun réalisme là-dedans, encore moins du naturalisme, étant entendu qu’on est dans le merveilleux et qu’on joue à y croire, pas à se moquer des uns et des autres. Quand, derrière le récit et les personnages, ne reste que la fable, sans souci de cohérence, la morale, seule, importe.
La bestia debe morir, Roman Vinoly Barreto (1952)
Adaptation antérieure du roman sur lequel s’est appuyé Chabrol pour Que la bête meure. Le film est plus dense et sans doute plus fidèle au roman. Il y avait de toute évidence une industrie du cinéma dans le Mexique du milieu du XXe siècle de bonne qualité.
Les recettes du succès sont à peu près les mêmes qu’à Hollywood. À voir si un tel système permettait à des productions plus personnelles de se faire, et si l’on a un peu facilement qualifié de cinéastes une ribambelle de réalisateurs qui se contentaient d’adapter des histoires écrites par d’autres. Rien de plus normal qu’à force de suivre les mêmes techniciens réaliser des films, on y décèle des motifs et des qualités qu’on se refuserait à voir ailleurs. On ne prête qu’aux riches. Et au sortir de la guerre, les riches, ce sont les « Américains venus sauver l’Europe ».
Le Mexique est encore certainement voué à rester une terre de cinéma de niche. La Cinémathèque propose quelques films mexicains à son festival (restaurés grâce à divers instituts), mais il ne faut pas s’attendre à en voir un peu plus à l’avenir… Faut pas compter sur moi pour autant pour faire le travail que certains se refusent à faire. La politique des auteurs doit mourir. Celle des grands films, même issus de générations spontanées aussitôt disparues, doit primer.
Macadam à deux voies, Monte Hellman (1971)
commentaire :
Alenka, Boris Barnet (1961)
Variation steppique du film de voyageurs (tendance films de bus) sur fond, forcément, de propagande (tout le monde il est heureux, tout le monde il est gentil dans le monde formidable de l’Union soviétique multiethnique, mais invariablement russophone). C’est un peu pénible ces histoires racontées sur le ton de la bonne humeur. Même si l’on échappe à l’ennui grâce à l’histoire de la petite autour d’un problème mathématique et à son idylle naissante avec un gamin rencontré sur la route.
1961, Barnet en a bientôt fini. Les réalisateurs (et réalisatrice, la petite a le patronyme d’une future cinéaste) viendront enfin proposer autre chose que ces machins acidulés sans grande consistance que le pays produisait jusque-là depuis la guerre.
Je suis une légende, Ubaldo Ragona et Sidney Salkow (1964)
À la hauteur du roman. C’est peut-être la seule histoire de zombie qui ait jamais su me passionner. Justement parce que c’est autre chose qu’une histoire de zombies (ou de vampires, ici, c’est la même chose, et c’est déjà en soi une excellente idée) : l’histoire d’un homme immunisé contre une pandémie ayant décimé la planète (quelques images rappellent furieusement ce qu’on a connu en 2020), et sans savoir pourquoi, capable par sa formation de comprendre en partie les risques qui l’entourent. Il s’échine chaque jour à créer les conditions de sa survie et à dézinguer au passage quelques « infectés » pendant leur sommeil, mais il finit par devenir le monstre à abattre.
Les normes se révèlent être moins une question de valeurs que de nombre : quand les nombres changent et que l’on est en minorité, les normes s’inversent et les monstres deviennent les « normaux ». Une leçon de relativisme bien plus qu’un spectacle débile où foisonnent les mines patibulaires des créatures errant entre deux mondes…
Le début du film rend par ailleurs bien hommage au roman écrit à la première personne, une de ses forces. Et l’on ne pouvait pas imaginer mieux que Vincent Price pour le rôle. Me reste à voir ce qu’en a fait Charlton Heston…
Le Poète, Boris Barnet (1957)
Vaguement meilleur que Le Lutteur et le Clown tourné la même année. Mêmes couleurs infectes, même propagande débile avec la mise à l’honneur des héros et la mise en accusation des bourgeois. Des décors en pâte à modeler, comme d’habitude chez Barnet, on a l’impression de voir un film des années 30. En dehors des acteurs, une fois de plus, il n’y a pas grand-chose à sauver.
Cinq Pièces faciles, Bob Rafelson (1970)
commentaire :
Le Début, Gleb Panfilov (1970)
Formidable petite comédie douce-amère sur les débuts inattendus de l’actrice principale d’un film sur Jeanne d’Arc. Quelques situations et répliques inattendues. Amoureuse d’un homme marié, Pasha va prévenir la femme de son amant qu’il s’est endormi chez lui. La femme lui demande alors de rester chez elle. Pasha lui répond que ça ne se fait pas. L’autre rétorque que c’est le contraire. Lunaire. Il faut suivre ensuite les caprices et les facéties de l’actrice pendant le tournage. Un petit côté Les Nuits de Cabiria, la drôlerie du désespoir souvent puéril et innocent. Deux acteurs forcément formidables, Dieu que ça change des films de Barnett… L’actrice et le réalisateur, en couple, sont tous les deux décédés l’année dernière. Triste fin. Passer de l’âge d’or du cinéma soviétique à la Russie de Poutine. Comme passer de Staline à la fin de l’URSS, l’espoir de la démocratie, et hop, rebelote. Ce n’est pas un début, c’est un éternel recommencement.

Kôchiyama Sôshun, Sadao Yamanaka (1936)
commentaire :
L’Enfance nue, Maurice Pialat (1968)
Du Petit Fugitif aux Quatre Cents Coups, du Vieil Homme et l’Enfant à De bruit et de fureur, en passant par Kes et Le Petit Garçon qui viendront l’année suivante, l’errance enfantine reste une valeur sûre du cinéma réaliste… Mais Pialat y installe aussi, grâce aux techniques de cinéma direct, un réalisme brut encore rare pour l’époque, un réalisme le plus souvent improvisé par des acteurs amateurs (quand ils ne jouent pas tout bonnement leur propre rôle), et qui pose les bases de son cinéma futur. Plus héritier d’Antoine, finalement, que de Truffaut qui produit le film. Pialat, comme d’autres, finira par faire appel à des stars, dénaturant un peu le dispositif radical mis en place dans ce premier film. À la même époque, et de manière plus éphémère, on a connu ça avec Eustache, si je me souviens bien. Le film possède surtout aujourd’hui une valeur documentaire indéniable, un regard sur les enfants de l’assistance publique au cœur des années 60, et un autre, tout aussi bienveillant, sur ceux qui les accueillent (des vieux magnifiques).
Airport, George Seaton (1970)
commentaire :
Le Cerveau d’acier, Joseph Sargent (1970)
commentaire :
Scènes de chasse en Bavière, Peter Fleischmann et Martin Sperr (1969)
commentaire :
février 2024
Amerika, rapports de classe, Danièle Huillet & Jean-Marie Straub (1984)
commentaire :
La Résidence, Narciso Ibáñez Serrador (1969)
commentaire :
Le Lutteur et le Clown, Boris Barnet (1957)
commentaire :
Mickey One, Arthur Penn (1965)
commentaire :
La Petite Gare , Boris Barnet (1963)
Les mystères permanents de l’incommunicabilité des humours transnationaux. Tout est forcé, rien n’est drôle. C’en est même gênant, on pourrait presque voir cinquante censeurs derrière chaque comédien pour l’inciter à sourire et être de bonne humeur. On est trente-cinq ans après La Jeune Fille au carton à chapeau. Et vous savez quoi ? L’humour du film était intégralement dû à ses deux interprètes principaux. J’aurais été curieux de voir ce qu’aurait donné Vladimir Fogel dans un film parlant. Anna Sten a fini par rejoindre Hollywood (sans grand succès). Mais ces deux-là n’étaient pas des pitres, ne forçaient rien. Ils étaient attachants parce qu’ils étaient lunaires, parce qu’ils gardaient en eux un petit quelque chose qu’ils ne voulaient pas dévoiler. La tristesse des clowns. Les comiques soviétiques auraient fait de Pierrot et de Colombine des ouvriers heureux de se tuer à la tâche. Quelle misère.
Anatomie d’une chute, Justine Triet (2023)
commentaire :
Journal d’une femme en blanc, Claude Autant-Lara (1965)
commentaire :
Note : Il arrive que le travail d’un distributeur fasse des merveilles. Ils arrivent parfois à imposer des films inconnus, largement passés à la trappe lors de leur sortie domestique, pas forcément bons d’ailleurs. Il suffit de comparer les notes sur différents médias pour le voir.
La Poupée, par exemple, de Wojciech Has. Aucune référence, pas de festival, cité nulle part, mais un film relativement mineur d’un cinéaste par ailleurs bien plus connu. Sur IMDb, autour de 650 notes, une moyenne de 6,9. Sur iCM, 59 notes pour seulement 3 favoris.
Il arrive que cela soit le fait d’une diffusion TV, mais ici je miserais plutôt sur un distributeur français : le film a bénéficié il y a quelques années de la totale avec restauration, sortie en salle, papier presse, etc. Et manifestement, le public français s’est laissé convaincre. Les critiques sont unanimes (sauf moi, mais je suis pas critique) et le nombre de notes sur SensCritique en ferait presque un classique : 149 notes, avec une moyenne qui explose celle d’IMDb, 78.
Le savoir-faire et le faire-savoir. Embauchez un bon chef de pub.
L’Exploit d’un éclaireur, Boris Barnet (1947)
commentaire :
L’universitaire et le zététicien
« L’universitaire et le zététicien, ou la rencontre improbable entre la tenante de la « science folle » (historienne du cinéma amoureuse de Freud) et le réalisateur amateur qui tel Monsieur Jourdain fait du cinématographe sans le savoir »
commentaire :
The Secret of Kells, Tomm Moore & Nora Twomey (2009)
Quel exploit d’être parvenu à mettre en scène des personnages de moines sans jamais parler de religion ! Le Moyen Âge revu à la sauce Miyazaki, voilà qui est plutôt audacieux, voire trompeur. Mais pourquoi pas. S’il y a une chose à invisibiliser dans ce monde, surtout quand on s’adresse aux enfants, c’est bien « Dieu ». Les moines ne sont donc que « copistes ». Et tant pis pour l’histoire. Les enfants découvriront un peu plus tard, à l’âge où d’autres apprenaient que le père Noël n’existe pas, qu’en des temps anciens, les hommes ont vénéré des dieux, et que c’est même pour illustrer leur vénération qu’ils construisaient des monastères, copiaient et remplissaient des pages à sa gloire. Marrant. Cachez ce Dieu qui rendrait nos mômes stupides.
Je ne sais pas si l’animisme est bien meilleur, mais au moins, c’est photogénique. Et c’est encore la principale qualité du film. Voire la seule. (Hommage à l’idiot de la version française qui a pensé qu’ajouter le nom du gamin ramènerait dans les salles les parents nostalgiques de la série Beverly Hills.)
Le Rouge et le Noir, Claude Autant-Lara (1954)
commentaire :
Tu ne tueras point, Claude Autant-Lara (1961)
commentaire :
Le Cauchemar de Dracula, Terence Fisher (1958)
Loin des versions ridicules que j’ai pu être amené à voir, celle-ci étant sans doute plus directement adaptée de Bram Stoker (avec l’usage apprécié de la métalepse que Lovecraft utilisera largement et qui est parfaitement retranscrit ici comme il le sera dans le film de Coppola – Mary Shelley l’utilisait de la même manière, me semble-t-il, dans Frankenstein). Fisher y est sans doute pour quelque chose, mais les deux acteurs principaux sont impeccables, et ce serait presque un euphémisme… Diable qu’il pouvait y avoir des garnisons entières d’acteurs de génie de l’autre côté de la Manche…
Me vient surtout une idée (elle semble m’avoir déjà effleuré l’esprit, ici ou là, dans mes commentaires) : un Dracula qui serait un agresseur sexuel, parfois un amant, dévoreur de femmes vu par les maris, et bientôt victime d’un complot sataniste visant à châtier le misérable séducteur. Je développe brièvement cette proposition ici.
Et si on oubliait nos déchets nucléaires ?, Linguisticae (2024)
Une fois n’est pas coutume. Petit commentaire sur un documentaire YouTube :
janvier 2024
Vanina Vanini, Roberto Rossellini (1961)
commentaire :
L’Étrangleur de Boston, Richard Fleischer (1968)
commentaire :
Divers :
C’est assez intrigant et révélateur de voir le succès populaire de certains cinéphiles devenus des « influenceurs » en matière de cinéma.
À une époque, tout passait par la presse, c’était des « influenceurs » de leur temps, puis l’Internet 2.0 a complètement changé les usages.
Il y a d’abord eu les forums et les blogs, aujourd’hui passés de mode, puis des sites cinéphiles de données qui permettaient, avant les commentaires ou critiques, de partager des informations. Le modèle était d’abord de remplacer l’Officiel des spectacles en donnant les heures des séances, puis de fil en aiguille, ces sites sont devenus des bases de données générales mettant à disposition d’utilisateurs enregistrés toujours plus d’applications. Les listes, les envies, les favoris, les notes et les commentaires sont arrivés.
Amazon a vite racheté IMDb, il me semble, quand en France, c’est Allociné qui a fait figure de premier mastodonte pour tous les cinéphiles allergiques à l’anglais.
Et puis, en France, alors que perso j’utilisais d’autres plateformes internationales, c’est SensCritique qui est apparu. L’équipe est composée d’ignares, mais l’outil qu’ils mettaient à disposition, une fois disposant d’une base de données fournie (ils ne l’ont jamais compris), a permis à des centaines de cinéphiles de partager notes et commentaires. Il n’y a pas d’équivalents dans le monde : dans le pays de la critique cinéma, on aime parler peut-être plus qu’ailleurs sur le cinéma. Et surtout écrire.
Un cinéphile comme Sergent Pepper avait des connaissances limitées sur le cinéma, mais sa parfaite maîtrise des outils mis à la disposition des influenceurs sur les réseaux sociaux a fait de lui une référence sur le site.
Et en plus 15 ans maintenant, sa capacité à commenter un film par jour force le respect et vaut bien n’importe quelle chronique « professionnelle » (professionnels d’ailleurs qui ne manquent jamais une occasion de discréditer les « influenceurs » de ces nouveaux usages).
Il est amusant d’ailleurs de noter qu’on peut juger de l’importance de ces nouveaux influenceurs en fonction de leur capacité à percer sur un des différents dispositifs mis en place par anciens et nouveaux médias pour exister : je ne suis pas sûr que la visibilité de Pepper sur les autres réseaux soit la même que sur SC. Une utilisatrice comme Ether sur SC, noyée dans la masse sur SC, est une référence sur Twitter. Et Nicolas Martin a rejoint des potes issus d’une « critique » plus traditionnelle. Un peu à l’image des revues ou des critiques d’autrefois, on mesure l’importance d’une référence en fonction de sa capacité à faire parler d’elle plus que par la qualité de son point de vue. Même si ça joue beaucoup et participe à ce jeu de reconnaissance et de compétition auquel ils participent volontairement ou non. Ce sera intéressant de voir l’évolution de ces pratiques dans les prochaines années. Des plateformes, des usages s’imposeront-ils pour remplacer les revues passées ? Est-ce qu’à l’image des 1ers Youtubeurs, il restera peu de place pour se faire entendre pour les nouveaux venus ?
En attendant, c’est assez heureux de voir qu’au moins pour les cinéphiles les possibilités offertes par Internet ont pu chambouler des usages et rebattre un peu les cartes de « l’influence » en matière de cinéphilie.
Contrairement à d’autres domaines, le cinéma sort vainqueur de la multiplication et de la facilité des échanges. Reste à voir si cela permettra de voir l’émergence de nouveaux regards, nouveaux discours et théories, d’abord dans la manière de voir les films, puis de les faire.
(commentaire ajouté à l’article « La voie du cinéphile connecté« .)
Mandingo, Richard Fleischer (1975)
commentaire :
Jeanne au bûcher, Roberto Rossellini (1954)
commentaire simple :
La Fille sur la balançoire, Richard Fleischer (1955)
commentaire :
Les Inconnus dans la ville, Richard Fleischer (1955)
commentaire :
Les Évadés de la nuit & La Peur, Roberto Rossellini
commentaire :
La Verte Moisson, François Villiers (1959)
commentaire :
Madeleine, David Lean (1950)
Qu’est-ce qu’on est loin des adaptations de Noël Coward… Je n’ai plus beaucoup de souvenirs des Amants passionnés ou des Grandes Espérances, mais avec celui-ci et Chaussure à son pied que je viens également de voir, on est à un haut niveau de précision dans la mise en scène, que ce soit dans le travail avec les acteurs (chaque mouvement semble soigneusement décidé, rien de superflu, à la limite parfois de l’inexpressivité pour contrarier les certitudes du spectateur), dans la direction artistique (les reconstitutions du XIXe siècle sont remarquables et tout s’agence bien à l’écran grâce à la profondeur de champ) ou dans les mouvements de caméra, des objectifs, de l’emplacement de la caméra… À croire que Lean se prend soudain pour Welles. Acteurs (tous les acteurs britanniques, à commencer par Ann Todd, sont justes et précis ; je serai moins convaincu par le bellâtre opportuniste français, mais le rôle est difficile à défendre) et équipes techniques arrivent à donner de la substance à une histoire déjà écrite mille fois. Clin d’œil au regard caméra de fin que les critiques des Cahiers ont sans doute oublié quand ils se sont émoustillés du même, jeté dans Monika (il faut dire que « le cinéma britannique n’existe pas »).