Le cinéma japonais des années 60 est décidément pas mal tourné vers sa sale guerre, assez semblable à notre 14-18 : la guerre sino-japonaise. (C’est le cadre du triptyque de Kobayashi, La Condition de l’homme.)
Comme d’habitude, on voit la volonté de montrer l’horreur de la guerre. En choisissant comme personnage principal une infirmière, on privilégie l’horreur de l’après, le carnage presque, pour y trouver assez étrangement une sorte de chirurgie du désir que certains ne trouveront pas à leur goût. On est très loin de ce que pourrait être un film patriotique. Une grande partie du film repose sur la nécessité de couper membres après membres, souvent sans anesthésie. Une boucherie.
L’autre côté du film, anesthésiant sans doute, est celui qu’on adopte en suivant le point de vue de l’infirmière. Le film ose parler d’un sujet tabou dans toutes les guerres, voire dans tous les hôpitaux. La sexualité des patients et… des infirmières. En l’occurrence de sa sexualité à elle, vu qu’il n’est pas question des autres infirmières. C’est assez troublant au début. On a du mal à comprendre où le récit veut en venir. Surtout, sans psychologie, sans volonté de la part de l’infirmière de se révolter après un premier viol collectif (qui est là suggéré alors que par la suite, on verra tout). Puis, on s’y fait. Pas la peine d’expliquer, de comprendre son comportement. Il est facile de concevoir que personne n’agisse normalement dans ces conditions de vie extrême.


Les soldats sur le front, sur leur lit d’hôpital, aussi, ont une sexualité. Même les soldats mutilés, incapables de se tripoter… Le mélange de pitié, d’horreur parfois et d’érotisme fait vraiment une sauce étrange. On pourrait être pas loin de la nécrophilie. Pourtant non, ces hommes sont bien vivants. Même le médecin désabusé, impuissant et shooté à la morphine. Et elle surtout. On ne sait rien de son passé. Pratique, pas de psychologie, rien. La guerre, c’est un monde fermé où rien n’entre et d’où personne ne s’échappe. C’est cru, mais sensuel. La chair dans tous ses états. L’infirmière a des désirs, comme les autres. Elle tombe même amoureuse… Une passion froide, clinique. On passe une envie sexuelle comme on ampute le dernier blessé : il faut que soit radical et sans sentiments. Ces sentiments tardent alors à venir. L’amour sous chloroforme, auquel on substitue la morphine. Il faut du temps pour se désintoxiquer, dans une chambre, petit nid d’amour alors que les bombes commencent à tomber. Si les soldats sont mutilés à vie, il reste un brin d’espoir pour ces deux-là, l’infirmière et son chirurgien-boucher, pour réapprendre à se toucher. L’espoir, on ne le voit pas longtemps, pour nous rappeler qu’il existe et qu’il n’appartient plus à ce monde. On rêve d’ailleurs et la guerre vous rattrape très vite. Quand ce n’est pas le sang ou le foutre qui gicle entre les doigts, les jambes qu’on ampute en remerciant de ne pas avoir perdu l’essentiel, reste le choléra pour bien vous dégoûter de la guerre.
On ne sait pas trop bien où le film veut en venir. Il peut n’être que démonstratif. Pas un film de guerre, pas un film d’amour. Il évoque juste une période noire de l’histoire. Une boucherie où le rôle des femmes, celui des femmes soldats, les infirmières, n’est pas forcément évident. L’image de l’infirmière, au cinéma, c’est souvent, le personnage implacable, l’ange impénétrable, résolu à secourir les pauvres soldats en train de crever. Bah l’infirmière, elle a aussi son histoire, et la vie des anges n’est pas rose.
Singulier et utile comme film. Ça me rappelle une infirmière qui s’était fait virer parce qu’elle avait confondu l’hôpital avec un bordel. Il doit se passer des choses étranges et indicibles dans un hôpital. L’idée de l’euthanasie est moins taboue que l’idée de la sexualité des mourants et des infirmières. Un hôpital, c’est un mouroir, c’est sérieux. On est là pour y crever. L’idée qu’on puisse s’y toucher, s’y tripoter, s’y aimer, n’est pas acceptable.


édit 2013 :
L’Ange rouge a été un de mes premiers Yasuzô Masumura et la vision du reste permet de revoir celui-ci sous un angle nouveau :
Masumura avait déjà adapté Yoriyoshi Arima en démarrant la franchise antimilitariste Yakuza Soldier avec l’acteur et producteur Shintarô Katsu (Hanzo the razor), et en l’achevant sept ans après. Je n’ai vu que ce dernier épisode, le seul sous-titré à ma connaissance, et on a encore affaire à une histoire d’amour impossible entre un soldat bourru et tête à claques — Katsu, forcément — et une espionne chinoise. L’antimilitarisme est là, comme le grotesque, les excès, l’insolence, les rebelles.
Quand on regarde sa filmographie et qu’on voit deux films comme A Wife Confesses (Une femme confesse) et Hanzo the razor, on pourrait se poser des questions… Et finalement, il y a bien un lien (une fois n’est pas coutume, je vais verser dans la politique des auteurs). On peut voir A Wife Confesses d’abord comme un film sur la résistance d’une pauvre petite bonne femme à qui on veut faire payer sa beauté, ou l’Ange rouge… comme un ange dévoué. Ce qui l’intéressait dans ces films, c’était ces personnages en marge, qui n’ont rien à faire des conventions et qui sont toujours seuls face aux autres. Ils n’ont qu’une envie : faire un doigt d’honneur à l’humanité tout entière. Ils ne veulent pas se justifier : ils vous regarderont juste avec un regard noir et iront faire des conneries pour se venger, tester leurs limites ou se prouver qu’ils existent. C’est un humour noir, glaçant, désabusé, qui est l’héritage de la fin des illusions dans une nation d’abord euphorique et expansionnisme après la sortie d’un isolationnisme forcé, après une Première Guerre mondiale gagnée aux côtés de ses futurs ennemis, après l’occupation de la Mandchourie, les horreurs du tout militaire, et finalement l’humiliation de la capitulation et de l’occupation américaine. C’est le temps des contestations (qu’on voit bien pareil également dans Le Faux Étudiant avec ce regard amer sur les petits groupes d’étudiants communistes). Il y a une certaine abdication face aux valeurs autrefois louées et vénérées (et même face aux nouvelles — comme le communisme —, on est plus dans le nihilisme). Il n’y a donc rien de beau dans « ce sacrifice de l’ange rouge » : les bons sentiments, Masumura les exècre. Alors, reste la sexualité… comme une drogue, comme de la morphine en réponse à la désolation et la perte des illusions. La seule drogue qui reste à des bêtes. Et si le médecin, en a lui, de la morphine (et si ça le rend moins animal, moins vulnérable à sa propre bestialité, à sa sexualité) les malades eux n’ont rien. Si l’infirmière « s’offre » à ses patients, ce n’est ni par « angélisme » ni par désir, c’est que tout le monde est bien malade, non pas des blessures et des amputations, mais bien d’un désenchantement généralisé : les malades comme l’infirmière.
À la même époque, il y a les films tout aussi désabusés d’Imamura. C’est même lui qui aurait un peu initié le mouvement de la nouvelle vague nippone en écrivant le scénario de Chronique du soleil à la fin d’Edo. Déjà une comédie noire et foutraque. Comme un symbole, le film se déroule, comme son nom l’indique, à la fin de la période d’isolement du Japon ; et le film semble être un doigt d’honneur aux films de Mizoguchi : assez du beau, assez de la tradition, place à la crudité nue, à la bestialité de l’homme, à sa folie destructrice. Ayako Wakao était déjà la rebelle en 1956 dans le dernier film du maître. En 1957, Imamura écrit donc Chronique du soleil et Ayako retrouve pour la première fois Masumura dans Ao-zora Musume. Si Masumura est parfois un peu baroque (et le sera de plus en plus, jusqu’au mauvais goût), Imamura était, dans ces 60’s, complètement rock’n’roll. Les deux sont dans la contestation, l’insolence et ont ce désir de montrer les bassesses des hommes et de la société. Le regard noir porté sur le monde, toujours. Les hommes sont des monstres grotesques…
















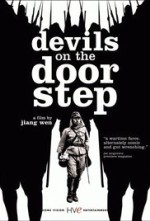
















 Année : 1988
Année : 1988
















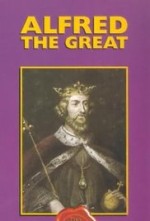 Année : 1969
Année : 1969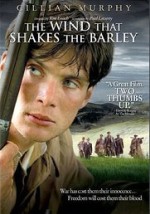
 Année : 2006
Année : 2006