Cinéma dans le miroir
Film finement baroque.
C’est d’abord le récit qui adopte une technique de destins parallèles finissant dans un climax attendu par en partager un commun. Avec ses différentes variantes, la technique est héritée des chroniques, du théâtre brechtien, des pièces de Shakespeare ou de bien autres choses encore. Au cinéma, les destins croisés ne sont pas inédits alors que le principe du montage alterné a façonné sa grammaire et son histoire : si on en reste aux destins parallèles partageant une temporalité et un espace communs, Street Scene de King Vidor, par exemple, ou Went the Day Well?, mettaient ainsi en parallèle différentes aventures urbaines.
Plus tard, ce type de récit reviendra périodiquement à la mode : alors que (de mémoire) la science-fiction des années 50 en faisait déjà usage pour montrer les effets d’une invasion au sein de la population d’une même ville (Body Snatcher, Le Village des damnés, Them!, Le Jour où la Terre s’arrêta…), le mélodrame (genre ô combien baroque), bientôt suivi par sa variante télévisuelle (le soap), l’adoptera dès les années suivantes (Les Plaisirs de l’enfer, notamment, mais aussi, la même année, La Toile d’araignée, et plus tard, La Vallée des poupées). Dans les décennies suivantes, ce sont les films catastrophes qui mettront le procédé à profit (c’est très utile pour multiplier les courtes apparitions d’anciennes vedettes : on pense à Fred Astaire dans La Tour infernale ou à Ava Gardner dans Tremblements de terre). Enfin, c’est bien entendu Tarantino qui joue pour ainsi dire presque toujours dans ses films avec les destins croisés et qui en relancera la mode dans les années 90.
Le baroque, ensuite, concernant la forme, pour le coup, inédite, du film de Fleischer. On adopte ici le Technicolor et le Cinémascope, une première pour ce type de films (thriller à petit budget avec une patte ou une ambition mélodramatique, voire sociale et psychologique, comme pouvaient l’être les films de Douglas Sirk ou certains drames de Vincente Minnelli, à commencer par La Toile d’araignée, déjà évoqué et sorti la même année).
Lors de sa longue carrière, Fleischer est connu pour avoir touché à tout, à tous les genres. Et en réalité, il est presque toujours en marge des genres qu’il aborde, travestit et entremêle. Une caractéristique du baroque. Son premier film sur le drame que vit une petite fille au divorce de ses parents était déjà, et reste encore, un film « sans genre ». Ses thrillers ou séries noires/b mêlent habilement l’âpreté du noir, la comédie avec des répliques cinglantes (Bodyguard, par exemple, ou ici avec ce Violent Saturday) et une ou deux histoires de cœur qui traînent. On retrouve ce mélange des genres ici. Film de hold-up, tout ce qu’il y a de plus traditionnel, sauf que justement, l’habituel film noir se serait focalisé sur les seuls criminels (ça ne fait pas toujours de bons films, au hasard, Le Cambrioleur, avec Jayne Mansfield et Dan Duryea).

Dans Les Inconnus dans la ville, on prend un pas de recul, et comprenant vite les intentions des malfaiteurs (suspense oblige), on regarde, attentifs, la patiente description des victimes collatérales de leur hold-up qui a de bonnes chances de tourner mal (sans quoi on n’y prêterait pas autant attention). Cette manière décalée, baroque ou épique (au sens brechtien : on refuse le spectaculaire et on cherche à dévoiler ou à analyser le cheminement social et psychologique des personnages) et que certains nomment déjà « soap », proche de la tonalité des films catastrophe des années 70 (le calme avant la tempête, les petites histoires faussement futiles des uns et des autres amenées à devenir tragiques, à la Rashômon, en croisant le chemin de quelques criminels), j’y ai vu surtout une appropriation du style Tennessee Williams.
En dehors de l’aspect moite et suintant de la Louisiane de Williams, on y retrouve la névrose des bourgeois ou des habitants d’une même communauté incapables de vivre entre eux. On y voit encore les difficultés des petites gens à préserver les apparences d’une vie ordinaire et conforme aux codes de la communauté, leur recours à des activités illicites pour s’en sortir, et surtout les amours contrariées par l’alcool et par le besoin de fuir les habitudes du cercle conjugal.
On sombrerait effectivement dans le soap si les acteurs en faisaient des tonnes. Mais Fleischer avait déjà démontré sa capacité dans ses films noirs à choisir des acteurs puissants tout en leur imposant de jouer la douceur et la finesse. Depuis l’Actors Studio, on sait que l’on n’a plus besoin de forcer pour passer à l’écran, ni même de prononcer chaque expression : la psychologie passe aussi par une forme d’incertitude et une perméabilité feinte des sentiments (appelée bientôt à craquer). On peut frimer un peu, gesticuler comme peut très bien le faire Lee Marvin (attaché à son stick déboucheur de nez depuis qu’il dit ne pas s’être remis d’un rhume refilé par son ex-femme — voilà qui est très « Actors Studio »), mais là encore, tout se fait en douceur.
Richard Egan, de son côté, en alcoolique mélancolique, charmeur et désabusé, est dans la lignée des autres personnages à la virilité affichée mais contrariée des films de Fleischer (Charles McGraw, Lawrence Tierney, Mitchum, Kirk Douglas, Victor Mature, Anthony Quinn…), capables de jouer sur autre chose que le muscle ou les vociférations.
Les coups d’éclats sont réservés aux répliques. Et si dans le récit, on retrouvait un peu de Tarantino, eh bien, dans ce baroque où les dialogues précèdent la violence, on est déjà un peu également dans du Tarantino. Ou du Sergio Leone. Voire du Charley Varrick. « Quand tu dois tirer, tire ! Cause pas ! »
De quoi peut-être se demander si ce baroque, ce n’est pas aussi finalement ce que certains nomment parfois « modernité ». Un cinéma qui se sait faire du cinéma. À la manière déjà du théâtre de Brecht, un cinéma conscient des effets qu’il produit, et ne manque pas de le faire savoir. À travers parfois des références. Car oui, je m’aventure peut-être un peu, mais à l’image d’un Tarantino, on croit presque voir dans Les Inconnus dans la ville un cinéma déjà de références, un cinéma de cinéphile conscient de l’histoire qui le précède, soucieux de rendre hommage aux films passés tout en ne manquant pas une approche nouvelle.
Même si parfois, les références que l’on pense voir au premier coup d’œil se révèlent impossibles. On est au cinéma, si on les rêve, c’est donc bien qu’elles existent.

L’acteur qui joue le môme de Victor Mature, par exemple, c’est celui de La Nuit du chasseur, un film qui commence avec les conséquences d’un hold-up ayant mal tourné. (Le film de Laughton est sorti quelques semaines après le film de Fleischer).
Sylvia Sidney, qui joue ici la bibliothécaire avec des soucis de portefeuille, avait tourné une quinzaine d’années plus tôt dans Casier judiciaire, un film de hold-up de Fritz Lang qu’elle parviendra à faire avorter grâce à une leçon de mathématiques morales.
Le personnage de héros malgré lui qu’incarne Victor Mature n’est pas sans rappeler celui de meurtrier repenti de Rock Hudson dans Victime du destin ou le shérif blessé de Duel sans merci (ici, Stephen McNally, toujours aussi flegmatique et sans la moindre once de fantaisie, passe du shérif au leader des malfrats). Lee Marvin retrouve le rôle de sadique qu’il a déjà pu jouer chez Don Siegel. Et le banquier voyeur rappelle le banquier, encore plus tordu, du Tueur s’est évadé : les mêmes limites du sadisme refoulé, le même animal à lunette (le film est tourné l’année suivante).
Il y a quelque chose de pourri à Hollywood. Les criminels reviennent à la fête. Et ils refusent de faire leur entrée par la petite porte de derrière. Et s’ils meurent, il faut que ce soit désormais en Technicolor et en Cinémascope !
Bientôt en crise, Hollywood ne sera jamais aussi bon que quand il semble porter un œil critique sur lui-même, quitte à se prendre comme référence : ce sera par exemple le cas dans un style tout aussi baroque, contemporain de Sergio Leone, de Cinq Cartes à abattre. Johnny Guitar aussi avait déjà bien montré la voie : porter un regard sur le cinéma, c’est aussi s’en moquer et prendre ses distances avec un genre pour lui insuffler une nouvelle jeunesse. Rio Bravo, quatre ans plus tard, proposera aussi une toute nouvelle conception du temps à l’écran.
Alors, oui, il pleut des références, et toutes sont un peu forcées et anachroniques. Plus que des références, alors, faut-il y voir un souffle « moderne » à Hollywood ? Se sentant mis en danger par la télévision, les studios commencent à vaciller et les restrictions du code passent au second plan. Le sadisme peut bien s’afficher plus volontiers chez Siegel, Hathaway, Aldrich et donc Fleischer, qu’importe s’il attire du public dans les salles. Et cela, jusqu’à la panne sèche. Les superhéros d’alors sont les névrosés. L’Institut Xavier réunissant la fine fleur des superhéros dans X-Men aurait été dans les années 60 un asile psychiatrique. Ainsi, au tournant de la décennie, ce qui était alors « moderne » ou « baroque » se transformera comme un vieux masque rouillé en alléluia du n’importe quoi. L’épiphanie des extravagances et des excès n’est pas pour tout de suite, si Les Inconnus dans la ville est une réussite, c’est précisément qu’il se trouve parfaitement entre les audaces nécessaires à l’établissement d’une nouvelle proposition de cinéma et les outrances répétées d’une époque ne sachant plus quelles limites dépasser pour attirer l’attention du spectateur.
On pourrait presque voir avec Les Inconnus dans la ville l’avis de décès imminent du film noir. Le genre était indissociable du noir et blanc et des stéréotypes moraux imposés par le code Hays. Le baroque (ou la modernité) du film de Richard Fleischer prouve que le thriller pur, ou le film noir (comme on ne l’a jamais appelé dans les studios), dépouillé des notes mélo-socio-psychologiques des Inconnus dans la ville, pourra tout à fait se conjuguer avec les caractéristiques que l’on croyait réservées aux séries A. Il faudra alors plus volontiers parler après de néo-noir pour les thrillers en couleurs à venir.
Quant à la violence (bien avant Bonnie and Clyde qui dépassera bien plus les usages de la violence au cinéma que le film de Fleischer), on la sent déjà poindre d’une manière qu’on n’avait peut-être plus vue depuis l’époque pré-code (du moins, dans des films de studio de premier plan). En cela, peut-être, le film (mais c’est toute l’époque qui est ainsi) annonce une ère nouvelle : l’ère où Hollywood ne peut plus composer avec la concurrence du petit écran et avec les restrictions d’un autre âge. Ce qui était autrefois réservé aux séries B va peu à peu se généraliser aux films de plus grande importance. D’où les années suivantes particulièrement baroques où des moyens bien plus colossaux que ce que l’on peut voir ici sont déployés pour illustrer des personnages toujours plus tordus et névrosés. Et la transformation sera totale dans les années 70 quand certains grands succès de l’époque seront des thrillers à grand spectacle (avec des variantes paranoïaques).
Pour finir : hommage à la technique, habile et expéditive (tout en étant non-violente) d’un des trois malfrats pour faire taire un gamin un peu trop grande gueule. Mon ex avait adopté la même technique lors de ses conférences où des gamins se trouvaient malgré elle impliqués. Elle avait même un budget alloué pour leur clouer le bec. C’est que j’en ai bouffé aussi des bonbecs. (Je ferais bien de revoir le pedigree de mes fréquentations. Qui veut finir une fourche nichée entre les omoplates ?)















 Année : 1964
Année : 1964















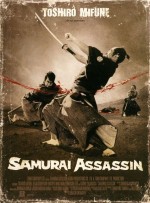


















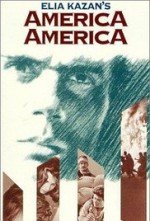 Année : 1964
Année : 1964
