Il faut l’avouer, quand on est amoureux des belles choses…, il est instructif de réévaluer certains films à la lumière de ses contemporains, de ses petits frères, tous oubliés — eux, éventuellement — pour de bonnes raisons. L’occasion donc de ré-étalonner la valeur des choses, et ainsi mieux comprendre, peut-être, ce qui fait de ces œuvres, des œuvres uniques et indispensables. Quand on s’intéresse à l’histoire de la représentation, en particulier au cinéma, ce genre de films (médiocres), si on sait ne pas en abuser, recèle des trésors inattendus ; c’est que bien qu’étant des objets affreusement quelconques, ils peuvent contenir malgré eux des informations éclairantes sur une époque oubliée ou méconnue du cinéma, ou tout simplement sur une époque qu’on n’a pas connue.
Ainsi, par exemple, il y a dans ces hésitations de mise en scène, dans cette approximation (inhérente à la métamorphose que le cinéma était en train de produire), une variété de déchets qui donne le tournis (les archéologues adorent les déchets). Les attitudes, les cadrages, le rythme, le découpage, le design, le jeu des acteurs, tout trahit la réalité d’une époque. C’est à ça que servent les codes, à se programmer des trajectoires, des routines, des usages, capables d’éviter ces erreurs grossières (on risque alors le formatage, mais c’est une autre histoire).
Si ces « déchets de réalité » ont une si grande importance ici, c’est que pour la première fois, on a avec le cinéma parlant la retranscription quasi crédible du monde telle qu’on le perçoit. En devenant parlant, le cinéma rend le spectateur un peu moins sourd. Ne lui manque plus que la couleur, mais déjà, avec le mouvement des images et le son, le pouvoir de fascination est total. Il faut donc imaginer l’émotion des spectateurs face à cette vision du monde qui s’offrait pour la première fois devant leurs yeux. Plus réelle que les photographies, plus réelle que le cinéma muet, et plus réel aussi qu’un film maîtrisé, résultat d’un savoir-faire qui a précisément pour objet de gommer tous ces déchets propres à la banalité du monde. Si ces premières images animées et sonores pouvaient sidérer le spectateur de l’époque, elles nous sidèrent aujourd’hui pour tout autre chose. D’abord bien sûr par la médiocrité de leur composition, mais surtout, encore une fois, par la retranscription accidentelle d’un monde, celui des années 20, qui ne s’était jamais laissé approcher avec une telle authenticité par le passé, et qui fuira très vite les écrans dès qu’on adoptera certaines habitudes ou codes de tournage.
L’un des aspects les plus amusants dans ce spectacle des médiocrités qui se joue devant nos yeux comme à travers le trou de serrure du temps, c’est la manière dont est retranscrit « le rêve américain ». Parce que si on sait que tout ce qui est lié à ce rêve, et en particulier à New York ou à Broadway, réveille chez les spectateurs d’aujourd’hui quelque émoi, on sait par ailleurs que ce rêve n’est qu’un leurre. Très tôt pourtant, les films hollywoodiens nous ont révélé cette illusion à travers l’exposition souvent innocente de ce qui se joue en dehors de la scène et des projecteurs. Mais il y a ce qu’on sait parce qu’on nous l’a appris, et ce qu’on sait par ce que l’on voit et le comprend par nous-mêmes. Or, ce rêve, à la lumière de ces « déchets de réalité » peine à être crédible. On sent bien que le film cherche à nous le vendre, pourtant entre ce qu’on nous dit et ce qu’on voit, rien ne correspond. On se trouve alors comme face à ces nouveaux riches qui, en d’autres périodes, qu’ils soient russes, chinois ou qataris, ne font qu’exposer leur désir de paraître. Paradoxalement, le folklore US tel qu’on le connaît, maladroitement retranscrit ici, ne nous apparaît jamais aussi crédible que quand il sent fraîchement le carton-pâte.


Dès la seconde séquence, en nous vendant du rêve, on ne voit que cauchemar.
Les deux personnages principaux arrivent dans leur chambre d’hôtel à New York ; elles se rêvent actrices à Broadway, elles ont le sourire, tout va bien malgré leurs poches, leur estomac et leur tête vides… On pourrait se dire que ça correspond au folklore américain. Sauf qu’émane de cette scène une sorte de solitude froide, d’angoisse sourde et pesante, qui ne tient qu’à la manière dont l’espace nous est représenté. Plus qu’une chambre d’hôtel, il s’agit plutôt d’un appartement, ni trop grand ni trop petit, ni luxueux, ni miteux, juste impersonnel et confortable comme il devait en exister « réellement » à New York à la fin des années 20. Un hôtel, me dira-t-on, est forcément impersonnel, et en quoi le confort serait-il un problème ? Eh bien, concernant l’hôtel, le problème vient surtout du fait qu’on n’a aucune idée du contexte. Ce n’est pas qu’il est impersonnel pour être impersonnel, c’est qu’il est impersonnel parce qu’il n’existe pas : aucune vue d’ensemble, aucune vue de transition montrant l’arrivée des filles en bas de l’immeuble ni à la réception. Juste un carton pour nous dire « vous êtes dans un hôtel ». C’est juste flippant. Imaginez, vous vous réveillez dans une chambre, on vous dit que vous êtes dans un hôtel, mais vous ne voyez rien d’autre que cet appartement qui pourrait tout aussi bien être… situé dans une cave ! Il ne suffit pas de me le dire (ou l’écrire), il faut me le montrer pour que j’y croie ! Ainsi, quand les deux actrices regardent par la fenêtre et rêvent de « se voir en haut de l’affiche », aucun contrechamp pour nous montrer la rue, les immeubles d’en face, nous vendre du rêve, le leur ! Et le confort pose un problème justement parce qu’il fait faux, on ne peut y croire. Le luxe ostentatoire fait rêver, mais le miteux aussi ! Le mythe de l’artiste maudit, l’atmosphère des petites chambres où les bas sèchent sur les abat-jours à 15cents… La promiscuité, le charme et la sueur presque latins. La vie de Bohème ! On verra tout ça dans les films qui suivent, et on l’a vu dans les muets qui précèdent. Non là, ça sent grave la réalité, le rêve américain comme il est (ou devait l’être) dans la vraie vie : un cauchemar de solitude. « Fais-toi tout seul ! ». C’est bien ça. Tout seul. Pas de voisin insupportable, pas de rue bruyante, pas d’humidité aux murs, pas de vie. La mort, le silence. Démerde-toi, et surtout, crève dans ton appartement, on n’en saura rien, il est insonorisé, désinsectisé, désinfecté, hermétique au monde comme à nos cœurs.
Voir ce film, ça a dû en déprimer plus d’un à l’époque… Si, si ! Ils ont dû voir les auditions désertées et les acteurs se suicider (certains découverts dix ans plus tard, le corps parfaitement intact et prêt à pavaner chez Madame Tussauds en laissant une note d’hôtel à 20 000 $). Parce que pour les films suivants, les acteurs itinérants arriveront souvent dans des pensions d’artistes. L’occasion de décrire une galerie de personnages autrement plus vivants que ceux qu’on trouve chez Madame Tussauds… Du folklore… Des personnages qu’on prendra plaisir à voir aimer se haïr… Parce que quand on aime se haïr (c’est souvent de la jalousie ou des querelles de vieux couples), c’est qu’on s’aime, c’est qu’on ne laisse pas indifférent. Pour un acteur, haïr, c’est exister ; mourir, c’est dormir, rêver peut-être… En tout cas, c’est être indifférent au regard des autres. Quoi de plus mortel pour des acteurs qu’une chambre d’hôtel impersonnelle ?
Alors voilà, ce Broadway Melody sonnerait plutôt en fait comme une oraison funèbre.
Autre particularité « réaliste », et cassant tout autant l’idée du rêve américain : l’évocation des répétitions. Dans l’esprit du spectateur, ouah, on va voir des répétitions, l’arrière du décor, c’est magique ! Sauf que pas du tout. En vrai, ce n’est pas glorieux (c’est comme quand on se prépare pour un combat de boxe, on n’a pas toujours Eye of the Tiger au cul des oreilles). Et dans le film, ce n’est pas glorieux non plus. Ça doit être fait tout à fait innocemment : « Voici comment on bosse à Broadway, ça vous fait envie n’est-ce pas ? » Eh ben, non, merde, de la sueur, de la mauvaise ambiance, et pis surtout… des numéros franchement pas au point. « Eh, bah, c’est qu’on répète, c’est normal ! » Oui, et quand une vedette de cinéma est filmée au lever du jour, on la montre mal coiffée et non maquillée ? Eh, MGM quoi !… On ne voit pas Garbo lever le doigt pour une pause pipi !… Bref, plus tard, on verra que quand on montre des répétitions, les numéros sont toujours… déjà au point (c’est con, mais en plus ça ne m’avait jamais titillé l’esprit, pourtant le metteur en scène on l’y voit les reprendre, mais nous, on ne voit rien — l’exigence légendaire des chorégraphes de Broadway sans doute…). Le voilà donc le rêve (et le mensonge) américain : la vie facile. On répète, et ça doit être parfait. Et là, non. C’est un cauchemar tellement ça fait amateur…


Un des premiers films sonores oblige, on n’échappe pas aux approximations des débuts ou aux impératifs d’une technique (ou d’ingénieurs du son) pas encore… au point. Là encore, on imagine la difficulté pour les acteurs, le metteur en scène et le studio, de juger de ce qu’ils voient et surtout entendent. Sans autre repère, sans pouvoir comparer… Le résultat est donc étrange. Souvent dans les premiers films sonores, on sent le passage entre les parties sonores et muettes, comme si on ouvrait les robinets, les lavabos, et glou et glou et glou… Pas de ça ici, au contraire, tout semble sonorisé. Non, le problème, c’est que la prise sonore s’est faite trop loin. On n’entend qu’un son d’ambiance, et il se trouve que parmi ces sons, on capte les voix des acteurs (qui sont donc obligés de jouer comme au théâtre pour se faire entendre). Ça donne une impression étrange, mêlée de réalisme et de distance. D’être là sans l’être vraiment. Comme invité, de trop, ou de passage dans une salle de bains qui n’est pas la nôtre… Manque donc l’intimité de la capture du son prise à la commissure des lèvres, aux premières gouttes de bave, dans cette bulle de l’acteur que les spécialistes nomment « le postillon ». Cette proximité avec l’acteur, le personnage, ne laisse aucun doute sur notre omniscience. Notre regard n’est pas celui, distant, de celui qui observe, caché avec la peur de se faire attraper, mais celle du narrateur qui voit et peut tout savoir. La réalité, face à la magie du rêve.
Par souci de réalisme (moi aussi, je répète), on y montre également les acteurs littéralement (ou presque) se chier dessus avant d’entrer en scène. C’est tout à fait exact (la fameuse odeur des coulisses qui mêle sueur de six mois, poussière du siècle dernier, chaleurs de terreur, sperme de quatre jours, café froid, cendre de cigarettes, préparatifs pyrotechniques, cuir moisi, taffetas brûlé, et donc… trou de mémoire). Sauf qu’il n’est probablement pas très judicieux de le montrer ainsi au public. Que les acteurs aient le trac, le public s’y attend, mais il faut le montrer de manière positive. Le trac, ça revigore les sens ! ça exalte ! ça électrise !…
Les revues présentées, et en particulier les éléments qui les composent (ces machins insaisissables et éphémères qu’on appelle « acteurs »), puent l’amateurisme. Là encore, c’est sans doute très réaliste, sauf que ça ne vend toujours pas du rêve. Les canons de beauté n’ont pas officiellement changé (c’était le 24 mars 1931 à midi pour les tatillons), et pré-code oblige (même les statues grecques sont pré-codes, en vrai), on se paie le luxe de voir de beaux morceaux, bien blancs, bien gras, se dodeliner sans grâce ni coordination. On sera plus regardant par la suite quant au casting des petites fesses musicales…
C’est que le manque de repère, sans doute, laisse croire à la possibilité de réinventer des codes nouveaux. Ce qui est en partie vrai, mais certains principes demeurent les mêmes. La découverte du son permet de s’émouvoir des moindres bruits, et on en vient à montrer l’insipide, à se focaliser sur le détail, un peu comme on devait s’émouvoir des premières images animées. On peut comprendre que tous soient un peu perdus (ou intimidés), mais le parlant, s’il peut en effet adopter des usages particuliers, ne répondra pas autrement à d’autres principes qui sont, là, communs à tous les arts de la représentation : la nécessité du rythme, l’inventivité, la justesse de ton, le respect des enjeux, la rigueur dramatique, la mise en évidence des points forts…
Par exemple, les transitions doivent, quel que soit l’art dans lequel on s’exprime, user d’une ponctuation pour souligner la structure du récit, imposer des respirations et offrir au spectateur des images reconnaissables lui permettant de comprendre où il se trouve. Or, ne sachant trop se situer, le film réutilise des éléments devenus inutiles du muet pour les utiliser de manière pas du tout appropriée, et ne propose aucun des artifices de ponctuation qui seront utilisés par la suite. L’effet produit sur un spectateur d’aujourd’hui est plus qu’étrange. Ce ne sont pas seulement ces cartons qui viennent s’insérer bizarrement pour dire comme chez Shakespeare où on se trouve, mais c’est par exemple l’absence de musique d’accompagnement. Le procédé n’a pas été inventé par et pour le cinéma, il existait déjà très probablement dans les vaudevilles et les revues à Broadway pour passer d’une scène à une autre… Donc là, carton ou pas, on se trouve un peu perdu entre deux séquences, et plus encore à l’intérieur, car le découpage technique, sans avoir la créativité des dernières heures du muet, n’adopte pas plus le découpage, déjà en vigueur dans la plupart des films muets et qui s’est imposé par la suite dans toutes les productions de l’âge d’or hollywoodien. Les raccords dans le mouvement, dans l’axe, les contrechamps de réaction, tout ça c’est de la chimie qui permet de recréer une impression de réalité tout en gommant ces affreux « déchets réalistes » qui sont communs à toutes les productions médiocres (le savoir-faire, c’est précisément d’arriver à fixer sa caméra et donc l’attention du spectateur sur des mouvements essentiels au lieu de lui mettre sous les yeux des mouvements parasites qui brouillent le message).
Le film souffre aussi d’un scénario calamiteux. L’histoire n’est pas si mauvaise (Edmund Goulding en est l’auteur). Mais les dialogues ne sont pas d’un grand raffinement et peinent à trouver le bon rythme (on ne le comprend sans doute pas encore mais au contraire du théâtre où on peut s’étendre, là, il faut aller à l’essentiel). Du coup, on se pose dans une situation et on attend presque que les choses se passent. Manque cette situation d’urgence qu’on retrouve plus tard dans la plupart des grands films (et déjà présente au muet).
(Je juge en fonction de ce qui vient immédiatement après, à savoir, les codes du cinéma classique qui s’établissent très vite dans les années 30. Quand on regarde un Altman par exemple, il aime utiliser cette distanciation, mais ces histoires sont souvent des chroniques avec des enjeux propres à chaque personnage et inconnus souvent du spectateur ; alors qu’ici, l’argument est tout à fait classique : les enjeux, on les connaît, ils ont été présentés dès les premières scènes).
Il y a à parier que la production ait été pressée par le temps (le film avait commencé à être filmé en muet) et dans cette situation, difficile non seulement de se faire écrire des dialogues de qualité, mais surtout d’avoir assez de recul pour comprendre qu’autant de dialogues si superficiels et mal (ou pas du tout) décomposés (soulignés) par le découpage ne laisseront qu’une impression de spectacle lointain, étranger au spectateur. L’impression de réalisme due à tous ces éléments mis bout à bout a probablement joué à l’époque un rôle important dans la perception du film, en provoquant cette sidération commune à toutes les avancées techniques dont on devine immédiatement l’importance, mais ce qui saute aux yeux surtout aujourd’hui, ce sont ses défauts.
Dernière particularité (et faiblesse quand on connaît la suite). Le choix de se focaliser sur l’aspect dramatique. La présence du producteur nommé Zanfield ne trompe pas, on privilégie l’aspect « revue » par rapport à la comédie. L’un des numéros présentés est même très « opératique », loin de ce qu’on présentera par la suite dans les films du genre. L’esprit « comédie musicale » n’est pas encore là, celui des vaudevilles, celui des petits artistes pouvant se faire un nom du jour au lendemain grâce à un numéro qui sera intégré entre deux séquences dénudées… et chorégraphiées… On y voit certes un ou deux personnages chargés d’amuser, seulement il semblerait qu’au lieu de choisir des artistes rodés sur un numéro, le leur, comme on le fera par la suite, ou de s’appuyer sur des seconds rôles de génie (comme Una Merkel, pour ce qui est précisément des Broadway Melody suivants), on ait fait confiance aux dialoguistes… Et comme, à travers son découpage, Harry Beaumont ne semble pas du tout intéressé par ces dialogues, aucune chance de nous divertir par ce biais.
Thalberg était pourtant aux commandes de la production (peut-être pas assez justement). Tout comme Cédric Gibbons, designer principal de la MGM (et on sait à quel point le design jouera un rôle important par la suite, non seulement pour la MGM mais pour toutes les autres compagnies). La dernière demi-heure du film est sur ce plan plutôt satisfaisant (mais loin des futurs standards) alors que les séquences de coulisses paraissent trop réalistes (tourné in location sans doute ou tout simplement mal filmées).
On sait que ce passage du muet au parlant a été crucial pour de nombreux acteurs, et il est probable que pour beaucoup d’entre eux, pas aidés par les circonstances (dialogues moisis, techniques approximatives, metteur en scène aux noisettes), ait fini par disparaître injustement. Ça ne semble pas être le cas ici cependant. Charles King est plutôt minable et ne fera rien par la suite. Anita Page est assez quelconque pour être gentil (morte en 2008…). Bessie Love en revanche, bien qu’affreusement employée ici (comme tous donc, mais elle a clairement plus de talent que les autres) aura une carrière bien remplie.
The Broadway Melody, Harry Beaumont (1929) | MGM




 Année : 1948
Année : 1948











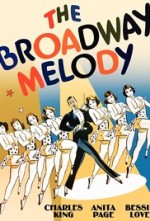















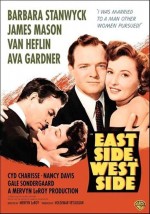





 Année : 1941
Année : 1941

















