Il faut qu’une porte reste ouverte ou fermée

The Royal Family of Broadway
Année : 1930
Girls About Town
Année : 1931
Réalisation : George Cukor
Avec : Ina Claire, Fredric March, Mary Brian, Henrietta Crosman
Avec : Kay Francis, Joel McCrea, Lilyan Tashman
C’est fou les progrès que l’on peut produire en l’espace de quelques semaines. Le cinéma parlant se distingue singulièrement du muet, tout était à réinventer, et rares sont les réalisateurs ou les studios qui ont compris instantanément les pièges de ce nouveau théâtre filmé.
En quelques mois, on produit des films à la va-vite à partir de pièces de Broadway, et le tour de force du système hollywoodien a consisté alors à trouver les failles dans ces ratés et à y proposer des solutions avant la concurrence. Si, à l’âge du muet, les recherches formelles et les superproductions avaient fini par prendre le contrôle du paysage cinématographique (en dehors de quelques acteurs comiques auquel le public s’était attaché), avant cela, c’était bien le burlesque (ou slapstick) qui avait inventé les codes de la réalisation (on a trop donné à mon sens d’importance à Griffith ou aux drames/thrillers en général, mais c’est une constance, on ne prend pas au sérieux… les rigolos). C’était, en gros, ma thèse dans mon article « Charlot grammairien ».
Pour faire simple, réaliser une séquence burlesque dépendait autant de l’exécution de l’acteur que du montage. Au théâtre, l’acteur est maître du rythme. Or, sans rythme, pas de comédie. La comédie, c’est la rupture, la surprise, la mise en opposition. Quand vous regardez une scène de commedia dell’arte ou un numéro burlesque, tout est déjà question de montage et de rythme. C’est donc naturellement que les premiers réalisateurs de slapstick (surtout le Chaplin de la première heure, d’après ce que j’ai pu en voir) se sont servis du montage pour cadrer leurs effets. Cadrer, dans tous les sens du terme.
Le poids du slapstick déclinant à la fin du muet, on peut comprendre la panique à l’arrivée du cinéma parlant. Au public étaient proposés des comédies ou des succès de Broadway parfois bien éloignés du burlesque (mais pas toujours : le cinéma parlant a permis aux Marx Brothers de s’imposer très vite dans ce support naissant qu’était le cinéma parlant). Qui détenait les codes de ces nouvelles comédies portées à l’écran ? Bien sûr, la règle des 180 degrés, celle des échelles de valeurs de plan ou la problématique des raccords, tout cela était déjà parfaitement connu. Mais comment réaliser une comédie désormais majoritairement propulsée par des répliques ? Le rythme, c’est une chose, mais la comédie tolère moins que le drame certaines libertés ou l’absence même de codes (on appellera ça, éventuellement, du « naturalisme », si ce n’est, plus généralement, de l’incompétence). La comédie ne se résume pas à un genre, c’est un langage : tu maîtrises certains principes et c’est drôle, tu ne les méprises pas, et ta comédie tombe à plat.
Les ratés, lors de ces premiers essais et premiers mois du cinéma parlant, proliféraient à l’affiche. Il suffirait presque d’éplucher la filmo des réalisateurs plus ou moins connus ou appelés à le devenir durant ces deux premières années (1930, 1931), et assurément, quelques rares chefs-d’œuvre émergeraient d’une forêt de films inaboutis. On a souvent pointé du doigt (et moqué) les acteurs du muet, incapables de faire face à une tout autre manière de jouer. Mais ils étaient les plus exposés et le cinéma a même entretenu cette légende qu’ils étaient les seuls à devoir s’adapter (Chantons sous la pluie, par exemple). Derrière eux, tout le système de production a en réalité dû réapprendre à réaliser des films. À faire des comédies. Si la facilité et la concurrence ont poussé les studios à adapter des succès de la scène new-yorkaise ou européenne, ils ont vite dû se rendre à l’évidence. Filmer une comédie, fût-elle un succès, ce n’est pas illustrer un texte avec des images et quelques stars.
En deux films de George Cukor réalisés plus ou moins coup sur coup, c’est ainsi cette évolution rapide qui se trouve remarquablement mise en lumière. Le premier (The Royal Family of Broadway) se vautre… royalement ; le second, sans être un chef-d’œuvre, présente beaucoup des codes des comédies réussies de cette époque pré-Code, dont une partie sera réemployée dans ce genre plus spécifique, déjà plus cinématographique, qu’est la screwball.
Espace scénique unique = théâtre / transparence = cinéma
Je dispose de mes propres codes, et souvent, pour illustrer un propos qui tourne en boucle d’une critique à l’autre, j’en reviens souvent à cette question simple : qu’est-ce que le cinéma ? La même réponse réapparaît alors toujours : le montage. Si je développe encore : qu’est-ce que le montage ? Je réponds : le rythme, la rupture, le montage alterné, la suspension, la grosseur de plan. Voilà quelques-uns des éléments essentiels constitutifs de la spécificité du cinéma, mais on pourrait en ajouter d’autres : la contextualisation et… les portes.
Qu’est-ce que le théâtre ? Un espace ouvert (la scène) où les portes claquent soit en coulisses, soit en ouvrant vers les coulisses. Dans un décor de théâtre, à moins de disposer de mécanismes sophistiqués (à la manière des productions totales et grandioses de Max Reinhardt à Berlin ou de Florenz Ziegfeld à Broadway), au mieux, on change d’espace une fois par acte. Le reste du temps, tout se passe donc au même endroit. Dans le théâtre de boulevard (encore aujourd’hui), on représente ainsi sur scène un grand espace ouvert vers le public, lui-même souvent compartimenté en aires de jeu plus petites. Cependant, tous ces espaces sont interconnectés : pas de cloisons, pas de portes. Rien de réaliste là-dedans, c’est une convention. Les acteurs se transportent d’une pièce à une autre sans rencontrer la moindre porte. Quand porte, il y a, elle ouvre sur les coulisses dont l’espace reste, par définition, invisible du public.
Quand les studios s’agitent donc tout d’un coup pour acheter les droits des spectacles de Broadway, qu’est-ce qu’est devenu le cinéma ?… Réponse : un espace ouvert où les portes claquent en coulisses.
Où sont les portes ?
Avec leurs gestes pleins de formes…
Dites-moi où sont les portes.
Portes, portes, portes, portes.
Où sont les portes ?
À la fois si belles et si plates.
Aux gonds qui traînent et qui planent.
Où sont les portes ?
Portes, portes, portes, portes.
Où sont les portes ?
C’est vrai ça, Patrick : où sont donc passées les portes dans The Royal Family of Broadway (1930) ? Eh bien, je crois n’en avoir compté qu’une. Et encore, elle se refermait sur un hors-champ invisible. Comme au théâtre. Évidemment : si je réclame des portes, c’est qu’elles vont vite devenir indissociables du cinéma (j’en avais parlé pour le film Attends-moi). N’imaginez pas un quelconque fétichisme. Je ne vais pas répéter ce que j’ai dit ailleurs : à moins de pouvoir réaliser un film dans de grands espaces, le cinéma (donc le montage) ne connaît pas d’outils plus essentiels qu’une porte. Vous l’ouvrez, et c’est automatiquement un espace nouveau qui s’offre au regard du spectateur. Vous avez le choix de rester sur le pas de la porte et de jouer ainsi de champs-contrechamps articulés autour de ce protagoniste de l’ombre, ce monolithe de l’espace, ou de montrer, au contraire, un personnage en train de faire son apparition. Dans ce dernier cas, le mouvement aura comme avantage de forcer un cut (entrée imprévue ou retour vers un personnage qu’on avait laissé entre-temps pour nous intéresser à d’autres : principe du montage alterné, mais appliqué à la mise en scène de salon) ou un raccord dans le mouvement (continuité du déplacement d’un personnage depuis une autre pièce et avec le plan précédent).

1931, l’Odyssée de l’espace
Essayez à la maison ! Le cinéma muet avait mis en évidence notre fascination pour une simple variation de champs-contrechamps (les chase films par exemple) : vous pouvez reproduire la même action en montage alterné, fait de va-et-vient, et notre attention restera hypnotisée devant une action en boucle sans rien proposer de nouveau (littéralement, pendant des heures, on peut suivre une étape du Tour de France sur ce seul principe). Ajoutez-y une porte, et c’est du cinéma.
Le problème dans The Royal Family of Broadway, c’est donc sa trop grande application à reproduire des codes spécifiques au théâtre. La majeure partie du film est tournée autour d’un même espace : une salle de séjour, un grand escalier, un canapé, quelques chaises, et dans les coins, des zones plus intimes (salon plus intime avec une cheminée, haut de l’escalier) auxquelles on peut accéder librement depuis la salle de séjour. On y remarque la même impression que face à une scène de théâtre à ne jamais pouvoir saisir du regard les plafonds, les limites exactes d’une pièce ou les perspectives. Un espace « vide », ample, aux proportions irréalistes, entre l’espace scénique et la caméra (une caractéristique du théâtre qui au cinéma n’est pas justifiée) donne clairement à imaginer une caméra tranquillement posée dans un studio sans souci de recul (j’avais noté cette particularité dans un film de Raoul Walsh tourné en 1931, Hors du gouffre).
Quelques séquences ouvrent vers des pièces nouvelles de la maison, mais l’intérêt du cinéma (ce dont le théâtre est incapable), c’est de passer d’un espace à l’autre en une fraction de seconde, de revenir par un simple cut aux personnages restés dans la pièce précédente et ainsi d’entamer un montage alterné… Par souci de contextualisation (qui deviendra de plus en plus une norme intangible), très vite, le cinéma apprendra à situer le décor principal au milieu d’un espace réel et public, puis à intégrer à l’intérieur de plans intérieurs des ouvertures factices ou réelles vers l’extérieur. Le cinéma muet utilisait déjà sporadiquement cette méthode (je l’évoquais pour Le Journal d’une femme perdue), mais cela deviendra surtout une constante dans les films parlants. Avant que l’on comprenne l’indispensable nécessité de contextualiser un espace en faisant l’union des espaces intérieurs et extérieurs, de nombreux films tournés en studio s’enferment dans l’idée qu’on peut ne jamais montrer quoi que ce soit de l’extérieur : j’avais noté cette particularité pour L’Ange blanc, de William A. Wellman (1931).
À cette incapacité à changer de place dans un même lieu pour en exposer librement tous les recoins (travail de contextualisation et de représentation d’un espace complexe et crédible au fil du temps) s’ajoute un autre problème. Puisque tout paraît un peu trop hiératique et théâtral, les acteurs et leur directeur trouveront difficilement leur rythme. Or, une comédie sans rythme, ça fait flop.
Grand espace vide au premier plan, distortion des perspectives et porte qui reste muette = théâtre
Espace en arrière-plan suggérant la réalité d’un extérieur = cinéma
Ni l’écriture ni l’adaptation ne sont en cause. Rien n’empêchait Cukor ou la production d’imposer un espace avec des portes, de scinder quelques échanges pour forcer un mouvement et séparer les personnages une fois ou deux pour créer des montages alternés (de salon). Rien, sauf l’habitude. On avait donc exploré cette manière de faire dans le cinéma muet, mais c’était loin d’être une règle parce que le muet obéissait à des logiques bien différentes. Avec le cinéma parlant, on peut certes multiplier les espaces, mais si l’on veut créer une situation, il faut bien un moment se poser. Au muet, on cherchait presque parfois à limiter ces confrontations parce que cela signifiait des cartons à ne plus en finir. On peut bien sûr profiter de l’expérience du muet pour varier la mise en place, mais on le comprendra très vite (ce sera une marque des screwball comedies) : dans la comédie, même si c’est les dialogues qui sont moteurs d’une situation, cela doit bouger et alterner entre mouvement et moment plus statique. C’est ça le rythme : à ne pas confondre avec la vitesse. On bouge, on avance, on se pose, puis on repart. Le tout, en discutant. Le tout, bien souvent, coordonné autour d’un sentiment d’urgence (c’est ce qu’on comprendra avec la screwball). Et l’art de la comédie américaine, il est d’arriver à circuler constamment dans un espace censé être unique et à trouver un prétexte à se mouvoir en changeant de pièce. Cette manie qu’ont les Américains à vous proposer un tour du propriétaire vient sans doute de là…
Pour résumer et pour le dire plus simplement : dans une mise en place comique, si vous restez statiques trop longtemps, vous vous installez et le public s’ennuie. Au théâtre, un canapé a beau trôner en plein milieu de l’espace, il ne fait jamais que de la figuration. De la même manière qu’on pourrait dire qu’une porte au cinéma a pour fonction d’être alternativement ouverte et fermée, au théâtre, le canapé n’a qu’une seule utilité : faire rebondir les personnages. Aussitôt assis, aussitôt debout ! Si vous posez un canapé dans un coin et que vous n’y faites asseoir vos personnages qu’une ou deux secondes, passe encore. Mais si vous le posez en plein centre de votre dispositif sur un plateau de tournage comme dans une comédie de boulevard, vous vous laisseriez à la facilité de vous y endormir. N’oublions pas qu’une comédie de salon (on n’appelle pas ça comme ça, c’est une manière de présenter les choses) est inféodée à son salon parce que c’est… du théâtre. Rien n’oblige un studio à adapter une pièce (de salon) dans un salon. Le cinéma n’est pas tributaire d’un décor unique. Et c’est là que Cukor s’est laissé prendre au piège : si le cinéma exige la mise en œuvre de nouveaux codes, se poser trop longtemps sur un canapé pour papoter n’en fera pas partie. Je choisis le canapé comme exemple le plus significatif, mais même quand il explore les autres espaces de son plateau, on ne sent pas l’énergie et le besoin de bouger.
Très vite, on comprendra donc l’impérative nécessité de s’activer, même dans des adaptations de pièces de Broadway (ou anglaise, ou hongroise, ou allemande, ou française).
La suite l’a d’ailleurs démontré : quels sont les auteurs de la pièce adaptée ici ? Edna Ferber et George S. Kaufman. Ne reconnaît-on pas dans cette maison d’hurluberlus un certain humour, un certain type de situation ou de lieu ? Réunis ou séparés, les deux dramaturges connaîtront quelques succès une fois adaptés à Hollywood. Leur ton est facilement identifiable : on n’est pas tout à fait encore dans ce qui deviendra la screwball (avec sa variante, la comédie de remariage) et le style se rapproche du burlesque situationnel des Marx Brothers : ici, on serait plutôt dans « la maison de fous » et l’humour loufoque. Les deux coécriront par exemple Pension d’artistes avec Morrie Ryskind, et Kaufman écrira Vous ne l’emporterez pas avec vous. Comparer les deux films permettrait de comprendre à quel point George Cukor s’est planté ou a galéré à transmettre à ses interprètes la tonalité loufoque du film. (En 1930, encore une fois, rien de plus normal.) Seul Fredric March semble avoir appréhendé l’excentricité de la pièce dont il semble avoir été le premier interprète à Broadway trois ans plus tôt. Il y est un formidable matamore, parodie assumée de John Barrymore. Aucun de ses partenaires ne passe la rampe : pas assez d’audace, de fantaisie, de justesse. Là, oui, on peut dire que l’arrivée du cinéma parlant a correspondu avec le déclin de certains acteurs. (Cukor n’est pas pour autant exempt de tout reproche : voyant que ça patinait, il aurait pu demander à ses acteurs d’accélérer le rythme. March y parvenait très bien.)
Au théâtre, aucun concurrent ne viendra vous faire voyager d’un espace à un autre : tout le monde est assujetti au « ici et maintenant ». Au cinéma, si. Si, au mieux, l’on renouvelle le décor une fois par acte au théâtre, au cinéma, un cut vous transporte aussi bien dans la pièce voisine qu’à l’autre bout du monde. Et c’est probablement la concurrence qui a forcé la mise en place rapide de codes entre la production de The Royal Family of Broadway et celle de Girls About Town.
Entre les deux films, on change ainsi du tout au tout : jeu sur la relation entre l’intérieur et l’extérieur (silhouette de « la mère » à la fenêtre interdisant le galant à venir s’incruster chez sa belle) ; variation des espaces à la fois dans les intérieurs (les portes claquent, et l’on écoute même aux portes) et dans les extérieurs (on choisit opportunément une histoire dont une bonne partie prend place sur un bateau) ; interdiction de s’appesantir (tout est mouvements, rencontres, passage d’un lieu à un autre, actions, oppositions, rebonds) ; et enfin, redistribution des rôles (beaucoup des acteurs du film resteront populaires dans la décennie : Kay Francis, Joel McCrea, Eugene Pallette).
Volontaires ou non, ces changements illustrent au moins une évolution globale et la prise de conscience rapide, dans l’industrie cinématographique, que le cinéma parlant ne fonctionnera ni avec les codes du muet ni avec ceux du théâtre filmé. Conscientisés ou non, ces changements vers des codes communs qui s’opèrent en à peine quelques mois concernent sans doute en priorité les films qui feront date ; en 1932, il n’est par conséquent pas dit que le gros de la production obéissait à ces règles. Et quoi que l’on puisse en dire, au moins, l’évolution semblait inéluctable, une évolution parfaitement illustrée dans ces deux films réalisés à quelques mois d’intervalle.
Énormément de films étaient produits à l’époque avec l’idée qu’en adaptant un succès de Broadway ou une comédie de la scène européenne, les studios se faciliteraient la tâche. La concurrence a joué son rôle, et c’est à cette période que des carrières parfois longues de plusieurs décennies se sont lancées. « Spectateurs, songez que du haut de ces premiers succès, quarante décennies vous contemplent. » Une réalité valable autant pour les nouvelles vedettes que pour les réalisateurs : certaines pointures du muet retrouveront peu ou prou leur rythme de croisière, d’autres ne trouveront jamais la porte du salut incrustée dans le mur qui fonçait droit sur eux, et d’autres encore comme Cukor ont émergé grâce à leur capacité à comprendre et à appliquer les codes naissants. Venu de Broadway, Cukor était disposé plus que d’autres à participer à cette révolution. Et dès 1933, il rejoindra la MGM pour adapter à l’écran à nouveau une pièce… d’Edna Ferber et de George S. Kaufman ! Les Invités de huit heures. Et cette fois, avec succès. Ironiquement, le metteur en scène y retrouvera deux membres de la « Royauté Barrymore » (Lionel et John), gentiment parodiée, précisément, dans The Royal Family of Broadway.
The Royal Family of Broadway (1930) & Girls About Town (1931) — George Cukor | Paramount
Sur La Saveur des goûts amers :
- Charlot grammairien
- Usage du montage alterné dans Le Lys brisé (1919)
- Situations, espaces vides et montage dans Une aussi longue absence (1961)
- La leçon de contextualisation de Vlacil (Adelaide, 1969)
- Organisation du mouvement dans L’Art d’être aimé, Wojciech Has (1963)
- Mise en scène et contextualisation : crédibilité, détails/situation générale dans Onoda
- Transition vers le cinéma parlant (tag)










 Année : 1936
Année : 1936

 Année : 1936
Année : 1936

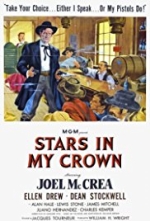 Année :
Année : 



 Année : 1955
Année : 1955


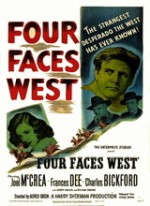 Année : 1948
Année : 1948




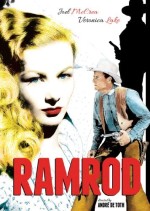

















 Année :
Année : 
