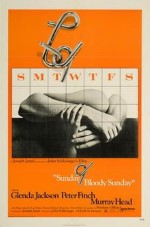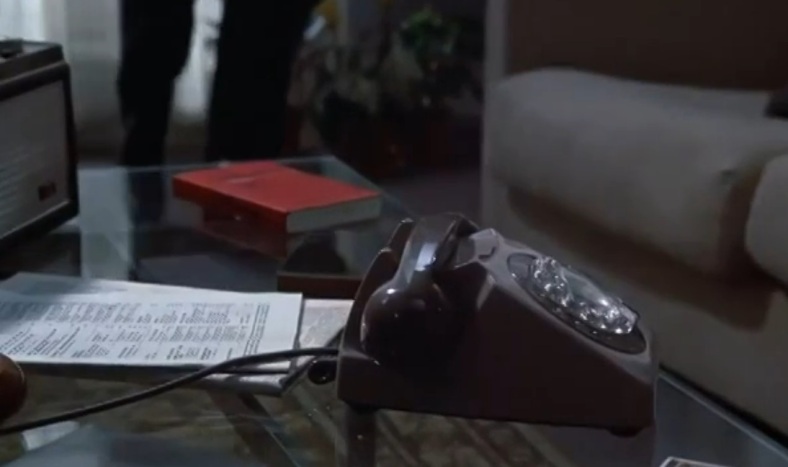Le Désert des Taratatas

Le Désert des Tartares
Titre original : Il deserto dei tartari
Année : 1976
Réalisation : Valerio Zurlini
Avec : Jacques Perrin, Vittorio Gassman, Giuliano Gemma, Helmut Griem, Philippe Noiret, Francisco Rabal, Fernando Rey, Laurent Terzieff, Jean-Louis Trintignant, Max von Sydow
Je ne croyais pas dire ça un jour, mais l’argument du film est un chef-d’œuvre. Certes, les scénarios ne sont pas des œuvres, mais le roman dont est tiré le film a des… arguments pour me convaincre de le lire un jour. Avec un titre de film pareil, sans rien connaître au roman initial, on est en droit d’attendre du spectacle, de l’aventure, du mouvement, des rebondissements… Et, surprise, sur notre chemin de spectateur, se dresse une histoire absurde et existentialiste à la Kafka sur une frontière floue où il ne se passe jamais rien et où on attend sur des décennies l’apparition d’un ennemi craint et imaginaire : les hommes de l’État du Nord ! Aka, « ceux dont on ne peut pas dire le nom », aka « Les Tartares ».
Les officiers amenés à se perdre dans cette forteresse du désespoir semblent, au fil des ans, soit broyés par l’ennui et le doute, soit sujets aux mirages et aux récits fantastiques de ceux qui pensent avoir vu quelque chose. Le plus souvent, ils finiront anéantis par la solitude et l’isolement des lieux, drogués ou fous. D’étranges relations se nouent entre ces soldats qui désespèrent de ne jamais se battre et pour certains, cet ennui finit même par devenir une drogue en soi : la foi qu’un jour les hommes de l’État du Nord se présenteront à eux et attaqueront. Le moindre signe venu du désert pourra ainsi être vécu comme la preuve de l’existence d’une attaque future et espérée. Certains attendent le Messie ; eux, c’est l’ennemi qu’ils guettent en espérant qu’ils viennent les délivrer. Parmi ces officiers (volontaires ou non) affectés à cette frontière débouchant sur le vide, certains rêvent d’abord de quitter ces lieux où rien ne se passe (c’est le cas du personnage principal) ; d’autres semblent s’être résignés depuis longtemps à y pourrir parce que la retraite que procure ce poste avancé loin du monde était ce qu’ils pouvaient rêver de mieux pour achever leur existence ; d’autres encore rêvent tellement de voir finir par aboutir à leurs portes une attaque qu’ils tardent à prendre les bonnes décisions quand les premiers signes extérieurs de la présence ennemie apparaissent : au moins, si la forteresse apparaît désertée, cela incitera peut-être les « Tartares » à attaquer. Les soldats qui y perdront la vie mourront alors d’autre chose que d’ennui et resteront peut-être dans les livres d’histoire.
Une matière en or, un sujet à grands films. Seulement, pour mener à bien de tels projets, il faut des génies aux commandes ou des réalisateurs audacieux un peu fous capables de tracer des pistes nouvelles dans le désert… Et Zurlini est, à mon sens, loin d’être l’homme idéal pour un tel film : c’est un cinéaste des espaces urbains et de l’intimité. L’errance serait peut-être plus dans ses cordes, mais le film reste pauvre en propositions purement cinématographiques, visuelles ou situationnelles illustrant cette thématique. C’est aussi un cinéaste habile à dévoiler les regards qui se croisent et à adopter des points de vue subjectifs. Là non plus, on ne voit rien de tout ça dans le film. Zurlini n’a ni les armes pour lutter face à un tel ennemi invisible qu’est la mise en scène des grands sujets existentiels ni le talent pour faire de la mise en scène le point d’attention central d’un film parce qu’il n’a jamais été un cinéaste des ambiances, de la contemplation et des illusions. On trouvait peut-être un peu de cette ambiance absurde et post-apocalyptique dans Le Professeur, mais une telle histoire (vide) aurait nécessité que tout soit mis en œuvre pour que l’accent soit mis sur les qualités imaginatives de son argument. On aurait pu rêver d’un Aguirre statique chez les Tartares, d’un 2001: A Time Odyssey, d’un Solaris terrien et uchronique ou d’un Problème à trois corps… pour te pendre. Occasion manquée. Un film, ce n’est pas un scénario. Encore moins une adaptation. Mais adapter un tel roman proposant un espace vide entier susceptible de voir des génies de la mise en scène venir y exprimer leur talent, ce n’est pas adapter La Dame de chez Maxim.

Peut-être y a-t-il des œuvres littéraires, basées sur un univers poétique et absurde parallèle, qui se déroberont toujours à leurs adaptations. Qui irait produire une adaptation du Rivage des Syrtes (dont l’argument est quasiment un clone du Désert des Tartares) par exemple ? Ou de… Dune ?… De Fondation ? Aucune adaptation ne sera jamais à la hauteur des imaginaires que ces œuvres véhiculent. Et j’insiste : la seule astuce viable avec de telles adaptations, c’est de s’écarter des obligations dramatiques d’une histoire, en évoquer les contours seuls tout en gardant une forme de cohérence narrative, et cela afin de proposer une œuvre qui s’appuie davantage sur l’atout majeur du cinéma : l’image. Ces histoires suggèrent des imaginaires puissants, ce serait une erreur de faire confiance aux dialogues pour en restituer la magie, la beauté ou l’absurdité. On ne vient pas voir Dune pour l’histoire, mais pour son univers (c’est bien pourquoi il y avait une logique à voir David Lynch en proposer une première version).
Zurlini ne dépasse jamais l’écueil de la transgression du roman et de son adaptation « littérale » se perdant à retranscrire à l’écran des scènes de dialogues bien trop prosaïques pour que l’on puisse partager la folie, le désarroi ou l’ennui des personnages. Quand on pense à l’utilisation des dialogues d’un Tarkovski dans Solaris ou ailleurs, il parvient toujours à les mettre au second plan : sa caméra montre autre chose et s’applique d’abord à transmettre une ambiance qui doit coller avec celle de son personnage.
Peut-on filmer un ennemi invisible ? Bien sûr. Qu’il existe ou non, ne pas pouvoir le montrer ne devrait pas être un problème parce que le cinéma, c’est l’art de suggérer les choses sans les montrer. On peut ainsi supplanter la menace d’un ennemi qu’on attend sans jamais le voir à d’autres, bien réels, moins exogènes mais tout aussi anxiogènes : les éléments naturels, la folie, la solitude, l’absurdité…
Peut-on filmer l’ennui ? Bien sûr. Tout l’art de la mise en scène consiste à filmer l’invisible, l’attente, l’ennui, la pesanteur, l’illusion du temps qui passe, la percussion des images pour en suggérer un sens. Quand Sergio Leone filme le début d’Il était une fois dans l’Ouest, il n’a ni besoin de dialogues, ni besoin d’action. Parce que la mise en scène, c’est justement de donner corps à ce qu’il y a entre les choses. Son cinéma, comme celui de Kubrick, de Visconti, de Coppola ou de Tarkovski, n’est fait que de pesanteur où il ne se passe rien, où on met de la distance avec les choses, où au contraire on se focalise sur une autre qui tarde ou grandit. L’attention, comme le suspense, elle naît de « l’attente », de la « suspension » des choses. Un dialogue ne suspend rien ; si on ne le met pas à distance ou en situation, on adapte gentiment un scénario pour la télévision. Le Désert des Taratatas.
L’ennui devrait être ce qu’il y a de plus cinématographique à filmer. Parce que pour filmer l’ennui, on est obligé d’essayer d’en faire sentir au spectateur les raisons et l’origine. L’ennui devient un mystère à appréhender. Filmer l’ennui, ce n’est pas filmer le néant ou l’attente. C’est en filmer les contours. C’est creuser les raisons de cet état suspendu supposément vide. La caméra fouille dans son environnement ce qui accable tant les personnages : c’est une loupe qui cherche des indices, qui illustre une quête en train de se faire autour de soi, dans un environnement immédiat que l’on ne saisit pas. C’est le montage qui fait alors dialoguer entre eux les images et qui nous suggère des explications à cet ennui. Concentrez-vous dans un film qui traite du néant, de l’absurdité ou de l’ennui sur les maigres éléments dramatiques que l’histoire vous offre, et vous n’avez rien compris, parce que le but, il est précisément d’illustrer un fantôme à travers les traces bien visibles qu’il laisse à son passage. L’ennui, tel un trou noir, on ne peut le voir directement, il faut guetter les traces qui trahissent sa présence. Et c’est ainsi qu’il finit par fasciner et par vous envoûter : parce qu’on regarde graviter autour de lui ce qui est encore vivant et qui finit par sombrer dans la torpeur. Ce qui émeut, ce n’est pas un cadavre déjà sans vie, mais un corps qui meurt et présente ses derniers sursauts de vie.

Mais ne mettons pas tout sur le dos de Zurlini. Pour illustrer ces espaces impalpables, pour mettre en scène les indices résiduels d’un mystère qui nous échappe et qu’il faut dompter, il faut disposer d’une matière suffisante servant de révélateur. Si aucune matière ne tombe dans le trou noir, vous n’assisterez jamais à son festin. Le néant, effectivement, on ne le filme pas en filmant « rien ». On le filme en multipliant les images qui le précèdent et le contournent.
Elle est peut-être là d’ailleurs la plus grande absurdité du film : toute la production (Zurlini en tête) semble avoir rendu les armes bien trop vite une fois envoyés à la frontière. Le monstre était là, il fallait tendre les jumelles et ne pas résister à la tentation de le montrer, quitte à ne rien voir. Depuis Hitchcock (rappelons-nous par exemple du film le plus hitchcockien de Steven Spielberg, Les Dents de la mer), on sait que plus un ennemi est invisible, plus il terrorise. Encore faut-il suggérer sa présence, ou son absence. Au lieu de nous montrer des personnages regardant au loin et discutant de ce qu’ils voient, il faut nous donner à voir ! Le cinéma, c’est la percussion des images. Pas un assemblage scolaire de répliques égrenées comme un chapelet de bénédictine pour faire plaisir au scénariste. Zurlini, le cinéaste des regards aurait dû comprendre ça. À des personnages qui regardent au loin pour guetter un ennemi invisible, il faut répondre à des plans subjectifs. Sans contrechamp, pas de hors-champ. Sans hors-champ, pas de crainte, ni ennui, ni attente. L’ennui n’est plus diégétique, mais canapégétique. Les répliques doivent poser brièvement les enjeux d’une situation, mais très vite, il faut les mettre à distance et se focaliser sur l’objet insaisissable qui apparaît, ou non, au loin.
Et si le problème vient autant de la production que de la mise en scène prosaïque et verbeuse de Zurlini, c’est bien qu’il faut apporter au film une matière à filmer dans ces contrechamps. Or, on voit trop la distinction entre les séquences tournées à la forteresse en Iran et les intérieurs de Cinecittà. Si la mise en scène, c’est l’art de faire dialoguer les images, l’un des défis de contextualisation auxquels doit se frotter tout cinéaste, il est d’arriver à faire cohabiter dans une même séquence des éléments tournés dans un lieu avec un autre. Pas le choix de trouver des artifices pour donner à voir justement l’instant, l’espace, où les personnages passent d’un lieu à un autre. Peut-être que les autorités iraniennes ne pouvaient-elles pas donner leur aval pour que soient aménagés un site archéologique pour le bien d’une production audiovisuelle. Mais c’est bien là toute une question de production. Si Zurlini est sans doute un peu fautif d’avoir cherché à suivre béatement un scénario trop littéral d’une œuvre qui n’a probablement rien de cérébral, le reste de la production l’est tout autant. On ne peut pas faire tout un film, cloîtrés dans un décor reproduit dans un studio, et se trouver tout à coup dans la séquence qui suit dans la cour ou sur les remparts d’une forteresse. Pour montrer cette drôle de guerre aux frontières d’un monde qui n’existe pas, il faut pouvoir l’alimenter avec autre chose que quatre ou cinq espaces clos et quelques séquences en extérieurs. Des transitions sont indispensables. Un jeu sur la profondeur de champ disposant toutes les échelles de cet environnement dans une même image aurait aidé à la contextualisation des choses, par conséquent à l’imaginaire. Parfois, ce sont bien des astuces de production qui servent à donner de la prestance à certains films qui en manquent par ailleurs à travers des séquences qui tout à coup proposent une idée, un angle ou un décor ingénieux : on pourrait rêver d’un dispositif comme celui mis en place pour un palace inachevé dans Rio Conchos capable de mettre à l’écran enfin un rapport intérieur/extérieur de la forteresse et d’illustrer l’absurdité de la présence de ces hommes postés au bord d’un précipice incertain.
On ne peut pas non plus compter sur Ennio Morricone pour pallier à l’absence de matériel et d’images. La musique ne fait jamais que venir surligner ce que l’on voit à l’écran. Elle n’est souvent qu’un écho qui vient renforcer l’espace vide d’une pièce, d’un décor, d’une situation. Elle ne fera jamais vibrer un espace que l’on a déjà rempli de personnages soumettant déjà au public leur musique. Il y a des films dans lesquels les dialogues sont à mettre en avant parce qu’ils font figure d’atout premier d’une œuvre ; mais quand un film est destiné à dévoiler autre chose, à développer tout un imaginaire visuel (même intime), les dialogues ne sont plus que des notes de bas de page.
Raté donc. Je rêverais d’une adaptation de cette histoire en film de science-fiction dans un univers spatial. Elle est là désormais la nouvelle frontière. Et les Aliens feraient de parfaits « Tartares ». (Encore faudrait-il trouver l’homme providentiel acceptant d’être envoyé ainsi au front dans une guerre avec comme seul ennemi que lui-même…)
Le Désert des Tartares, Valerio Zurlini (1976) Il deserto dei tartari | Fildebroc, Les Films de l’Astrophore, Reggane Films, Corona Filmproduktion
Sur La Saveur des goûts amers :
Les Indispensables du cinéma 1976
Perception d’images arrêtées sur Himiko, Shinoda (1974)
Récit, réalisation et sous-texte dans Sindbad, de Zoltan Huszarik (1971)
Liens externes :