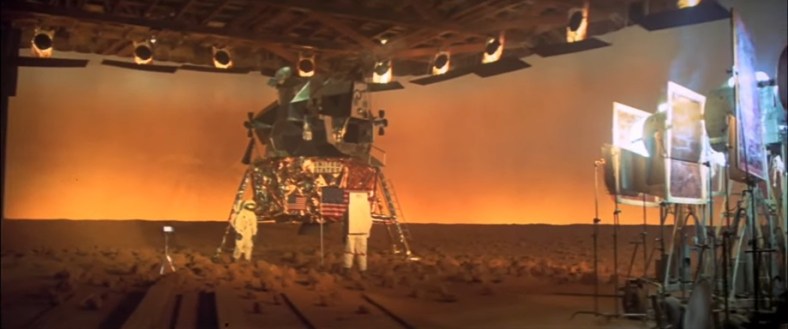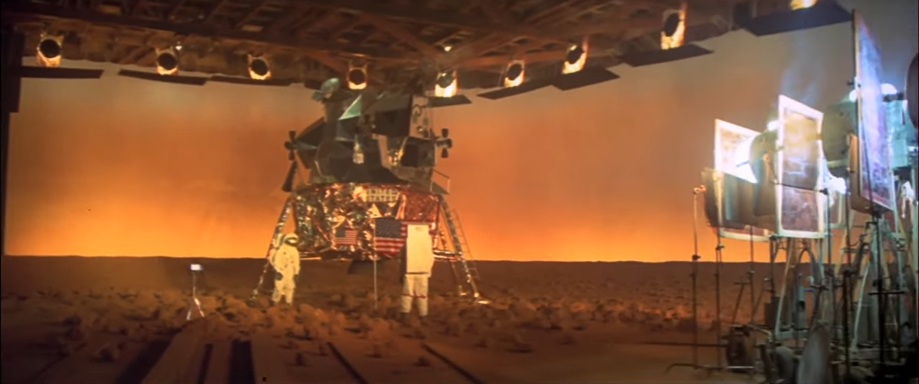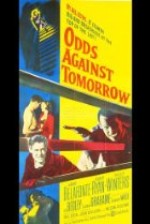L’Emploi du temps
Année : 2001
Réalisation : Laurent Cantet
Avec : Aurélien Recoing, Karin Viard, Serge Livrozet
Grand admirateur de Ressources humaines en son temps (le film figure toujours dans ma liste de favoris alors que je ne l’ai jamais revu), je connaissais l’existence de L’Emploi du temps et l’avais gardé dans un coin de ma tête en attendant de le voir. À l’occasion de la rétrospective du réalisateur à la tek, c’est donc chose faite.
La méthode.
Dans mon souvenir forcément bien brumeux un quart de siècle après, Ressources humaines mêlait acteurs professionnels et amateurs. Et dans ma logique, l’unité du jeu passait par de l’improvisation. Il est possible que le film m’ait plu davantage pour son sujet, mais c’est en tout cas la conception « postjugée » que je me faisais du film en venant voir celui-ci. L’acteur principal, Aurélien Recoing, présent pour la séance, douche légèrement mes attentes quand il affirme avoir travaillé sur un texte très écrit, malgré la participation d’acteurs amateurs. Et, en effet, on le remarque immédiatement à l’écran : l’exercice naturaliste ne s’appuie pas du tout sur de l’improvisation dirigée, mais sur un respect presque strict de lignes de dialogue.
Autant le dire tout de suite, dans le registre du naturalisme, la méthode est loin d’être la plus efficace. Les acteurs se débattent comme ils peuvent. L’exercice qui consiste à mimer la réalité avec un phrasé appris par cœur (et qui n’est par conséquent pas le sien) relève de l’impossible. Comédies et drames s’accommodent d’un texte établi à l’avance (méthode traditionnelle pour genres traditionnels) ; les « tranches de vie » des chroniques naturalistes connaissent des dispositifs de mise en scène capables d’éviter les écueils des répliques figées d’un scénario (le naturalisme, né d’abord dans le roman, profite d’une invention plus récente et trouve rapidement une traduction cinématographique à ses principes théâtraux alors même que le cinéma est encore muet et ne dispose donc pas de « répliques » ; cf., par exemple, Le Coupable). Insuffler le « vrai » à ses répliques, pour un acteur, relève beaucoup de l’exercice de style (ou de la « technique »), donc de la performance. Mais c’est un peu comme demander à des nageurs de traverser la manche en apnée : tout entraînés qu’ils sont, les meilleurs acteurs qui auront appris par cœur un texte écrit pour « faire naturaliste » ne pourront jamais reproduire totalement le souffle, l’élan du phrasé « improvisé ». Ils arriveront à trouver de la justesse sur des bouts de phrase, parfois quelques-unes, mais la perte d’attention, la nécessité de contrôler ce qu’ils font (comme un slalomeur contraint de suivre l’ordre des piquets) les contraindront à reprendre une forme de « souffle » qui inexorablement provoquera le déraillement de leur élan « vrai », de leur phrasé naturel et spontané. Dans n’importe quel style de film, cette artificialité recueille l’adhésion de tous. Elle relève de l’usage. Avec le naturalisme, ça marche différemment parce que très vite les metteurs en scène ont su adopter des dispositifs qui leur permettaient d’éviter l’exercice obligé des répliques apprises par cœur. Les exigences du genre imposent une plus grande spontanéité. Et c’est bien pourquoi l’écriture se définit le plus souvent à travers des situations, des axes de développement, des essais, des tâtonnements. Au centre de cette méthode : l’improvisation. Et si parfois quelques tonalités paraissent plus factices, on peut l’accepter parce que les acteurs possèdent dans l’ensemble cette fluidité, cette spontanéité et ce naturel qu’un texte ne permet pas.
Je m’attarde, mais c’est essentiel pour comprendre mon état d’esprit au début du film. Cette première « déception » ou surprise a certainement conditionné ma capacité à accepter le reste. Dérangeant au début du film surtout, mon attention s’avoue vaincue et s’autorise à mettre de côté la méthode : voir ostensiblement un acteur mentir pour un protagoniste qui ment, ma foi, il y a une forme de logique (on se convainc comme on peut). L’efficacité reste douteuse, car le film a besoin que le spectateur se botte un peu les fesses pour adhérer à la « méthode », mais mon scepticisme trouvera vite une nouvelle matière à se mettre sous la dent…

Le personnage.
Un personnage, pour que le public puisse le regarder, doit répondre à certains objectifs. Chaque spectateur pourra ensuite, à l’évidence, estimer qu’ils sont atteints, différemment les uns des autres, mais l’idée est là… Un de ces objectifs consiste à ne pas se rendre antipathique aux yeux du public. Il ne doit pas agacer. On aime les héros, les gens bizarres, les personnages pathétiques ou misérables, les monstres, mais on aime rarement nous attarder sur de pauvres types qui se comportent comme des salauds.
Vincent, indéniablement, souffre. Est-ce une excuse pour qu’il mente à sa famille ? Bien sûr. Il y a la manière de le faire, mais mentir parce que l’on va mal n’est pas rédhibitoire. Est-ce que la souffrance de Vincent justifie qu’il en vienne à soutirer de l’argent à ses proches ? Eh bien, pas du tout. Que tu te crées une double vie, que tu ne trouves pas la force de le dire à tes proches, que tu t’enfermes dans une spirale de la honte et du mensonge, tout cela, le spectateur (que je suis) peut le comprendre et l’accepter. Que tu embobines ton père, tes amis, tes collègues, interdises certaines personnes à rentrer en contact avec ta femme parce que tu veux mener un train de vie qui n’est pas le tien et que tu veux garder le contrôle et l’influence sur ton entourage alors que tu n’es qu’une merde ? Ce n’est plus acceptable.
Vincent, c’est le symptôme d’une société malade. Son problème, ce n’est pas qu’il souffre d’occuper un job à la con, qu’il se tue à la tâche au point de frôler le burn out. Non, son problème, c’est qu’il rêve de pouvoir et d’argent tout en filant sur l’autoroute des facilités. Si un jour, il décide de ne pas se rendre à un rendez-vous, c’est parce qu’il pense qu’il vaut mieux que ce que son boulot lui propose. Et puisque la vie ne lui offre pas ce dont il estime avoir droit, il décide de vivre son rêve et de l’imposer aux autres. La cause des souffrances de Vincent n’est pas une perte de sens qu’il comble par une mythomanie ordinaire, mais son égo surdimensionné. C’est son égo qui fait de lui un faussaire. Plus que la fonction, Vincent court après la « voiture de fonction ».
Est-ce touchant ? Non. Est-ce fascinant ? Non. (C’est terriblement ordinaire.) Est-ce que dévoiler cette réalité à l’écran dénonce ou illustre quelque chose de notre société ? Non. Le personnage de Vincent enfonce des portes ouvertes. « Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée », certes, mais quand tu ne fais plus que ça, il faut le faire avec style. Et ce n’est pas le domaine de la chronique naturaliste.
Le ton.
Le ton, l’audace, c’est comme le rythme au cinéma, comme la repartie ou comme les apartés au théâtre. La demi-mesure ne convainc personne. Si Vincent souffre et s’il ne manipule pas les autres pour tordre le monde à sa convenance, on peut rentrer en empathie avec lui. Des personnages en souffrance qui surnagent, gardent la tête haute sans jamais tomber dans la médiocrité, c’est le fonds de commerce du naturalisme. Vous regardez un film de Naruse et vous avez tout compris de la dignité et de la force des petites (et honnêtes) gens. Quand ces personnages commettent des erreurs, ils les regrettent amèrement. Quand Vincent est placé face à ses mensonges, il rembourse l’argent qu’il doit à ses proches, mais au lieu d’affronter sa famille pour s’expliquer, affronter la réalité et la conséquence de ses actes, il saute par la fenêtre comme un ado attardé et se barre : « Je vous emmerde, je n’ai rien à vous dire. » Chez Naruse (ou chez d’autres), les hommes sont souvent des lâches. Mais ils sont à l’origine des tracas des personnages féminins au centre de ces récits qui, eux, affrontent ces « opposants » avec dignité. Vincent, lui, est un connard. Le lâche au centre de tout. Ses opposants à lui, ce sont ces personnages qui gravitent autour de lui et dont il voudrait qu’ils s’accordent exactement à ses désirs comme des marionnettes.
Le film aurait pu tendre au contraire vers l’extrême opposé. Pas de demi-mesure. Si vous voulez en faire un escroc, faites-en un qui en vaut la peine. Les spectateurs conservent une fascination pour les monstres. À force de traîner dans le hall du même hôtel, Vincent se fait remarquer par un escroc assez peu convaincu pour son jeu de persuasion. Ils finissent par travailler ensemble. Un soir, son nouvel ami, son confident, son complice lui fait feuilleter sa « biographie » : sa fille avait collé dans un cahier toutes les brochures de presse qui évoquaient les exploits de son père. Un monstre ? Même pas. Un escroc, assurément, mais un qui ne se cache pas et qui garde, en dépit de ses activités, une forme de responsabilité et d’honneur. Un escroc… humain. Un personnage de roman (ou de cinéma) en somme. On pourrait craindre à un moment qu’il dénonce Vincent ou lui fasse du chantage. Au contraire, lui, contrairement à nous, se montre assez empathique à l’égard de ce pauvre type qui ment à sa famille en leur faisant croire qu’il bosse désormais pour une organisation onusienne à Genève. Vincent cherchait un boulot qui a du sens ? Même pas : le fric, la voiture, les fringues, le statut social, c’est tout ce qui l’intéresse. Un vrai connard. Un connard de tous les jours.
Elle est là la demi-mesure du film. Ni Cantet ni Recoing n’ont réussi à rendre sympathique, empathique, intriguant, fascinant leur personnage. Si son caractère et ses actions étaient exceptionnels, il serait devenu un monstre digne d’être regardé. Et s’il était au moins conscient de sa médiocrité, s’il montrait des remords de se trouver aussi con de courir après quelque chose de si futile et de si méprisable, s’il faisait amende honorable, il pourrait être sauvé à nos yeux. La compassion ou la fascination. Au contraire, Cantet et Recoing multiplient les plans dans lesquels le personnage sourit éhontément. Un contrepoint ? Comme pour en faire un monstre (le personnage est inspiré d’un véritable monstre dont Nicole Garcia avait tiré un film, L’Adversaire) ? Même pas. Les monstres fascinent au cinéma, on y dévoile l’exceptionnel à l’écran. Des crapules misérables, on les regarde s’il reste une part d’humanité en eux, de remords, si on les sent forcés par une force légitime. Le statut social ? Le Land Rover ? Sérieusement, ce sont des excuses légitimes ? Non.

Le seul personnage qui montre un peu d’humanité là-dedans (une humanité cinématographique), paradoxalement, c’est donc l’escroc. Cela aurait pu être le cas de l’ami à qui Vincent rend l’argent, mais lui aussi n’est intéressé que par le gain. À la manière dont il reçoit Vincent en lui avouant qu’il sait qu’il propose des investissements louches, on reconnaît là encore un salaud. Ce n’est pas une famille dans le besoin poussé à demander une faveur à un ami : non, le mec a entendu parler d’une magouille et accueille la personne en question avec le plus hypocrite des sourires afin de voir s’il ne pourrait pas le mettre dans la boucle. Ce serait dans une satire sociale, ce comportement serait parfait. Dans une chronique naturaliste, c’est détestable. Et quand Vincent lui rend l’argent, sa réaction n’est pas beaucoup plus digne… Le père de Vincent ne vaut pas beaucoup mieux d’ailleurs. Et la femme, qui semble comprendre petit à petit que quelque chose se trame, fait preuve aussi de lâcheté en refusant de mettre son mari devant ses responsabilités. Elle s’en tire mieux que les autres parce que c’est elle qui cherche la vérité, mais elle refuse de s’opposer à son mari ou de l’aider. Elle reste à le regarder mentir sans oser le confronter à ses mensonges… Le manque de courage et d’initiatives, à l’écran, ça passe mal.
Et j’en reviens au jeu imposé par les dialogues. Dans le travail préparatoire, en vue d’une improvisation dirigée, tout le monde aurait vu qu’il aurait fallu prendre garde à ne pas faire de ces personnages des salauds. Chaque acteur, chaque écrivain veut toujours défendre ses personnages et ils ont bien raison. Même les crapules, même les monstres. Montrer les bassesses irrécupérables de la psyché humaine, ce n’est pas les défendre.
Maigres espoirs.
Au milieu de ce théâtre d’horreurs, seuls deux personnages nous offrent des éclairs d’humanité. L’escroc, donc. Et la fillette du couple. Cantet trouve une astuce pour amorcer le dénouement et la « révélation » finale : le spectateur comprend petit à petit qu’ils savent, mais n’osent pas lui dire. La femme se réfugie alors dans la cuisine parce qu’elle ne peut plus écouter les balivernes de son mari, et la gamine vient alors, silencieusement, voir si sa mère encaisse le coup. Pas une ligne de dialogue, juste l’attention d’un personnage pour un autre qu’il sait souffrir. Retour au naturalisme d’Antoine : un plan, un décor, une situation et pas une ligne de dialogue. Le silence de la vérité.
En dehors de cet éclair d’humanité, le film n’expose rien d’autre que la bassesse humaine. Une posture faite pour la satire, l’excès, la monstruosité, pas pour le naturalisme.
L’Emploi du temps, Laurent Cantet 2001 | Haut et Court, Arte France
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci. (Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel