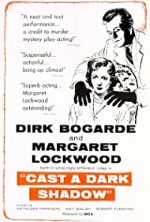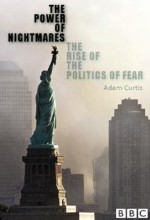Not all men

Last Night in Soho
Année : 2021
Réalisation : Edgar Wright
Avec : Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Diana Rigg, Terence Stamp
Les joies du confusionnisme. Pendant près d’une heure, on s’agace en voyant cette pauvre gamine ne pas aller voir un psychiatre, tout dans ses visions faisant penser à de la schizophrénie. Cela n’aurait rien coûté de balayer rapidement cette hypothèse ou d’inventer un subterfuge en guise de justification pour ne pas avoir à le faire (comme on le fait pour justifier de ne pas appeler les policiers dans un film criminel). On lève alors les yeux au ciel en comprenant au moment du dénouement que ses visions s’appuient sur des événements réels… qu’elle identifiait mal. L’horreur, le fantastique, c’est bien, mais quand ça tient d’une explication moisie justifiée sur le tard, on s’enfonce rapidement dans le ridicule. Et c’est d’autant plus vrai, pardon, mon cher Edgar (pas Poe), que les hallucinations de la gamine n’ont rien de simples visions rattachées à un espace hanté ou à une quelconque sorcellerie : quand elle est dans la bibliothèque et qu’elle attaque une élève suite à des hallucinations, c’est typiquement un type de situation que l’on peut rencontrer avec des schizophrènes. Pour le coup, aucun rapport avec un passé bien réel… Ne pas donner des explications à son comportement à ce moment-là est plutôt problématique… Première confusion qui me pousse à faire “beuh”.
Second niveau de confusion : le rapport aux victimes, aux mâles comme la société actuelle ne veut plus en voir (des prédateurs, pour faire court) et aux assassins. Déflorons l’intrigue. Une étudiante s’installe dans une vieille chambre dans le quartier de Soho ; elle ne tarde pas à avoir des visions sur une aspirante chanteuse dans les années 60 et « apprend » qu’elle aurait été abusée par une série d’hommes que son manager lui aurait fait rencontrer. Ses visions lui indiquent bientôt que cette chanteuse aurait été assassinée par ce même manager parce qu’elle ne se pliait pas à ses exigences ; elle pense y voir un crime non résolu, et court en informer la police qui ne la prend pas au sérieux. Arrive le twist où les masques tombent, et patatras, l’assassin était en fait la victime, la logeuse, qui s’en serait prise aux hommes qui l’avaient précédemment abusée. Donc, quoi ? Finalement,… not all men ?
Dans ses visions, quand elle comprend que ceux qu’elle croyait être, seulement, ses bourreaux sont aussi les victimes assassinées par sa logeuse, elle refuse de les aider quand ils lui demandent son aide. Soit, c’est de bonne guerre. La réplique est amusante d’ailleurs, très esprit metoo radical. Sorte de revenge movie par procuration. Sauf que les implications dramatiques deviennent difficiles à justifier : la gamine comprend le fin mot de l’histoire alors qu’elle est censée être sous somnifère (elle retrouve toutes ses facultés, on se demande comment), et si elle refuse de venir en aide aux abuseurs devenus à leur tour victimes qu’elle voit en hallucinations…, de quel côté va-t-elle se placer quand la mamie psychopathe (victime autrefois de ces abus mais devenue par la force des choses une tueuse en série) se trouvera en face d’elle ? Tu as trois secondes pour réfléchir, lady, parce que mamie arrive enfin de sa longue montée des escaliers ! Alors ?… Inutile de réfléchir, mamie décide pour toi. Et que tu sois une fille ou un mec, pour la boomeur, ça ne change rien à l’histoire : la sororité, elle la poignarde en plein cœur ! Aucun respect pour les féministes 2.0, ces bonnes féministes des 60’s qui ont mal vieilli.

Sérieusement, faut pas pousser mamie dans les orties, ça n’a aucun sens. Confusionnisme total. L’ironie, sans doute, c’est probablement encore qu’on ait affaire ici à une sorte de justification par l’absurde du mouvement metoo par ceux qui justement sont les moins bien placés pour en justifier les excès : les hommes. Confusion et tartufferie. Si on voulait résumer en un film d’absurdité de metoo, il aurait bien sûr fallu y mettre un peu de male gaze. « Mesdames, je vais faire un film pour vous défendre, vous, les victimes. Ce sera trash. Les hommes vont en prendre pour leur grade. » « Cool. » « Et puis, le twist est génial. » « Ah ? » « À la fin, c’est la femme qui est coupable. » « Heu. »
Dans Scary Movie, parfois, on peut être amusé de ne plus savoir qui sont les assassins et les victimes. Mais c’est volontaire. Ici, on rit jaune (giallo peut-être), parce que plus personne ne semble savoir qui sont les agresseurs ou les victimes ou les deux. Le film d’une époque, assurément où chacun voudrait pouvoir prétendre juger de qui est qui alors que le monde n’est, pour nous et à notre petite échelle, qu’un grand flou halluciné. La vie n’est pas une fiction : la première chose à faire, c’est d’aller voir la police, de laisser faire la justice, et de surtout ne jamais se fier à ses intuitions. Les intuitions traduisent le monde comme on veut le voir ou comme on le craint ; elles nous rendent surtout les choses simples, créent un récit cohérent avec peu de matière. Un récit, ce n’est pas la réalité. Pas plus que la gamine dans le film, on n’est apte à juger de ce que l’on pense voir ou comprendre. Connaissant son passif familial, elle aurait dû s’en remettre à un psy, comme nous n’avons d’autre choix que de nous en remettre à la justice quand surviennent des faits dont la nature précise reste floue. Intuitions, hallucinations, même combat. Si le film pouvait au moins servir à cette conclusion, ce serait déjà pas si mal, mais je suis probablement le seul à forcer ainsi cette interprétation. Le confusionnisme a ses vertus : je m’efforcerai toujours à trouver un sens personnel à un grand n’importe quoi. (Quand le film que l’on vous propose est mauvais, tentez toujours d’y créer le vôtre.)
Tout cela est bien dommage, parce que tout le reste est parfaitement réussi (production, réalisation, interprétation, musique). Plaisant à regarder, mais indéniablement mal fichu.
Last Night in Soho, Edgar Wright (2021) | Focus Features International, Film4, Perfect World Pictures