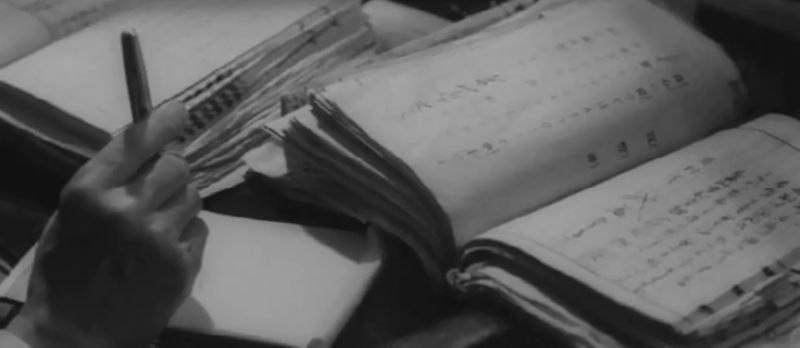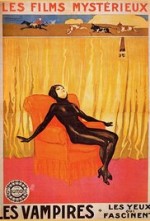Je connaissais à peine Yôji Yamada (en 2013), mais c’est une histoire de Seichô Matsumoto (Harikami et The Castle of Sand, deux favoris) et une adaptation de Shinobu Hashimoto (déjà les deux adaptations des deux Matsumoto précités, et une pagaille de grands films de Kurosawa, Kobayashi et même de Naruse : Rashômon, Les 7 Samouraïs, La Forteresse cachée, Dodeskaden, Hara-kiri, Rébellion, Le Sabre du mal, Nuages d’été, Kotan…). Il y a également Michiyo Aratama (Suzaki Paradaisu : Akashingô, Kokoro, Ningen no jôken, et encore Le Sabre du mal, Nuages d’été…).
J’étais donc assez impatient de voir ce que ce film pouvait donner. Résultat, c’est un chef-d’œuvre.
C’est un de ces films avec un bon sens de la morale qui nous questionne sur notre propre identité, sur notre capacité à percevoir ce qu’il y a en nous et chez les autres de bien ou de mal, qui montre du doigt les véritables problèmes de nos sociétés grâce à une intrigue complexe dans laquelle chaque personnage opposé n’agit pas pour s’opposer à l’autre, mais au contraire pour préserver ses enjeux personnels. Au début, pas de mauvaises intentions. C’est toute une subtilité qui peut faire une grande différence, parce que les personnages ne sont pas antipathiques : ils cherchent, ou en tout cas donnent l’impression, de chercher une solution ensemble, et ce sont les circonstances qui font que leurs conflits ne peuvent pas se résoudre… Et c’est seulement une fois que l’opposition est inévitable qu’on sort les crocs. Aucune méchanceté, juste de l’instinct de survie, et ça rend ces personnages follement humains.
Il y avait ça déjà dans Le Vase de sable. Harikami un peu moins, il était plus simple dans sa structure mais au bout du compte, il revenait sur ce même type de sujet, celui de la culpabilité révélée, la faute de jugement… Et chez un autre auteur, on avait aussi cette même touche dans Le Détroit de la faim. C’est assez comparable aussi à des films de cette époque, comme certains Masumura, Une femme confesse et The False Student. Ce sont des films presque engagés politiquement ou qui semblent du moins montrer la dureté et l’injustice d’un système. Jamais de discours un peu pesant comme certains films politiques de la même époque en Occident, on reste dans le constat, même si les conclusions qui s’imposent sont assez évidentes : il y a une justice des pauvres et une justice des riches.
Le sujet est clair. C’est celui qui nous est présenté tout de suite. On va droit au but.
Une jeune fille traverse tout le Japon pour demander à un grand avocat d’accepter de défendre son frère (unique membre de sa famille qui lui reste) qui est accusé du meurtre d’une vieille femme à qui il devait de l’argent. Son frère risque la peine de mort. Malgré son insistance, l’avocat refuse de prendre l’affaire : elle n’a à la fois pas l’argent demandé pour couvrir les frais, c’est trop loin, et les preuves semblent accabler son frère.
Ensuite, ce que propose le film, c’est d’illustrer et d’aller plus loin que le simple constat du « il y a une justice des pauvres et une autre pour les riches ». Si les pauvres ne peuvent accéder à la meilleure défense qui soit pour avoir une justice équitable, alors ils « peuvent » se retourner contre elle, et contre ceux qui, eux, profitent d’une justice avec des moyens confortables.
Le développement de l’intrigue est parfois totalement improbable ; il y a beaucoup de coïncidences forcées ; mais c’est un film presque à thèse, seule l’intention, le point de vue compte au final. Inutile de chercher une crédibilité dans ces rencontres et ces coïncidences, c’est comme une allégorie, pas réaliste pour un sou, pour être plus représentatif de la vérité, de la cruelle vérité. L’intrigue sert à illustrer une idée, et le récit n’a qu’une obstination, rester dans cette idée.
Il faut à peu près une heure pour que l’histoire se retourne comme pour montrer l’autre face d’une même pièce. Les mêmes événements se reproduisent presque de manière identique (c’est là par exemple que ça ne peut pas être crédible, mais encore une fois, ce n’est pas du tout gênant, au contraire, on sent la volonté d’opposer les deux solutions, les rapprocher le plus possible pour montrer que tout ce qui changera ce ne sera que le compte en banque des accusés — ou presque, à un détail près bien sûr). S’il n’y a pas de justice pour les pauvres, il n’y en aura pas non plus pour les riches… C’est un peu le héros tragique qui décide de jouer à Dieu et de forcer le destin… des autres. Le mythe bien japonais de la lady vengeance.
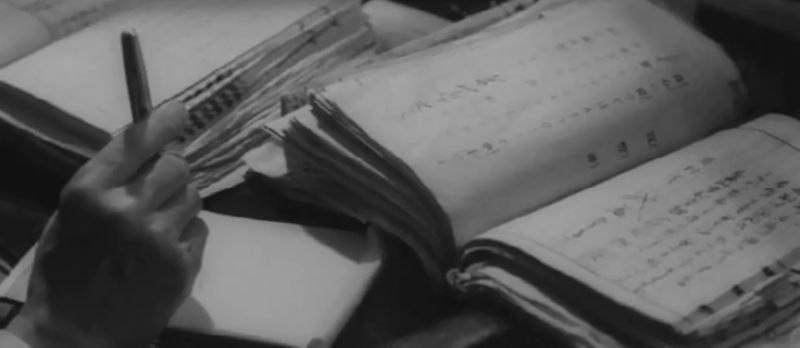

Ensuite, la structure de l’intrigue est montée à la perfection. Tous les éléments donnent l’impression qu’ils ont été créés pour un jour se rencontrer et se percuter. Comme dans un film de procès ou d’enquête policière, tous les éléments classiques de ces intrigues ne sont que du détail ; ce n’est qu’un prétexte à mettre les différents protagonistes en face l’un de l’autre pour faire ressortir leurs différences. Tout montre à quel point chacun des personnages est relié à l’autre, dépend de l’autre, mais en est aussi presque esclave. Elle attend de l’avocat, au début, qu’il défende son frère à son procès ; on ne peut pas imaginer personnage plus dévoué envers sa famille (son frère, qui n’est en fait pendant le film qu’une ombre puisqu’on ne le voit qu’à travers des flashbacks — l’angle, encore une fois, ce n’est pas le drame d’un procès bâclé, donc il peut crever à la limite, c’est juste accessoire et parfaitement hors sujet ; on ne le montre pas, on le fait dire pour signifier l’évolution dans le personnage de sa sœur). Et de l’autre côté, l’avocat est asservi à sa situation d’homme respectable, prisonnier aussi de son amour pour la femme qu’il veut sauver, dépendant finalement de la femme à qui il avait autrefois refusé son aide. Tragique, mais c’est aussi finalement le même petit jeu qui se joue à différents niveaux : je t’aide, tu m’aides, tu ne m’aides pas, je te nuis. La vie est une toile d’araignée tragique.
Ce qui est remarquablement rendu, c’est donc cette opposition entre ces deux personnages. A priori le rapport de force est inéquitable, et il est même inédit sous cet angle : une jeune fille pauvre de province et un grand avocat de la capitale. Mais les hommes, tous les hommes ont des faiblesses, surtout en face des jeunes filles… Une jeune fille d’autant plus attirante dans l’imaginaire japonais qu’elle est vierge, et qu’une confusion entre sexualité et vengeance renforce un peu plus la force de sa quête. On ne parle jamais de cette sexualité, parce que dans son obstination, elle ne peut pas penser à autre chose. Et quand il en est question à la fin, c’est un détail à la fois tragique et révélateur de son engagement… Comme une arme qu’elle se réservait en dernier recours. Une arme que, dans son intelligence (et non son machiavélisme comme chez certaines femmes dévorées par une vengeance féroce), elle avait prévue dès le début de se servir en espérant ne pas devoir l’utiliser…
Il y aurait pu donc y avoir un conflit frontal, brutal, manichéen. Et ce n’est pas du tout ça. On comprend que chacun a ses raisons, et d’ailleurs, ils font d’abord, et plus d’une fois, l’effort de comprendre et d’aller vers l’autre. Mais quand deux mondes sont autant séparés… Ç’aurait été une tragédie grecque, on aurait dit que les dieux décident à leur place. Le destin. C’est une tragédie moderne. Ou une pièce de Corneille : la sœur qui veut défendre l’honneur de son frère quitte à perdre le sien, quitte à vouer toute sa vie à cette même idée de réhabilitation. C’est une révolte sourde, froide face à l’injustice. Quand on est poussé par une certaine forme de devoir par la vengeance qu’on n’a pas forcément recherchée mais qui s’est proposée à vous et qu’il ne fallait plus qu’à saisir au vol, une opportunité…, eh bien, on décide, parce qu’on pense que c’est juste, et même si on sait que ce n’est pas juste, c’est une manière de se rendre justice soi-même, puisque la vraie justice, elle, a failli.


Bref, fascinant, profond et très instructif sur le monde et la société. Oui, nous pouvons difficilement nous affranchir de notre « classe ». Même avec la meilleure volonté du monde, même en étant positif et sympathique. Et on ne peut pas aller contre les règles de la société. La société est injuste et imparfaite. La littérature et le cinéma posent le constat ; ils ne jugent pas, ne proposent rien. Chacun à sa place.
Un mot sur le découpage très serré des scènes. Comme en littérature, c’est difficile d’arriver à ne pas s’installer dans une scène. En une phrase, on peut décrire une situation sans avoir besoin de la mettre en scène. Ici, c’est pareil. Le film prend même le parti d’arriver vers la fin à montrer l’évolution des personnages à travers le même mouvement : rencontre dans un bar, puis discussion en le quittant. La même scène revient ainsi plusieurs fois, un peu comme dans In the Mood for Love. C’est de la musique : c’est répétitif, mais à chaque mouvement, ça change imperceptiblement. C’est un jeu des sept erreurs : il faut être attentif aux détails et déceler ce qui a changé dans les relations des personnages. C’est rendu possible grâce à une maîtrise parfaite de la technique narrative, notamment en matière d’unité d’action : une trame et une seule, comme une obstination, les détails importent peu, seuls comptent ces éléments de l’intrigue qui évoluent quand tout le reste est statique ou dans le flou. Ensuite, c’est la densité des images, la rapidité d’exécution qui fait le reste.
Dès le générique, on est fasciné par toute cette séquence dans laquelle le personnage principal passe des heures, passant d’un train à un autre pour rejoindre la capitale. L’actrice est parfaite. On comprend presque la situation, l’humeur du film en trois secondes. On comprend qu’on ne la verra jamais sourire parce qu’elle est dévouée totalement à son affaire. Elle ne fait pas la gueule, elle n’est pas triste, mais déterminée. Un peu comme l’obstination qu’a le Comte de Monte-Cristo, d’abord à sortir du château d’If, et ensuite à préparer sa vengeance. Ce n’est pas la détermination d’une petite sotte : on sait déjà, dès cette première image, que si elle n’a pas ce qu’elle cherche, elle continuera encore et encore sans se démonter. Une obstination concentrée sur une seule chose : justice pour son frère. Et c’est seulement à la moitié du film alors, quand il n’y avait plus d’espoir, que les circonstances vont lui permettre de passer au niveau supérieur, l’ultime remède contre un monde qui ne tourne pas rond : la vengeance. La justice solitaire et rebelle des laissés-pour-compte.
C’est un type de personnages qu’on adore parce qu’il ne s’égare pas et fait tout jusqu’à la fin pour rester digne et droit. C’est seulement grâce à cette force de caractère, cette volonté de rester « vierge » à tous les niveaux, qu’on peut comprendre l’injustice qu’elle traverse et le revirement fatal qu’espère presque comme une délivrance le spectateur. Elle semble ne pas avoir de vie propre : elle défend son frère, point. Tout le reste semble aller inexorablement vers cette vengeance. Elle n’y a jamais pensé pourtant, au début. Ce sont les circonstances qui vont lui offrir une opportunité. Dans un premier temps, au contraire, c’est un ange. Elle n’en a jamais voulu à l’avocat. Ç’aurait été trop facile d’en faire une vengeresse immédiate, et moins efficace, parce que le but, c’est justement de ne pas dire qu’il y a les bons et les méchants, mais que même s’il y avait « des bons et des méchants », ils intervertiraient les rôles de temps en temps. Le spectateur doit sentir cette noblesse, cette résistance, et il doit se dire qu’il aurait cédé plus tôt. Seulement alors, on est prêts à accepter, à comprendre qu’elle profite d’une opportunité… Seulement alors, on est prêts à comprendre les coupables, tous les coupables.