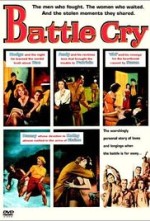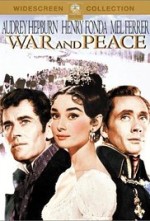La Guerre des boutons de manchette

Les Tricheurs

Année : 1958
Réalisation : Marcel Carné
Avec : Pascale Petit ⋅ Andréa Parisy ⋅ Laurent Terzieff ⋅ Jacques Charrier
Il y a quelque chose de savoureux dans certains films des années 50. Une certaine France, un certain parisianisme. Un peu comme voir ce que serait un film français sous influence du code Hays. Oui, on peut parler de sexualité, c’est même préférable pour avoir l’air impertinent, mais les personnages doivent être des beaux quartiers, et quand ils font des âneries, il faut pouvoir les montrer sous leur meilleur jour. On ne prête qu’aux riches le droit de faire des conneries…
Alors sûr qu’en voyant ça, on ait envie de faire la révolution, de créer la nouvelle vague. Une critique sur IMDb fait le rapprochement avec La Fureur de vivre. Mouais…, il était question d’une vraie middle class et de réels troubles existentiels d’un petit jeune des suburbs. Or, ici, de conflits, il n’en existe qu’entre des riches (ou une élite) avec des encore plus riches. La rive gauche contre la rive droite ; Saint-Germain-des-Prés contre les grands boulevards ; les pseudo-existentialistes contre les matérialistes. La guerre des boutons de manchette… Ah, oui, c’est ça la France. La France, c’est Paris, et Paris se limite aux 6 arrondissements centraux. Le gang de la rive gauche qualifie un gosse de riches habitant les Champs, de « banlieusard ». Eh, oui, tu as une Rollex, mais tu n’habites qu’aux Champs Élysée, tu ne peux pas avoir réussi ta vie, tu n’es qu’un simple banlieusard. Et moi qui suis né dans le XIVᵉ (le Petit Montrouge, le quartier où vécut Lénine — « Salaud, merdeux, communiste ! »), dans ces années 50, je devais donner l’air de venir de la Sicile pour ces jeunes existentialistes. Ah, il est où le Paris de Prévert, Marcel ?… Reste comme contestation, une jeunesse qu’on retrouvera aux Cahiers pour conspuer ses anciens, jusqu’en 68 où on occupera la Sorbonne comme on prenait la Bastille. Ou presque. La France, pardon Paris (l’anti-Commune), le seul pays au monde où même l’élite se croit contestataire, où la haute société se rêve en rebelle (le “en” étant de mise, comme on dit « en Chanel »). Le bourgeois, c’est toujours l’autre, celui de la rive d’en face.
Facile de comprendre pourquoi Truffaut haïssait le film. Né à Neuilly (ah, le bon air provincial, presque marin, du grand Ouest !) et élevé dans des arrondissements limitrophes du « Grand Paris », comme le personnage principal de ce film (8ᵉ, 9ᵉ, Champs Élysée), ça aurait pu être son histoire. La vie d’un petit gars de la rive droite se rêvant artiste, intellectuel… de la rive gauche, quoi. Un vrai rebelle without a cause, mais avec une vraie fixation sur la chose sexuelle. Laissez-moi deviner : on sent encore dans ces quartiers l’air du libertinage. Sur l’autre rive, Sade y est embastillé, et il va falloir aller le libérer ! « Baissez vos culottes, libertins du quartier latin ! À bas les conservateurs ! »… Mieux vaut être libertin que libéral, alors il faut instaurer une coopérative du cul. Tu peux baiser ma chatte, mais évite de me piquer mon sac. Comme le dit Laurent Terzieff au personnage principal du film venant de sa lointaine banlieue : « Bourgeois radin ! »

Les Tricheurs, Marcel Carné 1958 | Les Films Corona, Silver Films, Cinétel
Alors le film est une sorte de mix entre Sex and the City et American Pie… « J’ai un terrible problème : je ne peux pas me payer cette Jaguar ! » ou encore : « J’ai un gros problème, je crois bien que je suis enceinte, et je n’ai aucune idée de qui est le père. Bon d’accord, on s’en fout : continuons la surboum ! » Et au moment des grandes révélations, même le père, capitaine d’industrie, doit passer aux aveux : « J’ai quelque chose d’affreux à vous avouer : quand j’avais 20 ans, j’étais socialiste. »
C’est un sport national. Il faut vomir sur son voisin, il faut regretter ses origines et s’en inventer de nouvelles, il faut aspirer à devenir autre chose que ce que l’on est. La révolution, la contestation permanente, c’est la norme. Même les classes privilégiées doivent médire sur les classes encore plus privilégiées. Le règne de la Terreur et des coupeurs de têtes ; le règne du « faites ce que je dis, pas ce que je pense » ou de « l’égalité, surtout pour les autres ». Celui qui n’est pas rebelle n’est pas dans la norme. L’argent, c’est le vice, et tout le monde est de (la rive) gauche. Inquisition permanente des consciences, des bords, des rives (curieux terme de “Marais” d’ailleurs, qui serait une sorte de prolongement de l’esprit de la rive gauche sur la rive droite, un débordement marécageux, comme peut l’être le lointain XVIIIᵉ).
Alors comme Truffaut, oui, je me lâche sur ces personnages de faux voyous, sur ce gang de petits richards. Mais au fond, si je vomis sur eux, c’est parce que je les aime bien. Ce sont mes voisins. Surtout, on préfère toujours ses grands-parents à ses parents. Truffaut méprisait ce Carné-là pour mieux exprimer sa différence, mais moi, n’aimant ni l’un ni l’autre, devant tuer le père, je dois bien me résoudre à ne pouvoir me plaindre qu’auprès de Carné (surtout, avec un peu d’hypocrisie, de la maltraitance dont il a fait l’objet par ses enfants — sorte d’atavisme existentialiste).
Une histoire de grand-père, c’est bien ça. C’est la France de Sade, ces histoires sont forcément des histoires de cul. L’aspect transgénérationnel est fascinant. Truffaut fera finalement exactement le même genre de film avec sa série des Doisnel. « Oh, papa, laissez-moi être un rebelle, partir pour Cuba faire la révolution ! Et je reviendrai pour reprendre les affaires de la famille ! » Eh, oui, tous les vingt ans, à chaque nouvelle génération, c’est la même rengaine. Et finalement, rien ne change. La révolution, ce n’est finalement qu’un tour complet sur soi-même. Un petit tour et puis revient. Avec le vent qu’on produit, on pourrait en faire tourner des éoliennes… Je porte la mienne sur ma casquette, elle me va bien.


Rien ne change ? La musique peut-être… Pas vraiment. Seconde moitié des années 50, le bonhomme qui rêve de s’acheter une Jaguar se rend à une fête avec son pote du 8ᵉ arrondissement : « eh ! mais ils dansent encore le cha-cha-cha ! » Et Carné suggère que la musique révolutionnaire en 1958, c’est le jazz. Pourquoi pas, d’ailleurs la bande des Cahiers ne dira pas autre chose. Sauf qu’on est trois ans après Graine de violence. Eh oui, Marcel, 1958, c’est déjà le rock’n’roll !
Alors le film n’est pas mauvais en soi, techniquement parlant. Mais comme on peut dire que la France, sans les Français, ce serait mieux, ici on pourrait dire que le film serait plus agréable à voir sans cette bande de cons (pardon pépé). Le film pousse au parricide (ou au pariscide). Tourné en studio, on ne rêve qu’une chose en les voyant : sortir dans la rue. Elle peut bien planter sa Jaguar dans un arbre, l’héroïne, comme Françoise Sagan, ça reste la rébellion d’une fille du code Hays (ce n’est pas bourgeois de s’imposer des règles auxquelles on n’est même pas soumis ?) : surtout, que ce soit des personnages de bonne famille. Et quelles que soient les conneries dont ils se rendront coupables, il faut toujours le montrer sous un angle positif. Alors fonce, Mic, mourir en Jaguar, c’est trop chic. Les gens heureux n’ont pas d’histoire, et les familles sans histoire nous emmerdent : il faut bien avoir des tragédies pour se (faire) plaindre. Sinon, on n’est plus Français. Une bonne famille française, c’est une famille pleine de drames. Si tu as des grands-parents qui ne sont ni résistants ni collabos, si tes parents sont ni communistes ni libertins, ni fan de Coluche ni fan de Christian Clavier, si tu ne connais personne victime d’inceste, de suicide, qui soit mort d’une overdose, d’un accident de voiture, d’un cancer (au choix, foudroyant, ou long), si tu ne te plains pas de ce que tu gagnes ou de ce que tu as perdu, des politiques, si tu ne grondes pas contre les profiteurs, les riches, les étrangers, les Parisiens, les vieux, les laids, les cons, si tu détestes ou si tu adores ce film, mais allô quoi, tu n’es pas Français ! Un Français, ça ouvre sa gueule pour dire n’importe quoi, ou ça démissionne !
Marcel ? Je démissionne. Guitry avait raison (à moins que ce soit Cambronne).