Vu il y a une quinzaine d’années sans en avoir compris les enjeux “idéologiques”. Je n’y avais vu que le parcours d’un ambitieux… Tout faux.
C’est en fait le récit d’un homme intègre (ça, c’est ma vision en 2011, parce qu’elle a de nouveau changé en 2016 après la lecture de la Grève). Roark (Gary Cooper) est un architecte aux idées affirmées. Il refuse le conformisme et le goût populaire (celui qui a tendance à dénigrer l’art contemporain). Le film oppose son parcours, ses idéaux, à un “ami” architecte, Keating, qui est prêt à tout pour réussir, qui n’a aucune originalité et qui est prêt à donner ce que le public recherche. Au début, Keating pousse son ami à oublier ses idéaux et à accepter des projets aux goûts du public ; mais Roarks refuse et préfère aller travailler dans une carrière de pierre en attendant des jours meilleurs… Intégrité un peu forcée, et alors ?… ça force le respect, oui.
Keating rencontre l’homme d’affaires puissant, Wynand, issu des quartiers pauvres de New York, qui a monté tous les échelons de la société et qui a une vision cynique de l’homme. Il est plus conscient en cela de la réalité des hommes que Keating qui est juste un arriviste, un ambitieux qui n’a aucune vision et compréhension du monde. Keating est donc invité chez lui mais Wynand n’a d’yeux que pour sa fiancée, Dominique Franon, qui travaille pour son journal populaire, The Banner, et qui est fasciné par son désir, malgré la volonté de chacun à la réussite, de ne pas faire de compromis. Cherchant un architecte, un bon, un vrai, pour son immeuble, il avait d’abord fait appel à la grande plume de son journal, Toohey, mais les idées conformistes de celui-ci lui avait déplu et avait eu l’idée de demander l’avis de son autre critique, abonné aux dernières pages de son journal. Leur première rencontre était fascinante : Wynand vient trouver Francon chez elle pour lui demander son avis, et il la trouve en train de lancer par la fenêtre une statue antique. Quand Wynand lui demande pourquoi elle fait ça, elle lui répond qu’elle ne supporte pas de s’attacher à une chose qu’elle aime tant… Là commence la fascination de Wynand pour Francon : le courage d’assurer son intégrité, ses goûts, contre le conformisme et la facilité, lui qui est parvenu au sommet en faisant tout le contraire (il y a un petit côté Kane dans ce personnage — décidément). Et v’là la scène qui tue. Wynand décrit froidement à Keating sa vision du monde et des hommes, lui assurant que chaque homme était avant tout vénal. Keating n’est pas convaincu, Wynand lui propose donc de casser ses funérailles avec Dominique Francon contre un contrat avec lui. Keating est gêné, on comprend… Francon lui dit que c’est une occasion à saisir : il s’est fiancé avec elle, car elle est la fille d’un architecte célèbre, mais travailler avec Wynand serait une upgrade plus intéressante. Alors Keating accepte. Wynand propose à Francon de l’épouser, mais elle dit qu’elle s’est fiancée avec Keating parce qu’elle lui semblait tout à fait insignifiant, et qu’elle accepterait de se marier avec lui le jour où elle aurait définitivement perdu tout espoir.


C’est à ce moment que Dominique Francon va rencontrer Roark. Elle ne sait pas qui il est. Il travaille dans les carrières de son père, mais il la fascine. Pourtant, elle n’est pas du genre à se laisser séduire. On a donc droit à un puissant jeu de je t’aime moi non plus. Quand la Francon vous insulte, c’est qu’elle est déjà à vos pieds. Ils se séparent, sans que Roark lui dise son nom…
Finalement, la chance sourit à Roark quand un riche industriel lui demande de construire un immeuble suivant son style. On est dans les années 20, et l’époque est plutôt au classicisme des colonnes grecques. Roark est un peu le symbole d’une architecture moderne (tout ce qui paraît bien laid aujourd’hui…, c’est bien de faire preuve d’originalité, mais il y a des matériaux qui vieillissent vraiment très mal). L’immeuble fait grand bruit. Dans le petit cercle des initiés, on est fasciné, et si certains, assez rares, reconnaissent le génie de Roark, d’autres veulent l’épingler justement à cause de ce génie et de son audace. Dominique Francon, elle, est tombée une seconde fois amoureuse de Roark sans le connaître, elle a même remis sa démission au Banner parce qu’elle n’était pas d’accord avec la ligne éditorialiste du journal qui voulait le démonter. Ils se retrouvent enfin, mais la garce n’est toujours pas prête à se laisser séduire… Il faut se rappeler l’épisode de la statue antique. La médiocrité vous laisse indifférent ; le génie vous rend esclave : il faut s’en éloigner pour s’en prémunir… Fascinant jeu à la fois d’attirance et de répulsion.
Pour ne pas devenir l’esclave de son amour, comme d’autres deviennent les esclaves de leur ambition (c’est Toohey qui dit que les ambitieux sont esclaves de leur désir d’arriver au sommet), elle accepte de se marier avec Wynand… (On peut très bien balancer les statues antiques par la fenêtre…, les modèles de la tragédie grecque sont toujours là.)
Wynand est décidé à choisir le meilleur architecte pour construire une maison qu’il veut dédiée à sa femme. Il connaît la médiocrité de tous ces architectes aux goûts conformes à ce que ses lecteurs attendent, il ne veut rien de cela (vive la contradiction). Et il tombe fatalement… sur Roark qui n’obtient que des petits chantiers (comme des stations-service) mais qui se font remarquer encore par leur audace. Les deux hommes finissent par devenir amis (Roark ayant la noblesse d’âme de ne pas lui en vouloir pour ses papiers : il répondra même à Toohey qu’il rencontre par hasard qui lui demandait pourquoi il ne lui en voulait pas et à quoi il pouvait donc bien penser de lui… Roark répondra « je ne pense pas à vous » La bave du crapaud n’atteint pas la blanche colombe…). Francon est obligée de supporter cette nouvelle amitié, à en devenir jalouse, obligée de vivre dans une maison conçue par l’homme qu’elle aime, lui rappelant ainsi sans cesse sa lâcheté de s’être refusée à lui…


Keating réapparaît alors pour demander de l’aide à son vieil ami Roark. Il voudrait décrocher le contrat d’un immeuble social construit par la ville dont la difficulté est de le construire pour pas cher tout en en faisant une véritable œuvre architecturale. Un défi à la Roark. Celui-ci accepte de lui dessiner les plans à une seule condition : qu’il ne change rien, qu’il ne se laisse pas influencer par les désirs des promoteurs de travestir son œuvre. Keating accepte. Le projet est lancé, mais comme on pouvait s’y attendre, les promoteurs demandent à Keating d’effectuer quelques modifications qui plairont un peu plus au public et correspondront plus à la mode du moment. Keating pour honorer la promesse faite à son ami. Mais le projet est lancé sans qu’il puisse s’y opposer. Roark, voyant son projet dénaturé, décide ni plus ni moins… de la dynamiter ! Un procès a lieu. Ce sera le procès de l’individualisme. Pour sa défense, Roark dit que c’est le procès de la liberté de la création… Il gagnera son procès, les valeurs américaines sont préservées (en gros, on peut dynamiter des immeubles du “peuple” si l’architecte estime qu’on a dénaturé son travail… vive l’Amérique !).
Si la morale du film, surtout à la fin, est plus que douteuse (et il faut bien le dire assez contradictoire), il faut surtout relever la structure et la caractérisation des personnages. On dirait presque une formule mathématique. Rien ne dépasse. Tout est fait pour démontrer une idée, celle de la scénariste (Ayn Rand adaptant ici son propre roman). On ne s’embarrasse pas de vraisemblance. Par exemple, c’est un peu curieux de voir que lors du procès, Roark n’a pas d’avocat : ce n’est pas expliqué par une ligne de dialogue, c’est jugé accessoire. De même, on trouve des personnages aussi affirmés, ayant des idées aussi tranchées et les assumant jusqu’au bout, parfois même jusque dans leurs contradictions (comme Wynand qui sait écrire un journal populiste, mais qui méprise le goût conformiste du peuple). C’est dommage que les scènes soient souvent seulement axées sur les dialogues, qu’il y ait un petit manque de mise en situation de réelle mise en scène, parce que finalement, l’histoire n’est pas beaucoup moins “épique” qu’un Citizen Kane, seulement la mise en scène, elle, manque vraiment d’ambition, de personnalité. Un paradoxe pour un film dont le message principal, c’est qu’il faut éviter tout conformisme.


Sur la question des thèmes du film, comme je l’ai dit, je suis assez partagé. J’adore tout le début du film dans lequel Roark se montre intègre, ne voulant rien lâcher sur ses principes. Les discours sur l’homme esclave de sa propre réussite, c’est assez parlant aussi. Mais la fin, on est presque déjà dans le maccarthysme qui débutera juste après en 1950… Comme quoi les idées sont dans l’air. Pourtant, on n’est pas dans l’anticommunisme pur. C’est même assez difficile à cerner. Parce que l’auteur dénigre les hommes vénaux capables de tout pour gagner du blé mais loue la vertu de l’individualisme absolu. Qu’est-ce que l’individualisme sinon une volonté surtout de se faire sa place dans le monde ?… C’est surtout une vision qui s’applique aux intellectuels et aux artistes. Pour être un bon artiste, il faut affirmer ses idées contre la conformité. Mais là aussi, on pourrait remettre en doute l’intérêt d’une telle vision, parce qu’on le voit bien aujourd’hui, les non-conformistes, ce sont justement ceux qui arrêtent de dire “je” ou qui veulent à tout prix « être originaux ». On l’a même vu en architecture. Dans les années 20, je veux bien concevoir qu’un mec qui voulait casser tous les codes, épurer, faire des lignes audacieuses pour se démarquer du reste, ait des difficultés pour se faire accepter. Mais quand il n’y a plus que ça. Quand chacun veut montrer sa différence, son génie, on frise le n’importe quoi. Quand il est question d’architecture, il est question aussi d’unité avec le reste du style de la ville. Et plus encore, avant d’être une œuvre d’art, un bâtiment a une fonctionnalité. Alors, quand à la fin du film, Roark se justifie d’avoir dynamité un HLM (parce que c’est vraiment de ça qu’il s’agit) en disant que c’était son œuvre à lui et qu’il avait le droit de le faire parce qu’on l’avait dénaturé sans son accord…, bah ce n’est pas se prendre pour de la merde franchement. Il faut à la fois savoir être orgueilleux, affirmer ses convictions, mais aussi rester humble face à sa propre importance… On peut ne pas être pour les masses, la collectivité, mais se foutre de la gueule du monde, « moi je, et le reste du monde, c’est de la merde », c’est assez limite. L’individualisme, c’est bien, mais ça ne marche qu’avec le respect des autres. C’est comme la liberté, on dit bien qu’elle s’arrête là où commence celle des autres. Mais on l’a compris, la scénariste est pour le libéralisme sans barrière et sans règle, à la Reagan.
Dommage que ce film génial soit pollué par ce discours au procès. Vidor semblait vouloir l’abréger, mais l’auteure se l’était jouée à la Roark : j’accepte de vous céder les droits d’adaptation pour le cinéma si le discours de fin de Roak est filmé dans son intégralité… Bourrique. OK, sauf qu’on aurait aimé un peu de cohérence dans tout ça. Le reste du film n’est pas aussi extrémiste.
Certains ne verront que la fin, et d’une certaine manière ils auront raison parce que l’intention d’un film est toujours délivrée à la fin. Mais connaissant Vidor, on se dit que finalement ça ne mange pas de pain. La finalité est une escroquerie, mais le cheminement pour y arriver est trop fascinant pour bouder son plaisir.
Commentaire à propos de la fin (2013) : On l’accepte si on sait que c’est Vidor qui réalise. C’est d’ailleurs amusant de le voir réaliser ça, acceptant les conditions de l’auteure mais arrivant tout de même à mettre de l’humanité dans ce qui précède. La fin est si caricaturale qu’on ne peut pas y croire. Je suis conscient que c’est prêter des intentions au cinéaste qui sont purement du domaine du fantasme. Mais justement, ça participe au plaisir du film. On ne peut pas y échapper, l’histoire qui entoure le film participe à sa valeur, en bien comme en moins bien. Et tout est question de malentendu. Peu importe le point de vue d’un film, le seul point de vue qui vaille c’est celui du spectateur, c’est-à-dire ce que lui a envie de comprendre… et de s’imaginer. Le point de vue de l’auteur est misérable, c’est un leurre, il n’existe pas. On ne peut pas imaginer deux points de vue aussi différents que celui de Vidor et d’Ayn Rand. Le point de vue du “film” qu’on a tendance à évoquer facilement comme si un film pouvait penser ou dire quelque chose, existe d’autant moins ici. C’est une situation cocasse qui ne fait qu’augmenter mon plaisir. Comment des personnalités qui n’ont rien en commun peuvent-elles se retrouver autour d’un même film ?
Commentaire juin 2017 : Troisième ou quatrième visionnage, et ça devient insupportable, surtout après avoir lu les mille pages de La Grève d’Ayn Rand. Le film n’apparaît plus que comme un autre chapitre de la Grève, l’auteure ne répétant à l’infini toujours que les mêmes marottes. Ce n’est plus seulement la fin ou l’attentat contre les HLM qui passent plus, c’est toutes les petites phrases typiques de la haine de Rand pour les masses, le peuple, les parasites, et sa fascination, voire sa complicité avec les grands de ce monde qui parce qu’ils ont réussi le sont devenus le plus souvent parce qu’ils faisaient un bras d’honneur aux moins que rien que ne font que « reproduire » (voire se reproduire, à l’entendre presque). Chaque scène le même principe, à savoir l’illustration de cette idéologie puante que cette monstresse (pour reprendre un terme de Vincent Lindon) a illustré dans ses romans en réaction au communisme. Traumatisée la pauvre petite, que toute sa carrière, toutes ses pages, semblent finalement dédiées à la lutte contre le peuple, les masses… Entre individualisme et égoïsme, il n’y a souvent qu’un pas, entre respect des libertés individuelles et l’arrogance de ceux qui pensent avoir tout compris plus que les autres. Vive le mépris et l’arrogance : aucune place au doute, les pauvres, les fragiles peuvent (et doivent même) crever. (J’aurais dû parler de Rand, tiens, dans mon article sur les totems de l’idéologie, elle le mérite.) Reste la romance, des acteurs formidables, la musique de Max Steiner et le génie de Vidor à illustrer les prétentions puantes de l’auteure…








































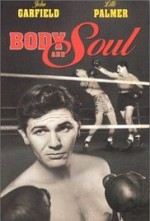



















 Année : 1949
Année : 1949





