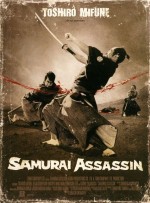3 février 1997
Étude dramaturgique
D’un point de vue dramaturgique, le film est un chef-d’œuvre. Pourtant, le genre de la chronique réclame une construction précise et rationnelle, et plus d’un s’y serait cassé les dents.
Dans la quête de l’œuvre et de la forme parfaite, atteindre ce que j’appelle « l’impression d’universalisme », le récit va droit au but. Chaque séquence est traversée comme s’il fallait ne s’intéresser qu’à l’essentiel, en ne laissant aucune part à la fioriture, et en même temps, l’ensemble de la structure dramaturgique, d’une séquence à l’autre, semble bien travailler pour un même objectif. La chronique est sans doute le genre pour lequel il est le plus dur de faire apparaître une telle unité parce que cet objectif est souvent analytique, thématique. Il se dessine au fil du récit pourtant ; il est omniprésent, comme une odeur imperceptible qui finit par se dévoiler dans son évidence.
L’histoire ne s’encombre pas ainsi de transitions. Le lien entre les scènes doit être laissé à l’interprétation du spectateur. Pour le forcer justement à trouver le lien commun entre tous ces événements. La mise en scène ne s’attarde pas non plus à reproduire une forme de réalisme ou de vraisemblance à travers des actions de personnalisation. Au contraire, tout devant être condensé autour d’une même unité dramatique, on est amené à découvrir les personnages à travers ces événements qui les dépassent. Événement après événement ; époque après époque. Et toujours, sans s’autoriser la moindre digression. C’est comme le tricot, si on rate une maille, tout est décalé et foutu. « L’impression d’universalisme », c’est bien ça, une vision d’ensemble qui permet au spectateur d’apprécier l’unité du film d’un seul coup d’œil. L’harmonie doit être parfaite.
Bien sûr, si on y regarde de plus près, il est certain d’y trouver certains défauts. Mais le film joue alors la carte, l’atout maître, de la chronique : la densité. Il est clair qu’une unité faite d’éléments grossiers, flasques, sera plus facile à trouver, et certaines œuvres arrivent à convaincre leur public à travers cette simplicité. Mais pour une chronique, pour un long récit épique sur plusieurs années, c’est presque un devoir de resserrer la course des événements et de traiter en deux heures (souvent plus) le maximum de séquences et d’époques possibles.
Là où on atteint alors la perfection, le génie de la forme, l’équilibre parfait, la structure idéale et harmonieuse, c’est quand le cinéaste, pleinement dramaturge et conscient de son rôle de conteur d’histoires, parvient dans ce maelstrom dramatique, dans cette frénésie, et ce qui pourrait devenir très vite une course incontrôlable…, tout à coup, à baisser le rythme. Il peut, tout en profitant de la vitesse acquise, se permettre de tout arrêter, ou du moins d’appesantir la course des événements, comme une pièce qu’on ferait tourner sur elle-même et qu’on regarderait fascinés en train de vaciller en perdant de sa vitesse, comme un triple sauteur lancé à toute vitesse qui arrêterait soudain le temps à son premier appel. Tatatatatah’… tah’… ta’h-ta’. C’est de la musique. Une quête et le sens de l’harmonie.

Car s’il suffisait d’accélérer toujours l’action, de multiplier la fréquence des événements, ce serait bien trop simple. Certains films bien sûr, sont des fulgurances, et marchent très bien comme ça. Mais en général, quand le rythme est haletant du début jusqu’à la fin, c’est qu’on a affaire à un film de type classique, ou aristotélicien. Les événements (forcément limités par rapport à une chronique ou à une épopée) sont concentrés autour de quelques heures, une journée ou deux tout au plus. Ce qui compte dans une musique emphatique, symphonique, grandiloquente, c’est la capacité tout à coup de ralentir, de se retourner, de contempler le chemin parcouru et de sentir ces tourbillons sonores qui étaient à la traîne comme la queue d’une comète se répandre et mourir sur notre visage. Et puis se retourner très vite et repartir… C’est que l’histoire doit reprendre son souffle, et permettre au spectateur de digérer tout ce qu’on lui a fait ingurgiter. Sur certains films, on peut tenter le coup d’y aller d’une traite. Pour un film de trois heures, il faut aménager la peine…
Dernier élément servant la cause « universaliste », le soin apporté à la mise en scène. Le montage et la dramaturgie ne font pas tout. Un corps composé d’une ossature sans tendons et sans muscles pour la soutenir n’a aucune chance de se tenir debout. L’harmonie, l’équilibre, la densité, tout cela est bien gentil si aucune matière molle et fibreuse ne vient donner corps à une œuvre. Cette chair qui doit recouvrir l’innommable, et qui doit paraître toute belle au regard du spectateur… Au point, oui, que certains se rêvent en lombrics ou en limaces… « Oh oui ! Qu’il serait bon en effet de ne voir en une œuvre que la chair, le cœur !… Que certains nous empoisonnent avec leurs charpentes, leurs sciences, leurs manières compassées ! Du cœur, de l’amour ! Des sentiments ! De l’émotion ! Je jouis ! Ah ! »…

Non, trois fois non. La chair ne vient que recouvrir la structure. Sans elle, les œuvres auraient l’harmonie d’un morceau de gravier et la consistance d’une bouillie de lépreux.
Oui, la mise en scène, à l’intérieur même des scènes, permet de donner corps à une structure austère et trop évidente. Décomposition du mouvement, lenteur, silence, échelle de plan et mise en valeur. C’est là qu’entre en jeu le bon goût, la poésie, le contemplatif. Tout est souvent affaire de paradoxes. De contrastes, d’alternances.
Un exemple, dans une scène de foule (nombreuses dans le film), au théâtre, on sait les personnages principaux présents, mais pas forcément au même endroit en même temps. La mise en scène, autrement dit le récit porté à l’échelle de la scène, s’applique à confondre les différents personnages au moyen d’un montage parallèle (ou alterné). L’unité est respectée et facilement compréhensible parce qu’on sait que se joue dans ce théâtre un même événement. Pour faire le lien, subtil, et presque métaphorique, entre les personnages, le récit va bientôt les réunir autour d’une autre dimension, d’un procédé modifiant complètement les unités spatiales et temporelles : le flashback. La logique du procédé apparaît évidente : il est question de réunir ces personnages, au-delà de la scène du théâtre, dans un autre passé et un autre lieu communs à tous. C’est comme se pencher sur le passé de quelques personnages au moyen d’un objet magique : ici un espace, quelques leitmotivs, des objets, un chant. Le retour symbolique vers ce passé, c’est celui, nostalgique, de ceux qui se retrouvent, durant les deux séquences d’introduction et de fin qui ferment le film comme un étui. Le corps donne sens au récit à travers l’interprétation des comédiens. À cet instant, la foule n’existe plus ; ils se démarquent d’eux comme ils se démarquent du présent pour se retrouver à un passé dont on comprend toujours, grâce à ces corps, et non grâce à des indications purement dramaturgiques, qu’il ne pouvait être que glorieux et définitivement révolu. Qui ne peut que commencer là où commence toute chose : à l’école. La structure pourra alors s’organiser harmonieusement autour de ce long flashback, comme face à un miroir déformé : d’abord l’ascension, les grandes réussites, puis la longue déchéance, le reflet altéré et les masques qui coulent. Un équilibre presque parfait : la faille initiale qui commande tout le reste et déstructure les destins. L’harmonie désaxée, propre à la tragédie. L’inéluctabilité d’une chute qu’on se repasse cent fois avec le même résultat. Parce que pour tomber, il faut avoir été élevé haut. Au moins sur les planches de l’Opéra.