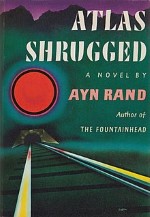Néomélo

Vanina Vanini
Année : 1961
Réalisation : Roberto Rossellini
Avec : Sandra Milo, Laurent Terzieff, Martine Carol, Paolo Stoppa
Rappelez-moi un jour qu’il faut que j’écrive un article intitulé « Le néoréalisme italien n’a jamais existé ». On pourrait arguer que les mouvements artistiques naissent en dehors des intentions de ceux qui les font. Mais précisément, à l’image de la nouvelle vague, on prête souvent des intentions à des cinéastes alors que ces mouvements, s’ils sont bien réels, sont presque toujours la conséquence d’un environnement de production spécifique (et de techniques) soit touché par des avancées techniques, soit détérioré (des moyens minimalistes s’imposent). C’est ce qui différencie les mouvements et les styles : quand Antoine ou Pialat décide d’adopter le naturalisme à plusieurs décennies d’écart (et qu’importe la manière dont ils décrivent leur propre style, cela peut être laissé à d’autres), on peut largement suspecter que le style qui découle de leur travail est le fruit d’une intention et d’un parti pris esthétique (voire, parfois, politique ou morale). Pourquoi ? Parce que le style qui transparaît de leurs films (et dont ils peuvent éventuellement se revendiquer) se fait en dehors (et avec certaines limites) d’un environnement de production ou de contraintes techniques.
Mais quand Visconti, De Sica ou Rossellini continuent ou commencent à réaliser des films dans une Italie en ruine à la fin de la guerre, ils font avec les moyens du bord. Le critique de cinéma, habitué aux films de l’occupation, à ceux de la « qualité française » qui vont vite s’imposer ou encore aux grosses productions américaines, bien sûr, quand il voit débarquer les films italiens fauchés de l’après-guerre, il voit ça comme une révolution. Et ça l’est d’une certaine manière — même si le néo de néoréalisme rappelle aussi beaucoup que ce serait une forme de mouvement ou de cycle (c’est le sens de mon article sur La Fille sur la balançoire) réapparaissant après une période qui n’aurait par conséquent pas été… réaliste. Toutefois, il est important de noter que ces mouvements (alors même qu’on fait vite, de ceux qui en sont, des « auteurs », donc a priori des réalisateurs conscients et volontaires de la manière dont ils produisent des films) sont beaucoup plus le fruit d’un contexte environnemental spécifique au sein d’une production locale que d’un choix délibéré d’un « auteur ». Ça ne réduit pas l’importance ou la pertinence des mouvements cinématographiques, mais il me semble que ça en limite assez le poids historique que l’on voudrait parfois leur donner, et surtout, cela donne une idée de notre capacité à surinterpréter des intentions derrière ce qui résulte plus souvent d’un environnement et de contraintes subies.
Ce qui fait de Visconti, de De Sica ou de Rossellini des « auteurs », c’est leur sens de la mise en scène et leur savoir-faire. Si on regarde la suite que prendront ces cinéastes du « mouvement » néoréaliste en s’étonnant des nouvelles approches (souvent plus dispendieuses, plus commerciales, plus « classiques »), on risque d’être déçu. Et c’est bien pourquoi je m’efforce le plus souvent de juger leurs films indépendamment (ce que se refusaient de faire Les Cahiers du cinéma à l’époque : un film de Rossellini ne peut pas être intéressant ou raté, et ça continue d’être un film néoréaliste même en couleurs et trompettes). La politique des œuvres contre la politique des auteurs.
Visconti a vite abandonné le « mouvement » ; De Sica aussi (presque toujours assisté de Cesare Zavattini), Antonioni gardera un style toujours très personnel mais déjà presque toujours plus focalisé sur les relations interpersonnelles que sur un environnement social ; Fellini, n’en parlons pas… Et si on a peut-être pu penser que Rossellini faisait plus longtemps de la résistance au milieu d’un environnement de production grossi par ses succès, c’est que, bien que soucieux (à mon avis) de proposer comme les autres des adaptations riches et pompeuses comme ses acolytes, il ne s’en est jamais montré capable, faute de savoir-faire en matière de production de films « classiques ».

On ne me fera pas croire que Rossellini a cherché toute sa vie à rester éloigné des productions « commerciales ». Jusqu’à ce pitoyable Vanina Vanini, où le cinéaste tente de suivre les codes du cinéma classique sans en être capable, sa filmographie est remplie de productions ou de tentatives de films pompeux ou de grosses productions. Il aurait pu tout aussi bien adopter des moyens misérables pour tous ces films comme au bon vieux temps de la sortie de la guerre où l’image était peu chère, où on se contentait de décors naturels ou d’acteurs non professionnels.
Non, ici, on rameute toutes les stars françaises du moment, on barbouille sa pellicule de jolies couleurs, on rémunère des centaines de figurants pour des scènes de foules inutiles à Rome, on ne transige pas sur le budget costumes, etc. On est loin des excès de Fellini, et on aurait presque envie de dire que « c’est bien dommage ! ». Parce que les Cahiers pouvaient bien chier sur la qualité française, Rossellini n’a tenté que ça dans les années 50 jusqu’à celui-ci. Et si plus tard, il s’est contenté de budgets plus modestes, eh bien, ma foi, c’est peut-être aussi parce que ses films faisaient un four et que personne ne voulait plus prendre le risque de les financer.
Alors peut-être que je surinterprète à mon tour les intentions de Rossellini quand il réalise toutes ces grosses productions et qu’il est lui-même assujetti à l’environnement du moment. Sauf que les productions modestes dans les années 50, réalistes, elles existent. Même en adoptant la comédie (voire la satire), Pietro Germi gardera toujours cette exigence réaliste.
À quoi assiste-t-on donc ici avec cette adaptation de Stendhal ? C’est simple : une nouvelle fois à l’incapacité de Rossellini d’illustrer une histoire. Autant, je ne le trouve pas si mauvais directeur d’acteurs que ça (on le voit manifestement porter un grand soin à la direction de ses actrices, et on sait ce que ça veut dire…), autant sur le plan du récit (il participe souvent à l’adaptation, il imagine donc dès la préproduction la manière de transcrire une histoire adaptée à l’écran) que sur celui de la mise en scène, il ne fait pas le poids.
Le travail sur la lumière est notamment catastrophique : de nombreuses séquences tournées de nuit plein phare, des transparences derrière une calèche qui fait assez peu « néo-réalisme » (mais on n’ose déjà plus ce genre de trucages à l’époque, on est en 1961 !) ; et sa caractéristique principale : son incapacité à savoir quand changer d’échelle de plan (et par voie de conséquence à savoir où mettre sa caméra, quand proposer un contrechamp, quand couper, etc.). Il se débrouille parfois à situer les acteurs dans l’espace, les y faire évoluer, puis la caméra les suit en plan rapproché, et c’est encore ce qu’il peut proposer de mieux : ça ne coûte pas cher parce qu’on reste sur le même plan et on donne l’impression d’en avoir utilisé trois fois plus. Mais puisque ça demanderait un savoir-faire phénoménal de parvenir à construire toutes ses séquences de cette manière avec efficacité, puisque ça réclamerait en quelque sorte de la créativité, Rossellini se plante la majeure partie du temps.
On n’est pas au niveau des Évadés de la nuit qu’il vient de tourner en noir et blanc, mais il n’y a guère que l’usage peut-être de la musique qui pourrait encore passer. Pour le reste, ce n’est pas bien brillant. Et là où Rossellini se vautre encore plus, c’est dans le récit et la pertinence des actions choisies : j’ai pouffé par exemple en voyant Vanina tomber aussi facilement dans les bras de son amoureux.
Rien n’est pertinent, tout est superflu, les enjeux sont mal définis.
C’est fou de penser que deux ans après Visconti tourne Le Guépard. On a l’impression en comparaison de voir un film avec les techniques des années 30.
Quel gâchis de voir assimilé Laurent Terzieff à si peu de grands films (plus tard, il jouera dans l’adaptation excellente mais confidentielle du Horla, sinon, eh bien, il n’a jamais été de mèche avec les cinéastes de la nouvelle vague — amoureux de théâtre surtout, on le croisait avec ma classe à la fin des années 90 au théâtre de l’Atelier, toujours un mot gentil pour nous, un grand sourire timide et une voix grave pleine de délicatesse). Il aurait mérité d’être mieux utilisé. Son charme gentil et sage n’était peut-être pas dans l’air du temps qui préférait les impertinents et les extravertis.
Vanina Vanini, Roberto Rossellini (1961) | Zebra Film, Orsay Films
Sur La Saveur des goûts amers :
Liens externes :






























 Année : 1964
Année : 1964