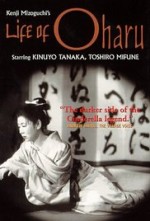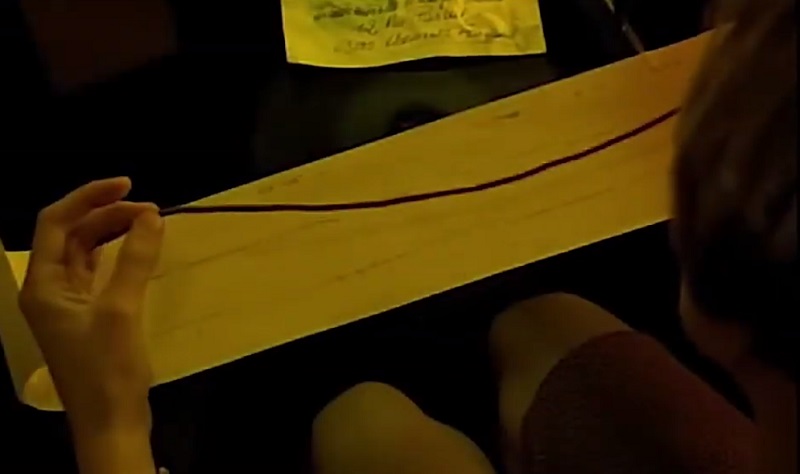Scénario d’une précision exceptionnelle. Il semble former une boucle sur le thème des passions amoureuses. On est presque dans un cheminement de héros antique ou dans la structure d’un récit dense et classique à la Racine…
Le point de départ de cette histoire, le début de la boucle, c’est Benjamin qui l’initie : un étudiant qui revient vivre chez ses parents, tout juste diplômé mais un peu déprimé et sans perspective d’avenir. Il est au niveau zéro de ses passions. Le diplôme aurait dû faire théoriquement de lui un homme, un adulte, pourtant s’il est fêté par sa famille et les amis de sa famille, lui sait qu’il a manqué quelque chose. Il n’est pas question, là, de ses études (dont on ne parlera jamais), mais de sa vie sociale, et plus particulièrement de sa vie amoureuse. La première scène à l’aéroport résume ce qui va suivre : en un regard, qui dure le temps d’une chanson, on a tout compris. Benjamin est perdu, et quand il regarde une jolie fille qui le croise hors-champ, il la regarde à la fois avec envie et avec gêne de peur qu’elle ne lui rende son regard… Benjamin revient de l’université sans ami, sans petite amie. Il revient en raté parce qu’il n’a pas su accomplir son passage à la vie adulte.
Benjamin se réfugie dans sa chambre alors qu’on le fête dans le reste de la maison. Là, déprimé, il est rejoint par Madame Robinson, qui lui fait le coup du « les toilettes, c’est pas ici ? ». Elle vient presque littéralement le sortir de son nid. On comprend tout de suite qu’elle flirte avec lui, mais lui continue de jouer les vierges effarouchées. On ne saura jamais si l’attirance de cette femme pour ce garçon pas franchement beau, sans aucune assurance, est juste feinte pour se taper un jeune lionceau, une proie facile…, peu importe en fait, tout le récit est centré sur Benjamin, et Benjamin ne veut pas savoir. Elle l’attire chez elle, le vampirise. On pourrait presque se croire chez Hitchcock où les scènes d’amour, disait-il, devaient être filmées comme des scènes de crime. Elle le tient dans ses griffes, elle joue avec lui, et lui gesticule comme une souris prise au piège ou comme le mâle de la mante religieuse qui sait que s’il obéit à ses pulsions sexuelles, il y laissera sa peau. On ne sait rien à ce moment des intentions de Madame Robinson, mais on sent que c’est le début de son cycle, de son initiation, qui va le mener à sa vie d’adulte.

Le Lauréat, Mike Nichols 1967 The Graduate | Lawrence Truman Productions
Benjamin se laisse séduire. Ils entretiennent tous les deux une relation cachée, au début, purement sexuelle, chacun semblant y trouver son compte. Très vite, cela ne suffit plus à Benjamin, il voudrait s’intéresser à la femme avec qui il couche. Il ne veut plus un corps, mais une âme sœur, une compagne avec qui communiquer. Mais Madame Robinson ne peut pas être cette femme. Elle a déjà tout compris des relations amoureuses et semble se désintéresser totalement de la chose, désabusée par la vie, blasée par les mirages de l’amour. Elle ne se sent par compte pourtant qu’elle tombe amoureuse de Benjamin. Un amour impossible, parce qu’il est basé sur la dépendance du corps : elle était alcoolique, elle devient accro à son jeune amant (simple interprétation, car une nouvelle fois, elle reste très mystérieuse derrière sa carapace de cynisme).
Alors, les parents de Benjamin, le voyant végéter dans la piscine toute la journée en attendant les nuits où ils ne savent pas ce qu’il devient, décident de le bousculer un peu en arrangeant une sortie avec une fille. Ce sera Elaine…, la fille de Madame Robinson. C’est un peu le sort qui s’abat sur Œdipe, la chance néfaste qui vous accable, le mauvais sort presque ordonné par les dieux que vous avez offensés… Les parents qui mettent leur fils dans les bras de la fille de sa maîtresse… Ce n’est pas Œdipe, mais les circuits narratifs ne sont vraiment pas loin d’être identiques.
Benjamin et Madame Robinson se trouvent devant le fait accompli, obligés d’accepter de jouer le jeu pour ne pas paraître suspects. Benjamin s’efforce donc de rendre la soirée la plus épouvantable possible pour Elaine. Mais c’est écrit, presque ordonné par les dieux. Benjamin, pour compliquer son sort, doit se laisser séduire par Elaine. Là, pas de psychologie, ça se fait très vite et sans aucune vraisemblance parce que les héros doivent tomber amoureux presque en une fraction de seconde : elle pleure, il la réconforte et l’embrasse. Ce serait traité de manière naturaliste, bien sûr, on n’y croirait pas une seconde. Comment un mec sans aucun charme, aussi rustre pourrait-il séduire une fille aussi jolie… ? Ce sont des héros de mythologie, ils ont en eux une force et un charme mystérieux qui subliment les codes de la vie quotidienne. Sur le seul plan du récit, on ne va pas s’embarrasser de vraisemblance en cherchant à expliquer ou rendre crédible une relation dans la longueur : seul compte le cycle initiatique de Benjamin. Chaque scène est une nouvelle aventure qui remet en question tout ce qui précède. Il n’y a pas de flottements dans le film : toute scène est comme une fulgurance, tout se construit et se reconstruit en même temps. On est toujours dans l’incertitude, non pas parce que le récit recèle des mystères ou des surprises (car on sait parfaitement où on nous mène : il n’y a pas trois cents chemins pour suivre ce cycle) mais parce qu’on s’identifie au personnage de Benjamin : c’est le résultat d’un récit collé à lui (il est présent dans toutes les scènes, dans pratiquement tous les plans : notamment au début, la caméra le suit d’un bout à l’autre des scènes, même si d’autres personnages interviennent et le sollicitent, un peu plus tard, on a même une vue subjective quand Benjamin enfile sa tenue de plongée… Le résultat en tout cas est parfaitement réussi).

On est à cet instant précis à la croisée des chemins. Benjamin a “péché” (dans le sens plus mythologique du terme) et il a là la “chance” de revenir à une vie plus conforme, une vie normale, ce à quoi il aspirait depuis toujours. Bien sûr, il faut maintenant qu’il gère et assume la situation, la relation croisée qu’il mène avec la mère et la fille.
Il ne fait aucun doute pour Benjamin que sa passion doit le mener à suivre la même route qu’Elaine, mais il doit maintenant affronter la passion jalouse de Madame Robinson. Le choix est évident, mais il ne sait pas encore comment elle va réagir et ne s’en préoccupe même pas. Il va pourtant découvrir, en allant chercher sa fiancée le lendemain, que la mère a une véritable passion, une dépendance très forte même, pour lui. Il ne peut plus y avoir de mensonge, on est à la moitié du film, et le sujet, ce n’est pas l’adultère : la révélation peut donc se faire ici, dans un grand chaos, dans un fracas de passions qui s’affrontent. Deux passions, quand elles s’accordent pour suivre le même chemin sont en harmonie et les corps, les personnages qui les renferment y trouvent leur compte, même si leurs passions défient les règles morales. Mais dès que les passions changent et veulent suivre des destins opposés, il faut que ça pète. Que ce soit Madame Robinson ou Benjamin, tous les deux ont gagné quelque chose et ils ne sont pas prêts à s’en séparer : elle le veut lui. Lui, veut sa fille… Triangle amoureux assez commun, sauf qu’on y ajoute là une dimension tragique, presque incestueuse. On ne peut pas se mettre d’accord avec une poignée de main. À cet instant, aucun compromis n’est possible. Après un tel climax de passions et d’affrontements, les personnages n’ont alors d’autres choix que de prendre leurs distances les uns avec les autres. Madame Robinson et Benjamin ne sauraient être à nouveau amants. Et Elaine, qui ne s’attendait pas à une telle révélation, se réfugie à l’université (une bonne petite fille).
Benjamin est allé aussi loin que possible, il doit entamer à présent un retour à la normalité dans son cycle. Cette normalité pour lui, elle passe par l’acceptation par Elaine de leur passion commune. Chose qui ne sera pas simple parce qu’il doit s’attendre encore à des affrontements et doit prendre le risque que sa passion, si elle n’est plus partagée, devienne une folie, une obstination malsaine et dérangeante. Loin de la furie Robinson, il espère, à l’université, retrouver sa belle… On reste dans la passion, et là, presque dans la folie amoureuse de Benjamin, prêt à tout pour préserver son amour, la question est devenue : est-ce que Elaine acceptera de le suivre dans sa folie, dans son refus des convenances sociales et de l’accompagner pour achever son cycle, vers quelque chose qui n’est plus seulement un cycle du devenir d’adulte, mais d’adulte contrarié, capable de vivre avec ses difficultés. À l’image du personnage de Madame Robinson, symbole et incarnation de l’adulte fracassé, obligé de créer des faux-semblants, des cycles parallèles, pour se maintenir en vie. Un peu comme si l’image de l’adulte, celle du personnage accompli était un leurre, mais qu’il fallait s’évertuer à préserver son image, parce qu’il n’y avait tout simplement pas d’autres issus. Aucun retour à la vie passée, insouciante et pure n’était possible…

Benjamin suit donc Elaine à l’université, l’épie, tel un obsédé, un malade d’amour. Au risque de passer pour un fou. Il doit la convaincre de le suivre… Nos décisions ne sont pas toujours déterminées par notre libre arbitre, par nos choix propres et conscients. Si dans la mythologie, les héros sont poussés par des considérations mythologiques, qu’ils ne sont en fait que les pantins des dieux. Là, on n’en est pas si éloigné que ça. Au fond, qu’est-ce que nous apprend l’histoire sinon que ce sont les circonstances qui décident à notre place ?
Après une première rencontre dans un bus, c’est Elaine qui vient le retrouver dans sa chambre. Les rôles ont changé. Si autrefois c’était Benjamin la proie, et qu’il s’était lancé dans les griffes de sa prédatrice ; là c’est Elaine qui prend le risque de venir se faire bouffer, vampiriser par son prédateur. C’est donc qu’il en reste une certaine forme d’amour, une certaine dépendance folle, ou du moins qu’elle veut affronter ses propres craintes pour pouvoir les apprivoiser. Elle veut savoir pourquoi Benjamin l’a suivie et ce qu’il compte faire. Elle connaît toutes les réponses. Même quand Benjamin lui dit que sa mère ne lui a dit que des mensonges à son propos, son cri est comme une forme de reconnaissance. Comprenant que sa mère lui a menti sur ses rapports avec Benjamin (en lui faisant croire à un viol), elle se retrouve une nouvelle fois dans la situation peu confortable de choisir entre sa mère et celui qu’elle aime. Et, il ne peut y avoir aucun doute sur son amour : on ne saurait conter dans une histoire mettant en scène des héros, des personnages sans passion… On pourrait être chez Cassavetes : sans passion, sans amour, sans confrontations épiques des désirs de chacun, il n’y a pas d’histoire. On est toujours dans l’excès, à l’apogée des possibilités, jamais dans la demi-mesure. Les héros ne sauraient se contenter d’un compromis. C’est tout ou rien.
Elaine pousse donc un cri, expression de son déchirement entre deux êtres qu’elle aime. Comme toujours les circonstances vont choisir à sa place. Ce cri a rameuté tous les pensionnaires, le logeur, et ce sera finalement son désir de sauver les apparences, les convenances, son refus de devoir tout raconter, tout dramatiser, qui va la calmer. La bête n’a plus de force et peut se laisser dompter. Mieux, c’est sans doute elle qui se laisse dompter par ses passions, car ce qui la ramène dans les bras de Benjamin, c’est la compassion qu’elle va avoir pour lui quand celui-ci se fera tancer par son logeur qui veut le voir quitter les lieux. Ce n’est pas la raison qui la ramène à lui. Les choix sont ailleurs que dans nos têtes. Elle ne s’est pas posé la question et n’a pas pesé le pour ou le contre. Elle n’a pas mesuré les conséquences de son retour auprès de Benjamin. Elle ne sait pas encore que cela impliquerait une cassure avec sa mère. Elle montre là, non seulement qu’elle n’est pas décisionnaire, mais qu’on est totalement esclaves de nos passions.

Les deux amoureux vivent heureux quelques instants. Lui ne semble pas prêt à penser au reste, il est insouciant et voudrait qu’ils se marient rapidement. Mais elle commence à se demander ce qu’il se passe et prend la mesure des événements en comprenant le poids de sa décision. Ils semblent suivre le même chemin, mais Elaine regarde encore en arrière pour regarder ce qu’elle a perdu, et en avant pour voir ce qui les attend au bout de leur cycle : elle sait qu’ils auront encore leurs démons à exorciser. À cet instant, lui la cherche du regard, et elle le voit à peine (plus tard, cela changera dramatiquement, ou ironiquement).
C’est comme si on fracassait deux bols de passions remplis à ras bord et que Elaine s’en trouvait éjectée. Elle se rappelle qu’elle a une mère qu’il va falloir affronter. Pourtant, c’est le père qui va être l’élément déclencheur de son départ. On l’avait rarement vu dans le film, et il rappelle que ce n’est pas seulement qu’une histoire de triangle amoureux : il est aussi le père d’Elaine et le mari cocu.
Le lendemain, Elaine a disparu. Dans une lettre, elle dit à Benjamin qu’elle l’aime, mais que ça ne peut pas marcher.
Benjamin fait alors des pieds et des mains pour la retrouver. Il sue essence et eau et la retrouve apprenant qu’elle se marie. En pleine cérémonie, il lui demande de partir avec lui. Une fois de plus c’est Elaine qui va devoir choisir ; encore une fois elle va décider sur un coup de tête. Les circonstances encore et toujours plutôt que le libre arbitre. Soit elle lui demande de partir et ce sera fini sans possibilité de retour, soit elle le suit se moquant des convenances et des démons qu’ils devront affronter toute leur vie. C’est finalement la réaction de ses parents, autoritaires, crachant presque sur son amoureux comme des singes enragés, qui va la décider à opter pour la solution la plus folle. Ce sont encore les passions qui commandent : on agit et on mesure les conséquences après.
Elle part avec lui, et c’est dans cette scène finale que se trouve tout le génie de la mise en scène de Nichols, toute l’ambiguïté de l’histoire. Ça ressemble à un conte de fées, avec sa fin heureuse : l’amour est sauf. Mais au lieu de nous dire « ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants », Nichols utilise en un regard, en un plan, une sorte de raccourci de toute leur vie à venir. Les deux amoureux fous montent dans un bus, c’est le point final de leur aventure, la fin du cycle pour Benjamin, aidé par les décisions heureuses d’Elaine. Il a enlevé sa princesse des griffes du méchant dragon, mais c’est une victoire plus sur les autres que sur lui-même. On comprend en un plan que cette union avec Elaine, il l’avait construite non pas pour les beaux yeux de sa belle, mais pour s’échapper des griffes de sa vamp. Il rit alors nerveusement, regardant droit devant lui : il a baisé le destin et les dieux, il pense avoir gagné. Dans le même plan, Elaine le regarde, attend qu’il lui rende son regard, cherche un peu d’amour en lui, de la complicité. Mais elle ne trouve rien. C’est déjà la fin. La boucle est bouclée sur un jeu de regards : le film commence sur le regard de Benjamin qu’il jette sur une fille en espérant qu’elle lui rende dans un aéroport, et se termine sur lui refusant de le rendre à la femme qui l’aime, dans un bus.

Ce que nous dit ce regard, c’est que la passion fait se rencontrer des hommes et des femmes, mais ils se trouveront rarement pour faire un chemin ensemble. Accompagner ne veut pas dire “avec” ; et à tout moment on peut “choisir” de prendre une autre voie — comme Madame Robinson, arrivée au bout avec son mari, cherchant à entamer un nouveau cycle avec Benjamin… Benjamin n’a pas achevé son initiation en terminant son cycle, mais en se rapprochant surtout du personnage perdu et cynique joué par Anne Bancroft.
L’amour n’existe pas. Il n’y a que la passion. Et la passion est capricieuse…
Le film est dans sa conception, d’une simplicité presque stupide à la Love Story, mais aussi plus complexe qu’il en a l’air. C’est un peu comme regarder un mur et y déceler petit à petit toutes les craquelures, ou les imperfections… Le génie d’un récit presque classique avec une unité d’action stricte, une boucle respectée. J’ai parlé de Cassavetes, mais il était encore plus simple de prendre comme référence le film précédent de Nichols. Parce qu’on est au même niveau sur le plan des passions dans Qui a tué Virginia Wolf ? On est dans la même démesure. La différence, c’est que dans Le Lauréat, on se focalise sur un personnage et qu’il n’y a aucune unité de temps (impossible). De la même manière, les personnages sont commandés par les émotions primaires, ils n’ont aucune retenue. Si Wolf est plus analytique, parce qu’il s’attarde sur des discussions qui vont réveiller de vieux souvenirs comme des démons cachés et amassés pendant longtemps sous un tapis, on reste néanmoins dans le même ton. L’unité de temps y est utilisée différemment mais participe à la même impression de tenue générale. Si Wolf est une suite de petits huis clos où les personnages, prisonniers, se mettent à vider leur sac, Le Lauréat utilise l’ellipse pour unir un ensemble de scènes soudées autour d’un unique thème. Le film a une tenue parfaite. Jamais on ne s’échappe du sujet, et on pourrait croire que tout ça s’effectue dans une période raccourcie comme dans l’univers classique. On ne s’appesantit que pour suivre Benjamin dans ses errances. En ce sens, ces quelques scènes “subjectives” et “chantées” ne sont rien d’autre que l’adaptation moderne des monologues d’autrefois. Si le film avait adopté le point de vue de Madame Robinson, nul doute que l’impression de suivre une pièce classique aurait été accentuée : Madame Robinson, c’est Phèdre tiraillée par ses passions coupables, son désir de vengeance, etc.
Petite remarque concernant la bande-annonce du film : À l’époque, on ne s’embarrassait pas de “spoils”. On savait très bien que ce qui faisait venir les spectateurs dans les salles, ce n’était pas de voir un film en étant surpris du début à la fin. L’intérêt d’un film n’est pas dans le déroulement de son intrigue, mais dans son atmosphère. Dans le comment et non dans le quoi. Quand on va voir Richard III ou Phèdre au théâtre, on n’y va pas pour être surpris…, on sait ce qu’on va voir. Donc, là, tout est raconté dans cette bande-annonce, même la fin. Gloire aux spoilages.


Spoil me!