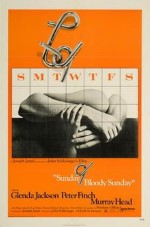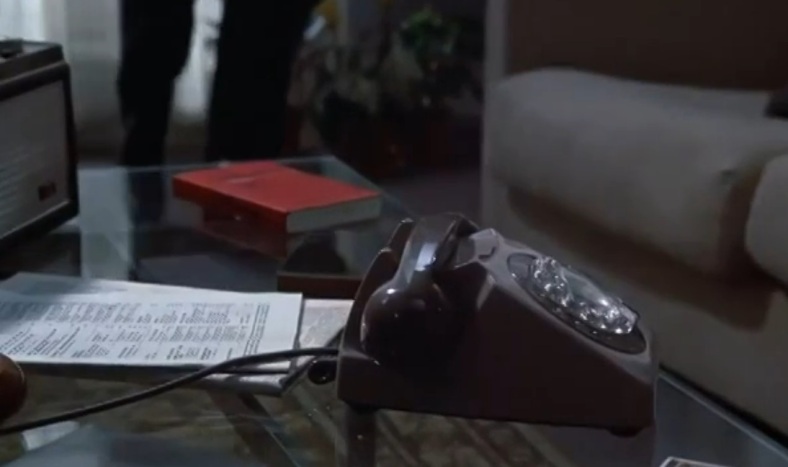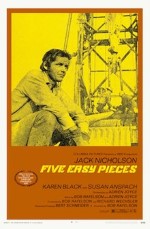Variation new-yorkaise et brutale du Crime de l’Orient-Express. Le film reprend un des gimmicks favoris du cinéma qui consiste à développer une poignée de personnages avant de les réunir dans un même espace (la réunion se passe dans une rame de métro, pile à la moitié du film). Le procédé sera particulièrement apprécié dans les futurs films catastrophe des années 70 et connaîtra un regain d’attention avec des variations moins « chorales », plus narratives, dans les années 90 avec les films de Quentin Tarantino. Autres références et sous-genres associés : le film de transport. De Lifeboat (canot) à Airport (avion) en passant par H-8 (bus), quel que soit le moyen de transport, le huis clos (souvent partiel) fait toujours son effet. On pense également ici particulièrement aux Pirates du métro (1974). En général, les récits qui mêlent ces deux thèmes narratifs procèdent de manière opposée : on passe du transport à un autre huis clos. Le modèle du genre est Boule de suif, qui a inspiré consciemment ou non Les Huit Salopards, de Quentin Tarantino. Ici, le récit se construit plutôt dans une logique de convergence dans laquelle différentes lignées finissent par se ramifier en un seul point (une spécialité d’Agatha Christie, même si cette convergence a toujours lieu au début – ici, elle intervient au milieu du film).
Dans ce genre d’exercice périlleux, tout repose sur un bon scénario, mais surtout sur une distribution parfaite. Le spectateur entre de plein fouet dans une situation que l’on comprend n’être qu’un prétexte à définir le caractère des personnages. Avant que tout ce petit monde se retrouve confiné dans un même espace, tout l’intérêt de l’intrigue repose non pas sur l’action, sur une suite d’événements, mais sur la personnalité et le talent des personnages et de leur interprète. Les acteurs ont toujours adoré ce type de rôles qui les remettent au centre du jeu. On est à New York, ça ne devait pas être bien difficile de trouver des acteurs de talent issus des nouvelles méthodes de jeu. En dehors d’un ou deux vieux dont le jeu caractéristique de l’ancienne école (l’inusable Thelma Ritter par exemple), avec leurs tunnels pas forcément maîtrisés, passe assez mal la rampe (de métro), les acteurs sont remarquables une fois réunis. Ils aident ainsi à parfaitement retranscrire la tension de la situation.
Sur le fond, le sujet peut également être vu comme une allégorie de nos sociétés égocentriques, surtout citadines, dans lesquelles on se laisse aliéner par nos terreurs individuelles et finit par montrer notre impuissance à faire « société » au milieu d’individus hétéroclites. Depuis, me semble-t-il, ces réactions apathiques ont été étudiées par les comportementalistes en confirmant qu’à partir d’un certain seuil ou en fonction de conditions spécifiques, les responsabilités se diluent et personne n’agit, surtout si aucun des témoins ne tire l’alarme en premier pour appeler « à faire bloc » contre un danger ou pour aider au contraire une personne en danger (les deux cas se présentent dans le film : d’abord avec l’ivrogne inconscient laissé pour mort dans l’indifférence générale, puis avec les agresseurs qui s’en prennent tour à tour à chaque entité de la rame).
En faisant quelques recherches, je tombe sur ce papier qui stipule que les travaux de ce type ont commencé après un fait divers étant survenu… à New York en 1964 : une femme aurait été tuée sans qu’une trentaine de témoins osent intervenir. (Le film n’a rien à voir, c’est un remake d’un film de télévision diffusé en 1963, mais la coïncidence mérite d’être notifiée.) Dans ce papier, on peut ainsi lire : « En présence de témoins passifs, une personne tend à rester elle-même passive, et d’autre part, des groupes de trois individus ont moins de chance de rapporter l’incident que des individus isolés. » (C’est significatif, mais dans le film, la question se pose d’intervenir directement, donc de se mettre soi-même en danger. L’étude date un peu, compte tenu des difficultés à faire des expériences sociales, possible que des travaux plus récents montrent des informations plus éclairantes.)
À supposer que dès qu’un premier témoin montre la voie, tous les autres suivent, ici, au bout d’une demi-heure de terreur et d’agressions diverses, c’est l’un des plus « démunis » qui finit par lever la main (sa seule valide) pour s’opposer aux agresseurs, tandis que les autres resteront les bras ballants. Jusque-là d’ailleurs, c’était presque toujours ceux que l’on considère comme les plus faibles qui osaient le plus répondre aux agresseurs : une vieille dame qui donne une claque à l’un des deux voyous, une autre qui se lève pour leur demander d’arrêter d’importuner l’un d’eux. Les hommes (et plus encore le soldat valide) se distinguent pour leur lâcheté. Un événement subtil à la fin du film témoigne également des tensions raciales de l’époque : quand les passagers arrivent enfin à stopper le métro et à appeler la police, instinctivement, les agents appréhendent le seul Noir de la rame… (Ils s’en prenaient aux Noirs sans tabou.) C’est peut-être un détail, mais ça veut dire beaucoup…

Autre allégorie possible (plus hasardeuse encore, mais jouons les « critiques de cinéma », rarement à court d’audaces interprétatives…) : la rencontre tumultueuse entre la jeunesse turbulente et insaisissable qui s’emparera bientôt d’Hollywood et toutes les figures conservatrices du cinéma de papa. Le vagabond (qui fait faux bond) ; le Noir qui ne veut pas faire de vague parce qu’il se sait sur la sellette (figure classique de Sidney Poitier depuis Graine de violence) ; le rebel without a cause affublé de sa veste coupe-vent inspirée des letter jackets d’université ; le bon soldat en permission ; l’homosexuel forcément tourmenté ; l’ancien alcoolique à l’affût d’une seconde chance ; la femme de professeur insatisfaite ; la mère écervelée qui a le cœur sur la main ; le couple de vieux qui se chamaille depuis le premier jour de leur mariage et qui déteste voir que le monde leur échappe…
Parce qu’effectivement, le cinéma est à un tournant. Le film est sorti en 1967, année charnière dans la production américaine : Hollywood sort enfin la tête de l’eau avec Bonnie and Clyde et Le Lauréat. L’Incident n’a pour autant pas grand-chose à voir avec le Nouvel Hollywood. Filmé sur la côte est, il aurait d’abord été financé de manière indépendante avant que Zanuck sauve le film de la faillite et en assure la distribution pour la Fox. Le film n’en reste pas moins le produit d’une époque qui, par contraste, éclaire l’éclosion de ce nouveau système.
Martin Sheen sera une des figures du Nouvel Hollywood, un peu plus tard, avec La Balade sauvage, de Terrence Malick (sorti en 1973). Beau Bridges sera vite employé à Hollywood, mais pas vraiment dans de grands films représentatifs de l’époque comme ce sera le cas pour son frère (il faudra attendre Norma Rae, de Martin Ritt, en 1979, mais une autre ère a déjà débuté). Brock Peters a souvent tourné dans des films avec Charleton Heston (allez savoir pourquoi) et est apparu dans des films d’Otto Preminger (Carmen Jones, Porgy and Bess), de Lumet (Le Prêteur sur gages) ; il tenait un rôle clé dans Du silence et des ombres (l’un des seuls acteurs noirs de premier plan à cette époque avec Sidney Poitier – qu’il a croisé sur Porgy and Bess). Quant à Larry Peerce, il suivra une carrière de réalisateur à Hollywood plutôt anecdotique selon les standards actuels (loin du Nouvel Hollywood, les studios continuent à produire des films de supermarchés, éventuellement rentables, mais ne laissant aucune trace dans l’histoire). Notons toutefois Un tueur dans la foule pour lequel il renoue avec le thriller confiné, mais dans un genre opposé (grand spectacle) et dans lequel, presque dix ans après L’Incident, il s’offre à nouveau les services de Brock Peters et de Beau Bridges.
L’Incident, de Larry Peerce 1967 The Incident | 20th Century Fox, Moned Associated
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant
Ou saisissez un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel