Il y a une fable amusante dans Parasite rappelant un peu la fourberie du coucou pondant ses œufs dans le nid d’autres espèces pour que ses petits soient élevés par d’autres. L’ironie ici serait qu’il y aurait double filouterie avec une morale assez noire. Parce que si chez Molière ou dans la commedia dell’arte, les rôles sont inversés et on montre que les valets, s’ils n’ont l’argent, disposent au moins de l’intelligence, ici les pauvres accepteraient presque leur situation de pauvres en adoptant une posture de « parasite » vis-à-vis des riches qui seraient alors intouchables. Et la réelle lutte en fait n’aurait lieu alors qu’entre les pauvres pour s’assurer la meilleure place dans le nid des riches. Il y a toujours plus bas que soi (bien symbolisé dans le film par les deux sous-sols). L’ambition des « pauvres » à ce moment-là n’est pas de prendre la place des riches, mais de correspondre le plus à ce que les riches attendent d’eux (ne jamais « dépasser la ligne ») pour bénéficier d’une place de choix à leurs côtés. Ils éjectent les employés de la maison un à un comme un coucou jette dès sa naissance les œufs de ses hôtes, mais ils ne cherchent pas à prendre réellement la place des maîtres, peut-être parce qu’ils savent intuitivement qu’ils ne feront pas long feu dans leur monde : si le fils s’amuse lors de la beuverie « quand le chat n’est pas là les souris dansent » à noter que sa sœur passerait, elle, incognito dans ce milieu, il s’interroge plus tard sur sa propre capacité à se fondre dans cette société où les riches sont tout à leur aise (d’ailleurs, celle censée être la mieux adaptée à ce monde sera celle de la famille qui ne survivra pas — peut-être un signe que le dieu Wi-Fi veille et châtie ceux qui chahuteraient un peu trop l’ordre établi). Et si au final, le « maître » est agressé, c’est moins pour lui piquer sa place que par un geste non prémédité (le père ne fait jamais de plan comme il le dit) et en réaction à la condescendance un peu forcée de son « maître » à le pousser à associer la classe des individus à leur odeur (un cliché peut-être un peu facile mais tellement représentatif de nos préjugés).
Il y a peut-être d’ailleurs dans cette fable la même incongruité que peut inspirer l’escroquerie du coucou, parce qu’une des grandes réussites du film de Bong Joon-ho, c’est de ne pas avoir fait des « maîtres » des personnages antipathiques. Pas seulement parce que l’opposition réelle viendra une fois nos « coucous » bien installés dans leur nid et se fera avec d’autres « parasites », mais parce que ç’aurait été pousser la farce un peu loin que de faire des pauvres les gentils et des riches les méchants. Je dois avouer qu’on n’a pas toujours connu le cinéma coréen aussi subtil… Aucun doute sur la nature de ces riches : ils sont victimes d’une escroquerie, et pour beaucoup, de leur crédulité. On gagne alors à ne pas avoir de personnages réellement antipathiques, chacun étant parfaitement nuancés (sauf peut-être les deux enfants de la famille riche qui restent toutefois en retrait tout au long du film), et on se rapproche alors bien de la fable du coucou, qui pourra bien devenir trois fois plus gros que ses parents adoptifs, ces derniers seront toujours aussi dévoués et crédules. Tout au plus le « maître » pourra relever l’étrange odeur de l’élément parasite placé insidieusement dans son nid, mais ne s’en offusquera pas plus que ça (jusqu’à ce qu’au contraire, ce dégoût passager irrite tragiquement celui qui est censé en porter la marque…). La fable aurait pu être grossière, au lieu de ça, elle fascine et on tente longtemps après à en démêler les fils, les implications comme les conséquences. À la fois simple à comprendre, mais assez floue pour qu’on s’y arrête avec l’impossibilité d’y trouver une image nette et établie avec le temps. C’est à mon avis cette capacité à dépeindre des espaces flous où l’attention du public s’arrêtera sans être capable d’y trouver la netteté attendue qui fait souvent une grande œuvre. On s’approche de ces espaces, on tente une approche différente dans l’espoir d’y voir enfin un objet clairement défini, mais on n’y trouve jamais qu’une tache floue qui se dérobe à notre entendement. Comme un effet de sfumato.
La fable concerne tous les parasites qui luttent plus ou moins pour gagner les faveurs des maîtres. Ainsi quand la mère prétend que si elle était riche elle serait tout aussi gentille (voire probablement naïve) que sa maîtresse, elle ponctue sa phrase par un geste violent à l’égard d’un des chiens (autres parasites) la ramenant bassement à sa condition de parasite. On rit jaune, parce que si la plaisanterie est amusante car paradoxale, il n’en reste pas moins que la morale en creux qu’on peut lire dans cette situation, c’est qu’on ne s’élève jamais de sa condition (de parasite). Le constat suggéré est noir : l’ascenseur social est un mythe.

Le récit est parsemé de petites incohérences, mais on les accepte comme on accepte de voir les animaux parler dans une fable. Le réalisme n’est pas un souci, même si parfois, on peut être en droit de se demander si l’absence de cohérence de certains éléments ne nuit pas un peu à une certaine forme de bienséance en nous sortant du film quelques secondes (perso j’ai levé un sourcil quand le père est censé rester plusieurs mois dans le sous-sol, se nourrit dans le frigo des Allemands quand ils sont là, mais se contente de boîtes de conserve pendant les mois où il n’y a personne dans la maison, alors qu’on nous a précédemment fait comprendre qu’il n’y avait pas assez pour vivre : sinon pourquoi la gouvernante s’inquiéterait-elle de son mari après son renvoi ?). Par exemple, quand on sait que chacun des membres de la famille finit par se faire employer dans la maison, et cela en quelques semaines, on n’est pas si choqué que ça de les savoir habiter toujours leur sous-sol miteux : parce que ça relève précisément plus de la fable que du réalisme. Il y a un souci de fabulisme comme il y a un souci de réalisme. L’erreur (et peut-être Bong Joon-ho s’y est-il laissé prendre à deux ou trois reprises) aurait été de vouloir rendre chaque recoin de la trame en cohérence les unes avec les autres avec le risque de dénaturer la fable.
S’il n’est pas recommandé de raconter les différents détours d’un film, avouons qu’on échappe pour cette fois à un twist final trop souvent de rigueur dans les thrillers. Au mieux assiste-t-on à deux coups de théâtre : un, une fois que le « plan » s’achève et qui sert à relancer efficacement l’intrigue et lui faire prendre un détour plus violent (la lutte des classes inférieures pour l’accès aux ressources détenues par les « riches ») ; et un autre dans le dénouement. Rien de plus classique. Aucun retournement qui vous oblige à remâcher ce que vous avez vu ou qui subrepticement vous fait avaler votre chewing-gum. Si le film tire à la fin légèrement sur le pathos et sur les fils de la cohérence (faute notamment à l’emploi un peu trop grossier des possibilités du morse), c’est tout de même appréciable de ne pas tomber dans un excès de retournements gratuits malgré la touche ludique, divertissante, du film (c’est le principe de la satire à l’italienne). Arriver à jouer sur les deux tableaux sans que l’un n’empoisonne ou ne finisse par phagocyter l’autre, c’est assez rare. Une forme réussie de symbiose par parasitage.
Autre réussite rare, l’usage narratif des smartphones. Il n’est jamais facile d’intégrer ces nouveaux objets dans une histoire tant la place qu’ils peuvent prendre dans la mise en scène et dans le montage peut vite devenir un problème. Le défi est alors d’apporter du contenu, du sens, à travers l’écran et par le biais de quelques mots. On revient presque un siècle en arrière quand il fallait jauger le nombre d’intertitres dans son film. Et Bong Joon-ho s’en tire très bien en se limitant le plus souvent à un plan, un message, intervenant dans le montage. L’information donnée fait avancer l’action, mais la réaction à cette information sera toujours visuelle : jamais (ou rarement), un texto ne répondra à un autre. Ce serait déjà une répétition. Les Coréens étant des fous de Kakao Talk (l’équivalent de WhatsApp), on remercie Bong Joon-ho de ne pas nous noyer (comme dans la vie) dans un tunnel de plans de messagerie (deux plans d’écran de smartphone qui se suivent, c’est déjà trop : on s’inquiète déjà d’en voir apparaître d’autres).
Il est assez rare de trouver chez un même réalisateur deux talents cohabiter, celui de la direction d’acteurs et celui de la réalisation (le montage technique comme on disait à une époque). Ceux capables de faire les deux comptent parmi les meilleurs. Reste alors plus qu’à savoir raconter une d’histoire, et on peut dire qu’on a affaire à un maître. Tous les acteurs sans exception sont parfaits, et ce n’est pas seulement dû à un choix de casting ou à la chance : la mise en scène de Bong Joon-ho est si précise, qu’aucune raison de penser que certains détails dans l’interprétation des comédiens soient le pur produit du hasard. Diriger un acteur, c’est souvent l’aider à se débarrasser de tout le superflu, c’est-à-dire l’expression, le geste, le regard, qui au moment voulu donnera du sens à la situation, éclairera le récit, les intentions ou l’état d’esprit de son personnage. Un acteur, ç’a toujours tendance à vouloir en faire beaucoup ; le metteur en scène doit donc être là pour le canaliser et l’obliger à respecter une sorte de ligne claire. Voilà pour la direction d’acteurs. Quant à la réalisation, elle se met justement au service du contenu. Les acteurs doivent servir le récit pour le mettre en lumière, la réalisation aide les acteurs (et à travers eux les spectateurs) à éclairer encore plus le sens (quitte à éclairer une zone de floue comme dit plus haut). En ce qui concerne le cinéma coréen actuel, on pourrait être toujours un peu tenté de craindre une réalisation sophistiquée à l’excès, maniérée. Et étonnamment, si Bong Joon-ho se fend de quelques mouvements de caméra, ceux-ci sont toujours justifiés : un travelling latéral d’accompagnement sur un personnage marchant vite, ça aide à suivre, et à coller, à son humeur ; un travelling lent commençant sur le visage d’un personnage révélant en une seconde ce qu’il pense en laissant échapper juste ce qu’il faut pour qu’on comprenne la situation (parce qu’il se pense observé par personne, en tout cas pas par l’autre personnage qui lui fait face mais qui ne le regarde pas à cet instant), puis bougeant lentement vers cet autre personnage, ça aide à comprendre l’opposition des personnages, à les inclure dans un même espace narratif qu’un champ-contrechamp aurait moins bien rendu (dans cet exemple, c’est moins le mouvement de caméra qui importe, mais le temps de latence entre les deux visages) : le mouvement de caméra permet de garder les personnages dans le même plan et d’insister sur leur nature (d’un côté le prédateur, de l’autre, la proie). Tout se tient : le metteur en scène dirige des acteurs pour donner sens à son histoire, il dirige sa caméra pour rendre au mieux les interactions entre les personnages, et au final, le but est de raconter au mieux son histoire… Pas de faire un film spectaculaire, drôle, non, raconter une histoire. La fable avant tout.
Notons encore le rythme assez échevelé du film : ce ne serait pas une qualité si Bong Joon-ho ne savait distiller parfaitement ses effets, ralentir quand il faut la cavalerie. Parce que faire un film haletant de bout en bout, rien de plus simple. Ici, jamais on ne s’ennuie : curieux et amusés au début, on profite à la fin du premier acte, et avec les membres de notre famille d’escrocs d’un repos bien mérité. L’objectif défini au début du film est atteint, on se questionne alors de ce vers quoi pourra alors s’orienter le film. Et ça repart de plus belle. Dans les deux cas (ou les deux actes), deux procédés me semble-t-il ponctuent assez souvent parfaitement le film pour diversifier les rythmes : si la comédie use d’effets lents et laisse toute la place aux acteurs pour nous faire entrer en empathie avec eux, la seconde partie, plus thriller et action, les deux sont parsemés ici ou là à la fois de montages-séquences pour nous montrer les avancées rapides de la trame (notamment dans l’évolution de l’escroquerie, et avec toujours un choix de musique judicieux), mais aussi de montages alternés (trois sections : les trois familles en prise le plus souvent avec un membre d’une des deux autres familles). (On notera à ce propos peut-être un épilogue certes maîtrisé du côté de l’emploi du montage-séquence, avec cette fois la voix du fils servant de lien entre les plans au lieu de la musique. Il fallait certes conclure le récit, et c’était sans doute le moyen le plus pratique pour ce faire, mais Bong Joon-ho en fait à ce moment peut-être trop, trop longtemps sur ce qui n’est plus du ressort de la trame principale.) Je n’avais pas vu une telle réussite en matière de montages-séquences (de mémoire) dans un thriller depuis Gone Girl (avec le même emploi du ralenti pour évoquer l’inéluctable majesté d’un plan se déroulant comme prévu).
Je ne vois guère que certaines comédies italiennes (ou un Molière) pour rivaliser avec la maîtrise de Bong Joon-ho en matière de satire. Je pense particulièrement à Une vie difficile pour l’alliance réussie de la comédie satirique (sociétale) et le drame attachant, et au Pigeon, pour l’aspect choral et branquignolesque. Mais la réussite encore plus palpable chez Bong Joon-ho, c’est en plus sa capacité à y adjoindre encore dans ce pot-pourri déjà bien garni de styles, une pincée de thriller. Et là, en plus d’évoquer cette fois Shakespeare pour son habilité à finir assez souvent ses films dans un joyeux carnage (ce n’est pas si commun de voir autant de personnages principaux disparaître de nos jours à moins de faire un film à élimination), on ne peut s’empêcher de penser à l’archiconnu Servante, œuvrant dans les mêmes sphères domestiques et le même rapport malsain entre maîtres et serviteurs (inversement des rapports entre maîtres et domestiques, appropriation par la plèbe du bon vieux sweet home cher à la classe « moyenne »).












 Année : 1923
Année : 1923





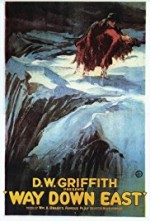








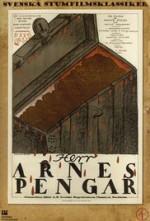








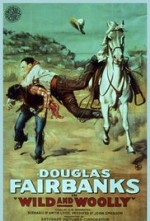






 Année : 1917
Année : 1917