Sakura en pleurs

La Lignée d’une femme
Titre original : Onnakeizu / 婦系図
Année : 1962
Réalisation : Kenji Misumi
Avec : Raizô Ichikawa, Masayo Banri, Michiyo Kogure, Koreya Senda, Eiji Funakoshi, Mitsuko Mito, Mako Sanjô, Saburô Date, Akihiko Katayama
— TOP FILMS —
Somptueuse adaptation d’un roman déjà adapté quatre fois au cinéma de Kyoka Izumi, auteur de nombreuses histoires qui seront adaptées au cinéma, dont Le Fil blanc de la cascade de Mizoguchi.
Aucune de ces précédentes versions n’est disponible. La première version réalisée par Hôtei Nomura voit Kinuyo Tanaka interpréter le rôle de la geisha devenue femme du personnage principal. On doit la seconde à Masahiro Makino pour la Toho en 1942 dans un film cité par les 300 de Tadao Sato dans son ouvrage de référence (Hideko Takamine joue la sœur cadette amoureuse de son frère adoptif et une autre actrice de Naruse, grande star des années 30, Isuzu Yamada, interprète le rôle de la geisha). La Daiei propose avant celle-ci une première version sortie en 1955 avec Teinosuke Kinugasa derrière la caméra et notamment Fujiko Yamamoto devant. Enfin, en 1959, la Shin-Toho en réalise une dernière version avant celle de Misumi (au cinéma, parce que le roman a fait l’objet de nombreuses adaptations à la télévision). Autant dire qu’on a affaire à un classique de la littérature et du cinéma ; ce qu’on voit là, ce n’est encore probablement que la partie émergée d’un gros iceberg camouflé dans le brouillard…
Je ne vais pas mentir. J’ai toujours eu un goût prononcé pour les contextes historiques composites rarement exposés au cinéma, les périodes intermédiaires et mouvantes. Le fait qu’en Occident on voit le plus souvent les productions nipponnes de manière dichotomique entre d’un côté les productions classiques en costumes prenant forcément place à l’époque Edo, et de l’autre, toutes celles qui sont contemporaines à leur récit (au mieux, les années 20-30), cela revient à écarter malheureusement le milieu de l’ère Meiji durant laquelle le Japon s’ouvre au monde, s’industrialise, s’éduque et connaît par conséquent un changement majeur dans la structuration et les usages de sa société (curieusement, le cinéma américain souffre du même déficit d’image, j’avais vu ça avec La Fille sur la balançoire). La période n’est pas pour autant délaissée des films que l’on peut souvent découvrir à travers notre angle auteuriste du cinéma, mais il est souvent trompeur, car on y voit finalement assez peu de ces changements d’usage (pas autant qu’il me plairait de les voir en tout cas : on reste cantonnés aux quartiers de plaisirs, à la campagne, certaines adaptations des romans prenant place à cette époque montrent assez peu du pays, et ce sont finalement peut-être les films de yakuzas qui dévoilent le plus de cette époque durant laquelle tous les instruments de cette modernité envahissante — lunettes, costumes à l’occidental, revolvers, premières automobiles — sont les attributs ostensibles de personnages déviants sans « code d’honneur »). Misumi réalise d’ailleurs l’année suivante une biographie d’un des acteurs de ces réformes, Ôkuma Shigenobu, à travers laquelle ces usages composites et mouvants sont encore plus notables que dans La Lignée d’une femme.
L’un des premiers usages qui tranche ici avec ce qu’on est habitué à voir, c’est la manière dont le personnage central de cette histoire, Hayase, un jeune pickpocket, est pris en main puis adopté au début du film par Shunzo Sakai, un professeur à l’Université impériale de Tokyo. Quelques années plus tôt, cette figure paternelle aurait été un samouraï ou un vaurien (comme le personnage de Shintarô Katsu dans L’Enfant renard). Et cela continue avec la séquence qui suit : devenu adulte, Hayase finit ses études et devient traducteur d’allemand. Confusion des classes et ouvertures nouvelles sur le monde, rien de mieux pour aiguiser mon imagination.
Après ce premier choc lié à la singularité et au caractère hybride de son sujet, vient pour moi un autre choc, esthétique, cette fois. Si la période Meiji est source de beaucoup d’étrangetés visuelles apparaissant parfois à l’écran, je dois faire un autre aveu : j’ai un faible pour les vitres au cinéma. Ce n’est pas un intérêt métacritique ou symbolique, comme certains, pour le surcadrage, c’est purement visuel. Les vitres permettent la mise en évidence d’arrière-plans travaillés dont l’intérêt est justement de n’en saisir qu’une infime portion et de deviner le reste. Comme les portes coulissantes ou les paravents, les vitres permettent aussi de structurer des espaces marqués à différents niveaux de profondeur. Ce que ces cadrages symbolisent, je m’en moque ; ce qu’ils rendent possible, en revanche, c’est surtout des ouvertures sur un monde disparu reproduit, ou suggéré, le plus souvent en studio. Des vitres donc, mais aussi un agencement propre aux petites maisons japonaises intégrant des éléments venus d’Europe tout en proposant dans un même plan des espaces de vie sur différents niveaux, des ruelles en arrière-plans qu’on devine juste au bord d’une fenêtre ouverte sur toute sa latéralité, des minuscules parcelles de jardin combinant dans un désordre factice une variété de végétaux et d’ustensiles exotiques, des panneaux pour délimiter les propriétés, mais derrière lesquels on devine déjà toute une vie disparue, il y a tout ça dans le film. Une vitre, un espace structuré, c’est un piège à hors-champ, un fouet à l’imagination. Et encore une fois, si la plupart du temps, ces vitres, shôji ou panneaux soulignent des espaces devenus familiers à force de les dévoiler au cinéma, c’est d’autant plus excitant ici que cela concerne un monde rarement mis aussi bien en évidence au cinéma.
C’est que le budget artistique (art design, décors, costumes et accessoires) doit affoler les compteurs.
Une fois sous le charme des premières minutes (sujet et direction artistique), il faut encore que le sujet réponde aux promesses initiales.
C’est une constante, au Japon comme ailleurs : quand les classes fractionnées tentent de se recoller pour former une société nouvelle que l’on espère apaisée, les vieux réflexes réapparaissent, et on tend à faire appel à des fondamentaux sociocomportementaux pas si désuets que ça. Devenu adulte, Hayase, l’ancien pickpocket adopté par un notable, compte bien se marier avec la femme qu’il aime, Otsuta, une geisha. Cette dernière n’y croit pas beaucoup, et pourtant, sans le révéler à sa famille, aidé seulement de deux serviteurs, le jeune homme, fraîchement diplômé, se marie et s’installe avec Otsuta qui a tout à apprendre du rôle de la femme au foyer. Parallèlement à ce bonheur conjugal naissant, c’est surtout la question de la fille légitime de son père que la famille devra régler. Car Taeko est amoureuse de son frère adoptif et n’est pas pressée de voir les prétendants se masser à la porte du patriarche. Les difficultés commencent quand Eikichi Kono, le fils d’une importante famille de Shizuoka se met en tête de se marier avec la demoiselle. Sa mère qui joue les entremetteuses pour ce mariage n’arrive pas à convaincre Shunzo Sakai, le père de Taeko. Seulement, Eikichi connaît Hayase et après une première demande infructueuse trouve moyen de faire pression sur lui : il apprend d’abord qu’il est secrètement marié avec une geisha alors que ces alliances sont prohibées au sein de l’institution où il exerce désormais en tant qu’interprète, et il assiste à un vol dans lequel Hayase est impliqué malgré lui et le dénonce à la police pour se venger de lui.
Les conséquences négatives s’enchaînent alors pour Hayase. Eikichi s’étant assuré que la presse ait eu vent de son histoire, l’ancien pickpocket perd d’abord son emploi ; son père apprend du même coup son mariage avec une geisha. Shunzo Sakai demande alors à son fils de faire un choix : soit il quitte sa femme indigne, soit il reste avec elle et il coupe les ponts avec lui. À cette occasion, on se rend compte surtout que l’hypocrisie de cette nouvelle classe dominante a tout de celle de la génération précédente. Car Sakai a lui-même longtemps entretenu une geisha : l’ancienne « okami » d’Otsuta. Et une fille est née de cette relation : Taeko. (On est dans le mélo, je me régale.) L’histoire ne fait que se répéter.
À ce sujet, petit intermède. Les amateurs de la politique des auteurs et aficionados de la psychanalyse pourront également se régaler parce que deviner qui est justement issu d’une union illégitime entre une geisha et un riche marchand ? Kenji Misumi (c’est du moins ce qu’on apprend sur la ressource des sans ressources). On peut donc légitimement penser que le sujet du film le touchait particulièrement.
On n’en est pas à la moitié du film, et c’est pourtant à cet instant qu’apparaît la grande scène à faire. Dans un jardin magnifique, baigné dans une atmosphère brumeuse et poétique, au milieu des sakuras en fleurs (symbole de la beauté et de l’amour éphémère), Hayase dit à sa femme qu’ils vont devoir se séparer. Elle ne comprend d’abord pas, pensant, naïvement, et certaine de l’amour qu’il lui porte, que c’est elle qu’il a choisie quand son père l’a mis au pied du mur. Dans tous les films de Misumi, on retrouve ces face-à-face décisifs entre amants ou ennemis (c’est la même chose), et chaque fois, c’est bien le sens du cinéaste à diriger ses acteurs, ralentir le rythme, jouer sur les regards et sur l’incertitude qui ressort. Misumi n’est pas le cinéaste des sabres qui s’agitent, fer contre fer, mais bien celui des face-à-face qui précèdent les explosions de violence ou les séparations. Un homme rencontre une femme, comme disait Wilder qui s’amusait que cela puisse représenter l’idée la plus géniale qui soit au réveil d’un scénariste un peu ivre. On n’a jamais trouvé mieux.
L’avantage parfois des adaptations de roman, c’est que ceux-ci ne sont pas exactement calibrés pour le cinéma. Les adaptateurs s’y cassent souvent les dents, mais pour qui a le génie d’un Yoshikata Yoda, cela peut être l’occasion de surprendre le spectateur et de faire le pari d’un nouvel élan. Une fois la grande scène de la séparation finie, on a ainsi l’étrange impression qu’en plein milieu du film, une tout autre histoire commence (tandis qu’un autre amour éphémère prend forme : le scénariste de Mizoguchi entame ici une première collaboration avec Misumi ; ils se retrouveront sur trois autres grands drames, La Famille matrilinéaire, Deux Sœurs mélancoliques à Kyoto et La Rivière des larmes).
Les dénouements précoces, je n’y crois pas beaucoup. C’est pourtant parfaitement réussi ici. Poussés ou émus par cette séparation soudaine, cruelle et brutale, on voit le film parvenir à rester sur la même émotion. De la même manière que le silence qui suit une musique de Mozart reste du Mozart (dixit Sacha Guitry), Yoda et Misumi arrivent à surfer sur le deuil de cette histoire d’amour sincère. À moins que la force du récit à ce moment soit de nous raccrocher à des enjeux pas si nouveaux que ça, avec des cheminements narratifs qui reprennent de plus belle… Quoi qu’il en soit, alors que l’on reste désarçonnés par l’émergence de ce dénouement précoce, tout donne l’impression par la suite d’apparaître à l’écran pour la première fois, comme si l’histoire qui se développait maintenant à l’écran n’avait jamais été racontée. Une impression étrange, renforcée par les décors exceptionnels et en couleurs de ce monde reconstitué de milieu de période Meiji.
L’une part dans le village de son enfance pour devenir coiffeuse ; l’autre se met en tête de partir pour Shizuoka rencontrer la famille d’Eikichi pour se venger à son tour de ses bassesses. C’est que Hayase a découvert que Madame Kono, celle qui était venue enquêter et jouer les entremetteuses auprès de sa sœur Taeko… a une fille aînée née d’une relation extra-conjugale. Il arrive à la faire chanter et au moment où il allait révéler le secret à sa fille, Madame Kono tire sur Hayase avec un revolver. (Je me régale : c’est du mélo et elle lui tire dessus à travers une vitre !)
Et on se régale ainsi une vingtaine de minutes supplémentaires. Évidemment, si on goûte peu au mélo, l’addition risque d’être amère. Car ces minutes sont loin d’être apaisées. On meurt et on pleure beaucoup. Taeko vient rendre visite à celle qu’elle ne sait pas être sa mère et à Otsuta, désormais malade : ayant appris le mariage de son frère aimé avec l’ancienne geisha, Taeko ne montre aucune rancune envers elle et lui montre au contraire toutes les meilleures attentions du monde. Avant que la dernière fleur de cerisier soit arrachée de son arbre…
L’honneur est sauf, pour cette fois, l’arbre généalogique d’une « femme indigne » s’arrête là sans avoir donné à cette joyeuse société d’hypocrites le moindre fruit pourri.
S’il y a une mince réserve, ce serait l’interprétation de Masayo Banri en Otsuta. Une femme magnifique, à la beauté presque plus moyen-orientale que japonaise avec un grand nez, mince et étroit. Jolie, mais peut-être pas assez innocente pour le rôle, plus faite pour la comédie avec son œil enjôleur et sa bouche moqueuse (elle joue Otane la même année dans Zatoïchi et est, à ce jour, comme c’est de coutume de le dire pour ces témoins de l’âge d’or du cinéma japonais, toujours vivante). En voyant qui l’avait précédée dans les versions antérieures, cela laisse songeur… Autre acteur à contre-emploi, Eiji Funakoshi, habitué des rôles d’hommes sages et éduqués, qui interprète ici le serviteur.
Jaquette DVD de La Lignée d’une femme, Kenji Misumi (1962) Onnakeizu | Daiei
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel



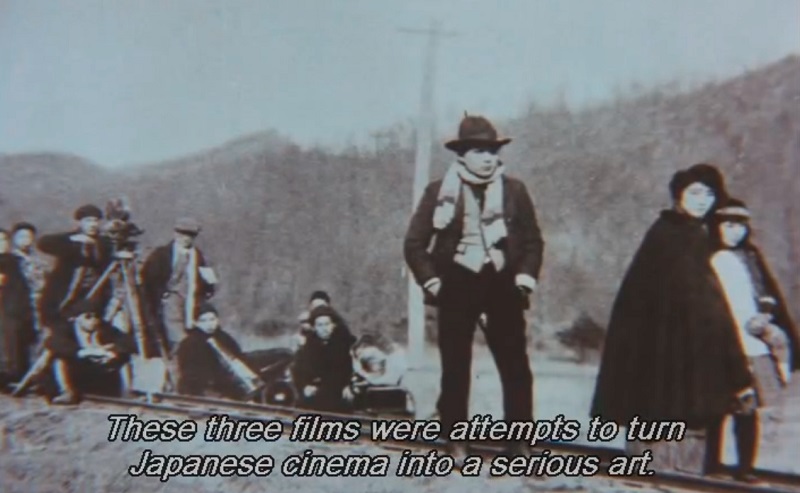




 Année : 1952
Année : 1952























