Illusions perdues
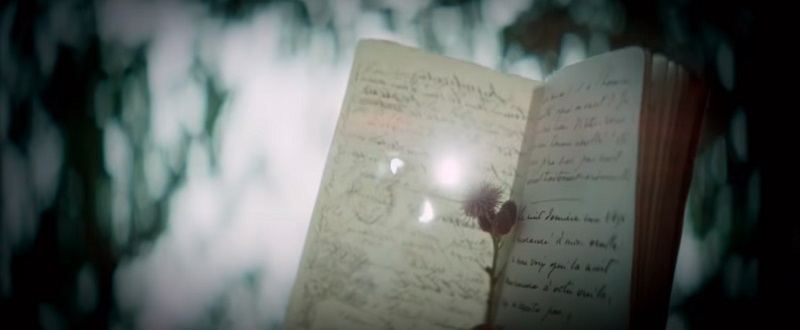

Illusions perdues
Année : 2021
Réalisation : Xavier Giannoli
Avec : Benjamin Voisin, Gérard Depardieu, Jeanne Balibar, Xavier Dolan, Vincent Lacoste, André Marcon, Louis-Do de Lencquesaing, Jean-François Stévenin
Une réplique résume assez bien le film, celle où Lucien critique le roman de Nathan qu’il n’a pas lu en prétendant qu’il manque de mystère et que si certaines choses doivent être dites dans un roman, il faut également que d’autres soient tues. Cela s’appliquerait tout autant au cinéma, et en particulier à ce film, parce qu’en plus du défi déjà difficile de l’adaptation, Xavier Giannoli se devait d’en relever un autre pour ne pas décevoir : ainsi, si son film dispose par ailleurs de beaucoup de qualités, liées en partie à la production et à la transcription à l’écran on peut lui reprocher le caractère démonstratif de son exécution notamment dans sa direction d’acteurs.
Commençons par les réussites. Réputée impossible, l’adaptation, en se concentrant manifestement sur le second volet du roman et sa partie parisienne, en supprimant une bonne part des personnages (la sœur de Lucien n’apparaît que comme destinataire de ses lettres, le Cénacle a totalement disparu) ou en en réunissant d’autres (le personnage de Nathan semble réunir deux personnages) arrive à convaincre et à trouver sa propre unité. Le cinéaste paraît avoir aussi forcé la correspondance entre la situation politique et journalistique de l’époque de la Restauration avec la nôtre. Je ne pourrais dire jusqu’à quel point le trait est forcé, et si cela était nécessaire, mais la connexion est parlante : la critique cinglante du journalisme faite par Balzac (et qui lui était, semble-t-il, reprochée) reste d’actualité. La question des fausses nouvelles a plus rapport aujourd’hui avec le développement des réseaux sociaux, mais la multiplication des canards de l’époque rendue possible par de nouvelles techniques d’imprimerie n’était-ce pas déjà d’une certaine manière une forme de réseau social avec leur manque de contrôle ?

Les trouvailles scénaristiques du cinéaste pour adapter le roman d’ailleurs (si tant est que je puisse les identifier), en particulier celle qui implique la nature du personnage joué par Xavier Dolan, sont impeccablement imaginées. Adapter, comme traduire, c’est trahir. Les astuces de Xavier Giannoli permettent au récit de s’articuler comme un film ancré dans son époque — avec tous ses petits trucs, ses modes, pour le meilleur et pour le pire — au lieu de se contenter d’en proposer une adaptation fidèle, mais confuse.
La reconstitution est parfaite. Le travail sur le décor, sur les accessoires, les figurants, tout en rapport dans un film à la production et à la scénographie (comme on dit au théâtre ou dans certains pays), avec le découpage technique, le montage, la lumière, etc., tout ça donne au film une densité rare dans le cinéma français.
Une fois qu’on en est là, une bonne part du travail est accomplie. Le public en aura pour son argent. Reste l’essentiel quand on a répondu à tout ce cahier des charges des grosses productions historiques : la petite note de talent et de savoir-faire qui distingue un film d’un autre. La bascule décisive se situe presque toujours au niveau de la mise en scène. Et l’on touche ici aux limites des compétences de Xavier Giannoli. Les mêmes défauts se retrouvent d’ailleurs constamment dans ce genre de productions : quand il est question de rythme, de montée d’intensité, de pesanteur poétique ou lyrique, de frénésie ou de folie, d’urgence… ou de direction d’acteurs, tout cela doit passer en définitive par les acteurs.


Comme disait l’autre, une bonne part de la direction d’acteurs consiste à réussir sa distribution. En ce qui concerne les seconds rôles, c’est du haut niveau : Gérard Depardieu, Jeanne Balibar, Xavier Dolan, Vincent Lacoste, André Marcon, Louis-Do de Lencquesaing, Jean-François Stévenin… Sur le papier, ça envoie du lourd. Chacun semble fait pour son rôle respectif. Et malgré une direction d’acteurs perfectible (des petites fausses notes de justesse que le réalisateur laisse passer), ils assurent, grâce à leur seul talent, le gros du travail de mise en situation et d’ambiance. Les dialogues auraient gagné à être mieux ciselés (quelques « n’est-ce pas » et des prénoms inutiles en fin de phrase affreusement rendus par exemple), mais sans eux, sans leur justesse, parfois sans leur folie, sans leurs audaces, sans leur style (souvent caractéristique, personnel, à la limite de l’incongruité et de l’anachronisme pour certains, mais c’est un atout même dans un film historique), on s’ennuierait bien vite.
Là où ça pêche bien plus, c’est que pour faire face à une telle distribution, il faut un acteur pour jouer le premier rôle capable d’endosser le costume et d’assurer la comparaison. Benjamin Voisin ne concourt malheureusement pas dans la même catégorie que ses collègues. Quand je qualifiais le film de démonstratif, sans mystère, ces défauts majeurs appliqués au film pourraient autant être, ou surtout, imputable, à son acteur principal. Rien dans sa composition n’est joué dans la nuance, tout est restitué au premier degré, fait pour être vu et apprécié, saisi, par le spectateur (et par conséquent, rien ne lui est laissé, au spectateur, à sa seule interprétation). Il force, explicite, surjoue, surnote… Loin d’être mauvais, l’acteur manque de force de caractère, de style, d’audace, de précision, de spontanéité, de maîtrise aussi, comme certains de ses partenaires. C’est d’ailleurs un des plus grands écueils auquel doit faire face un acteur : réussir à manier contrôle de soi (sans lequel il n’y a pas de précision, pas d’autorité, pas de maintien ou de tenue) et spontanéité ou justesse… Quand on cherche l’un, on perd souvent de l’autre ; et quand on est en recherche de l’un (de la maîtrise, donc), c’est par définition qu’on n’en dispose pas naturellement… (ce qui interdit forcément à la fois l’aisance, la spontanéité et l’audace). Même avec leurs défauts (leur âge plus avancé surtout), j’aurais préféré voir ce qu’aurait donné Xavier Dolan ou Vincent Lacoste dans le rôle de Lucien. Et malheureusement, si tous ces acteurs magnifiques aident Benjamin Voisin, le plus souvent, à garder le rythme ou à créer une situation lors de leurs face-à-face, quand il est seul ou, pire, accompagné d’une actrice, pour le coup, là, sans talent, tenant le rôle de Coralie, plus rien ne va : il ne peut plus seulement être en réaction (ce qu’un acteur moyen peut encore se contenter de faire face à de meilleurs acteurs que lui), il doit être moteur de l’action, donner le ton, attiser la tension, susciter le mystère, l’intérêt, proposer des nuances complexes et contradictoires, le tout subtilement, sans forcer… Et le cinéaste ne le soutient pas beaucoup : la nuance, le sous-texte, c’est ce qu’un acteur joue en permanence et à tous les niveaux. Or, un mauvais directeur demandera à un acteur moyen d’ajouter de la nuance dans les pauses ou à l’ultime seconde du dernier plan d’une séquence… (Je vois d’ici la scène : « Tiens, là, quand Cécile de France quitte la pièce et te laisse face caméra, au lieu de jouer l’émotion, joue la défiance ! Ça met un peu de nuances et accroît la complexité du personnage ! ») Ben, non. Quand on parle de sous-texte, c’est du texte qui s’ajoute au texte des dialogues, « sous », ou « par-dessus ». Pendant (et cela, à travers le regard, la posture, l’attitude, l’intonation, l’action souvent anodine dans ce registre), ce n’est pas du « après texte ». La nuance, c’est une couleur générale qui se trouve à chaque seconde, par composition comme dans une pièce musicale, pas par petites notes (de bas de page ou de fin de séquence) successives et épisodiques. Et souvent, l’acteur apporte cette nuance à travers ses audaces, ses propositions, ses ratés aussi parfois (l’avantage du cinéma par rapport au théâtre où l’on ne dispose pas d’une autre prise). Rien de cela n’est possible si l’acteur n’a pas le talent pour suggérer certaines de ces audaces, si le directeur d’acteurs ne lui laisse pas l’occasion d’oser s’engager vers cette voie et s’il ne le met pas dans les meilleures conditions pour favoriser ces prises de liberté ou s’il ne tend pas lui-même vers des dispositifs qui permettent à un acteur de trouver l’aisance nécessaire à l’émergence de ces propositions. Sans cela, oubliez la spontanéité et la justesse.

La performance d’un acteur principal ne relève pas de l’anecdote dans un film. C’est lui qui donne le ton, qui assure l’efficacité d’un des principes fondateurs du spectacle. À travers lui, le public croit en ce qu’il voit : quand un acteur se cherche, quand le spectateur découvre un acteur qui joue plutôt qu’un personnage dans une situation, le pari de la vraisemblance échoue. Un détail résume cette cassure et ce lien interrompu entre le spectateur et le récit : quand la situation réclame qu’un acteur se lance dans de grands éclats de rire et qu’on ne voit qu’une chose, un acteur qui se force à rire, le charme est irrémédiablement rompu, on ne peut y croire.
Ces gros défauts de mise en scène se manifestent le plus souvent quand Lucien apparaît seul à l’écran ou est accompagné de Coralie, et c’est d’autant plus difficile à jouer pour Benjamin Voisin, qui ne profite pas de l’élan apporté par les autres acteurs, que Xavier Giannoli le met en scène à ce moment-là dans des montages-séquences (il n’est pas forcément seul dans l’espace, mais seul à l’écran ou le centre de l’attention). Comment voulez-vous interpréter une situation quand vous n’apparaissez à l’écran que dans un plan de quelques secondes ? Ce sont des tableaux successifs que propose ici le cinéaste. M’est avis que la meilleure chose à dire un acteur est alors d’en faire le moins possible. Ce n’est pas, semble-t-il, ce qu’a choisi de dire Xavier Giannoli à son interprète. Et même quand le cinéaste ralentit volontairement le rythme, comme quand lors d’un plan faisant peut-être référence à Stanley Kubrick, c’est bien lui qui ne trouve pas le ton juste (son travelling arrière est intéressant, mais il s’intègre assez mal à la séquence — voire à la musique — qui précède, et le rythme qu’il instaure à la scène est bancal : un baiser sur le front, un personnage qui passe hors cadre pour ne laisser que le principal à l’écran…, on voit l’idée, mais ça ne marche tout simplement pas, le genre de scène que Kubrick aurait reproduit cent fois pour trouver le bon rythme, le geste juste). Ce n’est donc pas qu’une question de distribution, il manque ce petit quelque chose à Xavier Giannoli pour arriver ici à élever son film.
Mais ne gâtons pas notre plaisir. On ne demande pas à tous les films de se hisser à la hauteur de tous les grands films. Une adaptation réussie, c’est assez rare pour être appréciée à sa juste valeur. En attendant, j’irai revoir Les Frères Karamazov de Richard Brooks pour me rappeler à quoi peut ressembler une adaptation qui tient du chef-d’œuvre (et avant que son génial et improbable interprète, William Shatner… s’envole chatouiller les nouvelles frontières de l’infini).
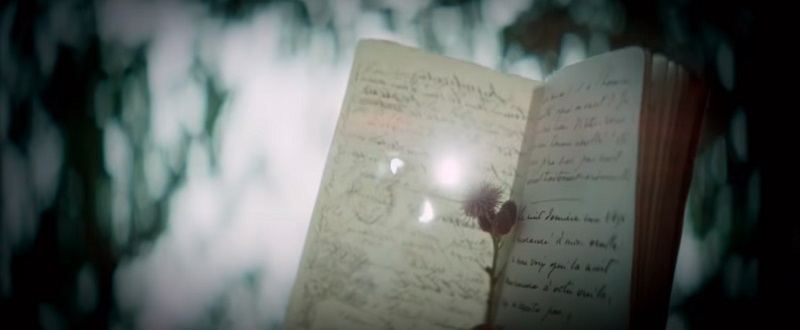

Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel

























































